Article élu d'intérêt général
Les lecteurs d’Élucid ont voté pour rendre cet article gratuit.
La dernière note du Haut-Commissariat au Plan, consacrée à « la bataille du commerce extérieur », constitue une illustration spectaculaire de l’impotence à laquelle l’élite dirigeante, confite dans son dogme néolibéral, a fini par se résigner.



Abonnement Élucid
Le constat établi par les auteurs du rapport est pourtant sans appel et parfaitement présenté. Depuis le début des années 2000, la France connaît un déficit commercial structurel qui n’a cessé de s’accroître, pour atteindre 77 milliards d’euros en 2019 ; 74 % de ce déficit, soit 51 milliards, repose sur la seule industrie manufacturière. Il représente 3,1 % du PIB, quand celui de l’Espagne est de 2,7 %, et que l’Italie et l’Allemagne jouissent d’un excédent représentant respectivement 3,1 et 6,7 % de leur PIB.
Gravité du diagnostic
Le contraste distinguant les deux premières économies de la zone euro est grandement défavorable à notre pays, l’excédent allemand dépassant les 200 milliards d’euros. Si la France est déficitaire dans sa relation commerciale avec l’Allemagne, l’ampleur du déficit est sujette à débat : de l’ordre de 15 milliards d’euros pour les autorités françaises, il est estimé à plus de 40 milliards par l’office allemand de la statistique publique.
Sans chercher à l’expliquer, les auteurs du rapport, dans un bel effort de lucidité, déduisent benoîtement de cette incertitude qu’elle « peut être source d’une différence de perception politique, préoccupante quant à la réalité d’un co-leadership franco-allemand en Europe ».
Mais ce qui vaut pour les échanges franco-allemands vaut également pour les échanges de la France avec les autres pays européens ; le déficit y est la norme avec les Pays-Bas, la Belgique et l’Italie. Seule la Grande-Bretagne achète sensiblement plus à la France qu’elle ne lui vend (12 milliards en 2019). À ces déficits européens s’ajoutent ceux des relations commerciales entre la France et les pays asiatiques, Chine en tête (15 milliards en 2019).
Tout à son ambition de description exhaustive, le rapport pointe ensuite les principales branches concernées par ces déficits structurels. Il va même – c’est là son principal intérêt – très au-delà de l’analyse habituelle par branches, puisque sont identifiées dans l’étude 914 postes ou produits dont le déficit est supérieur à 50 millions d’euros par an et dont l’ensemble représente plus de 80 % du déficit total. Sans surprise, ces quelque 900 postes recouvrent l’ensemble de l’activité économique. Regroupés par branches, ils donnent les résultats suivants :
- Équipements et objets de la maison : 42 milliards d’euros de déficit en 2019 ;
- Machines, outils, équipements professionnels : 13 milliards ;
- Textile, vêtements et accessoires : 17 milliards ;
- Produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux : 7 milliards.
À ces branches déficitaires de longue date s’ajoutent celles des « véhicules et équipements de transport » (33 milliards) et des « produits agricoles alimentaires » (22 milliards).
L’automobile, excédentaire jusque dans les années 2000, a cessé de l’être depuis, conséquence d’une baisse très nette de la production nationale, quand celle de l’Allemagne s’envolait. En 2000, la production automobile allemande était 3,1 fois supérieure à la production automobile française ; en 2016, la production allemande est 6,6 fois supérieure à la production française. Les deux tiers des salariés des firmes automobiles nationales sont aujourd’hui employés par leurs filiales étrangères, conséquence des délocalisations massives réalisées depuis vingt ans.
Dans le domaine agricole, enfin, la France est également devenue ces dernières années déficitaire dans bien des productions, à commencer par les fruits et légumes.
Si dans toutes ces branches, d’autres postes se caractérisent à l’inverse par leurs excédents, ils ne permettent pas d’assurer ne serait-ce que l’équilibre de notre commerce extérieur.
Ce déficit chronique et massif, sans précédent dans l’histoire contemporaine de la France, découle en droite ligne de la désindustrialisation poussée qu’a connue notre pays au fil des dernières décennies. Tous les vieux pays industriels ont certes connu une diminution du poids relatif de leur secteur industriel dans l’économie à la faveur du décollage économique des pays asiatiques dans le cadre de la mondialisation, mais la France se distingue par l’ampleur de son déclin dans ce domaine.
Le poids de l’industrie dans le PIB y est ainsi passé de 23 % en 1980 à 13,5 % en 2019, un niveau bien inférieur à la moyenne européenne (UE à 27, 19,7 %). Parmi les pays développés, seuls les États-Unis et la Grande-Bretagne ont connu une évolution comparable.
Or, l’industrie est un secteur clé de l’économie, indispensable au maintien de l’emploi et au développement d’un pays. Sans elle, pas ou peu de gains de productivité, pas ou peu de progrès technique, des pertes d’emplois directs et indirects en nombre, une fragmentation territoriale aggravée (par le basculement dans la France périphérique d’espaces dévitalisés) et une dépendance économique et géostratégique vis-à-vis de l’étranger, dont la crise sanitaire a constitué une douloureuse illustration.
Indigence de l’analyse
On aurait pu croire que la gravité du constat allait inciter les auteurs du rapport, sous la direction de François Bayrou, à produire une analyse sans concession des facteurs à l’origine de cette désindustrialisation, quitte à remettre en cause un certain nombre d’a priori idéologiques solidement ancrés dans le sens commun.
Las ! Il n’en est rien malheureusement. La description détaillée du déficit, la multiplication des chiffres et des graphiques ont aussi pour vocation de masquer l’indigence de l’étude lorsqu’elle s’interroge sur les causes du déclin, tout autant que lorsqu’elle se risque à avancer de prétendues solutions.
Au titre des causes, donc, à peu près rien, sinon, peut-être, un effet de mode : « Il faudra faire un jour l’histoire de la désaffection brutale que le secteur productif en général, spécialement le secteur productif industriel, a subie ces trente dernières années », ou encore : « À partir des années 90, l’industrie a été délaissée, à l’heure où la tertiarisation de l’économie et l’industrie sans usines avaient le vent en poupe ». Le refus de se pencher sérieusement sur les facteurs à l’origine de notre affaissement industriel condamne ainsi les auteurs du rapport à se contenter d’une pseudo-explication tout à fait superficielle, et même à évoquer – comble de l’aveuglement – un « déclassement sans cause » !
Les vecteurs d’un éventuel redressement évoqués ensuite témoignent, eux aussi, de l’extraordinaire enfermement idéologique qui règne au sommet et qui ne réduit à presque rien les possibilités d’action. Le rapport se contente de proposer que l’État définisse une « stratégie nationale » de reconquête productive dans tous les postes déficitaires, en associant étroitement les grands groupes, les jeunes pousses, les ETI et les PME, le tout saupoudré de prises de participation nationale dans le capital de certaines entreprises afin d’inciter à la relocalisation de leurs unités de production. Autrement dit, le Plan, une fois dressé par lui le constat alarmant d’une désindustrialisation massive de la France, n’a rien de sérieux à proposer pour y remédier : aucune vision d’ampleur, aucune réflexion audacieuse, aucune proposition concrète.
Il faut voir cette tragique impotence comme une conséquence du refus de mettre en cause le cadre macro-économique mondialisé dans lequel l’industrie française a évolué ces dernières décennies. Refus à peine conscient, tant la soumission idéologique qu’il suppose va de soi dans l’esprit de nos dirigeants. Le libre-échange, la liberté de circulation des capitaux, l’indépendance de la banque centrale et la monnaie unique européenne sont considérés comme des faits de nature, sur lesquels le pouvoir des hommes ne saurait s’exercer, sauf à prendre le risque de déclencher des catastrophes.
Ainsi, l’indépendance de la banque centrale – c’est-à-dire sa soumission aux intérêts de la haute finance transnationale - n’a pas à être questionnée ; qu’elle prive l’État français du levier de la politique monétaire quand, partout ailleurs dans le monde, les États utilisent cette politique pour réguler leurs échanges commerciaux avec l’extérieur, voilà qui ne saurait poser problème, dès lors que la supériorité ontologique du Marché est admise.
Ainsi, autre exemple, l’euro n’a-t-il pas à être mis en cause, en dépit de l’abondante littérature qui depuis 20 ans en a démontré ses effets néfastes pour la France. « Il n’y a pas de différence entre l’Allemagne et la France sur la monnaie puisque les deux pays ont l’euro en partage » vont même jusqu’à affirmer les auteurs du rapport, étalant crânement au passage leur analphabétisme économique. Il semble qu’ils n’ont jamais entendu parler de l’impact différentiel de l’euro sur l’économie des États qui l’ont adopté ; surévalué pour la France, sous-évalué pour l’Allemagne aux dires mêmes du FMI, l’euro a procuré à Berlin un avantage compétitif décisif, dont témoignent les échanges commerciaux entre les deux pays.
L’euro est, depuis sa naissance, une condition du succès commercial de l’Allemagne, un succès acquis aux dépens de la France, dont il a accéléré le déclin productif. Dans cette perspective, l’apparition d’un déficit commercial structurel français dans les années qui suivent l’apparition de la monnaie unique ne saurait relever du hasard. Les auteurs du rapport s’étonnent par ailleurs de ce que l’Allemagne reste performante dans la plupart des branches industrielles, y compris dans la production d’appareils électroménagers, où la France a perdu l’essentiel de ses usines, délocalisées notamment vers l’Europe médiane.
Comment ne pas y voir, là encore, un effet concret de la divergence économique alimentée par l’euro ? Confortée en Allemagne par une politique de freinage salarial et de démantèlement de la protection sociale mise en œuvre au cours des années 2000 pour gagner encore en compétitivité dans le cadre du Marché unique, cette évolution pose en outre la question du libre-échange et de la libre circulation des capitaux, autres points aveugles du rapport.
Lorsqu’en 2017, Emmanuel Macron s’est rendu, pour des raisons électorales, sur le site de l’usine Whirlpool à Amiens en passe d’être délocalisé en Pologne, le futur président de la République a précisé qu’il ne ferait pas de « miracle », autrement dit que la délocalisation était dans l’ordre des choses et qu’il convenait d’en atténuer les effets sociaux plutôt que d’en combattre les causes. Quatre années plus tard, les auteurs du rapport ne pensent pas autre chose, puisqu’aucune mention n’est faite du libre-échange dans leur propos, comme si la politique commerciale n’avait aucun impact sur l’appareil productif.

La chose est pourtant difficile à nier lorsque cette politique, indéfectiblement acquise au libre-échange depuis des décennies, met en concurrence, à l’intérieur de l’UE et au-delà, des pays au niveau de développement très dissemblables : que pouvaient espérer les employés français de Whirlpool, dès lors que leurs concurrents polonais se contentent d’un salaire minimum de 540 euros et que leur production peut être exportée en France sans entrave douanière ? L’adhésion dogmatique du pouvoir en place aux thèses libre-échangistes et, pire encore, la délégation à l’UE du pouvoir de négociation des accords commerciaux avec le reste du monde condamne le tissu industriel de la France à une inexorable érosion.
Ainsi privé, par sa soumission à « l’Europe » et aux exigences du capitalisme financier, de l’essentiel des leviers qui constituent ailleurs dans le monde les prérogatives ordinaires des États, la France se trouve condamnée à subir son déclin, aussi longtemps que ses élites s’arc-bouteront sur des conceptions idéologiques dépassées, comme le font, sans peut-être même en avoir conscience, les auteurs du rapport.
Incapables de discerner l’essentiel, ils s’en tiennent à une analyse causale indigente tout en reconnaissant et en décrivant longuement la gravité de la situation. Dans ces conditions, les moyens d’action prônés pour enrayer la spirale du déclin ne peuvent être que dérisoires, comme en témoignent certaines déclamations purement incantatoires, aussi vaines que déplacées : « Rien n’est impossible à un pays comme le nôtre », est-il écrit dans le rapport. Rien, sinon la remise en cause radicale du cadre qui a précisément abouti à notre déclin…
La Haut-Commissariat au Plan, ressuscité en 2020 par un Président de la République soucieux d’affichage et maître de l’illusion, n’a en fait rien à proposer en matière de stratégie économique, à la différence de son glorieux prédécesseur. La faiblesse indigne de ses propositions le démontre, elles qui reprennent à la lettre les propos insipides que tenait il y a dix ans déjà, François Bayrou, son actuel dirigeant, sur ce même sujet.
Dans les premières lignes de son célèbre article, favorable au protectionnisme, « De l’autosuffisance nationale », Keynes rappelle, en 1933, qu’il a « été élevé dans le respect du libre-échange, considéré non seulement comme une doctrine économique qu’aucune personne rationnelle et instruite ne saurait mettre en doute, mais presque comme une composante de la morale. » Et d’ajouter : « C’est un long processus que celui de s’arracher à des modes de pensée qui était ceux d’avant la guerre, ceux du XIXe siècle ». S’il était encore en vie, il serait sans doute stupéfait de constater à quel point le XXe siècle finissant et le XXIe naissant ont pu sur ce point-là connaître une vertigineuse régression, dont la France constitue, hélas, un exemple achevé.
Photo d'ouverture : Emmanuel Macron et François Bayrou, Pau, 13 janvier 2020 - Régis Duvignau - @AFP
Cet article est gratuit grâce aux contributions des abonnés !
Pour nous soutenir et avoir accès à tous les contenus, c'est par ici :
S’abonner
Accès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous

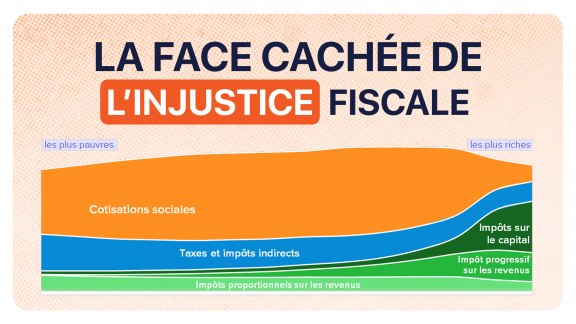






6 commentaires
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.
S'abonner