On le sait, le changement climatique est réel et l’Arctique se réchauffe comme le reste de la planète, provoquant la fonte de la banquise. Outre les effets sur la hausse du niveau des mers, cela va engendrer un autre problème, car des organismes pathogènes (notamment des virus) sont restés piégés dans la glace depuis des millénaires. Si le pergélisol dégèle, irons-nous vers une nouvelle pandémie ? Des équipes européennes ont déjà réussi à « ramener à la vie » des virus géants retrouvés dans le sol sibérien. Même si ceux-ci ne sont a priori pas une menace pour la santé humaine, qu’en est-il pour les autres pathogènes enfouis ?

Si le réchauffement climatique est déjà responsable de la migration de vecteurs de maladies infectieuses du Sud vers le Nord (notamment le moustique tigre), le danger pourrait bien venir du Grand Nord. La fonte des glaces est associée à celle du permafrost ou pergélisol, où se trouve conservés dans le froid de nombreux micro-organismes, dont des virus et autres bactéries. Or, ceux-ci pourraient potentiellement être de nouveau actifs une fois que la hausse des températures les aura sortis de leur « état léthargique ».
Cela peut ressembler à la science-fiction et pourtant, récemment, des scientifiques d’une équipe internationale sont parvenus à « réveiller » ces anciens virus âgés de 30 000 à près de 50 000 ans. Et tous avaient gardé leur capacité infectieuse ! Heureusement, et pour des raisons logiques de sécurité, l’ensemble de ces pathogène ciblait des protozoaires, organismes très éloignés de l’Homme et des mammifères en général.
Mais comment cela est-il possible ? « De la même manière que vous mettez une graine, même ancienne, dans la terre. Un virus subsiste sous deux formes dont une particulaire qui reste inerte (nommée virion) et qui doit pouvoir entrer dans des cellules spécifiques d’un organisme hôte particulier », explique Jean-Michel Claverie, professeur à l’université d’Aix-Marseille et auteur principal des travaux en question. Les chercheurs se sont uniquement intéressés aux virus infectant des amibes notamment une espèce facile à cultiver :
« On met les échantillons prélevés en contact avec les protozoaires et on regarde ce qui se passe. Si des virus sont présents, et qu’ils sont spécifiques à cet hôte, ils vont entrer dans les cellules et se multiplier. Ce qui prouve qu’ils sont encore infectieux et "vivants". »
Lisez la suite et soutenez un média indépendant sans publicité
S’abonnerAccès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous


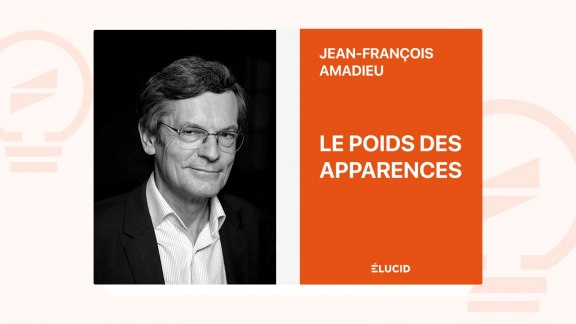
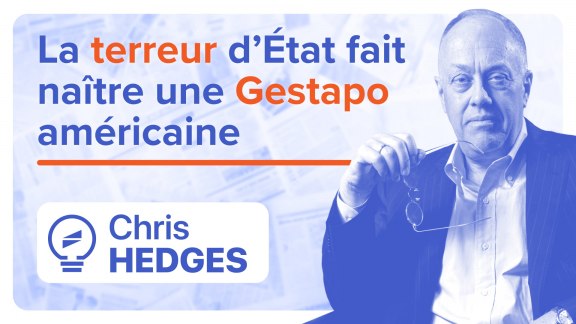




1 commentaire
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.
S'abonner