Les interrogations autour de la guerre et de ses causes constituent un thème traditionnel de la science politique. Dans son essai La Fabrication de l’ennemi (2011), Pierre Conesa, spécialiste des questions géopolitiques, nous invite à envisager la question sous un autre angle, afin d’échapper à un éventuel aveuglement idéologique.

Podcast La synthèse audio
Les démocraties doivent, avant d’entrer en guerre, obtenir l’assentiment de l’opinion publique. À cette fin, elles mobilisent divers marqueurs d’opinion pour stigmatiser les nations désignées comme ennemies. L’auteur s’efforce de dévoiler ce processus de fabrication de l’ennemi et, en prenant de multiples exemples, nous offre ainsi une meilleure vision du dessous des cartes de la géopolitique récente.
Ce qu’il faut retenir :
La construction de l’ennemi est le produit d’un processus sociologique utile pour une nation, car il lui permet de se souder, d’asseoir sa puissance et d’occuper son complexe militaro-industriel. Les États fabriquent sciemment leurs ennemis, quelle que soit leur nature (rival planétaire, ennemi proche, etc.), à l’aide de différents marqueurs d’opinion (intellectuels, services de renseignements, etc.).
Si l’ennemi est une construction, il est possible de le vaincre par un processus inverse : la déconstruction. Plus concrètement, il est important de faire preuve d’empathie vis-à-vis de notre ennemi. La réflexion stratégique moderne ne peut se faire qu’en prenant en considération les perceptions réciproques.
Biographie de l’auteur
Pierre Conesa (1948-) est un essayiste et un haut fonctionnaire français. Agrégé d’histoire, il enseigne la matière à l’université avant d’intégrer l’ENA, puis devient administrateur civil au ministère la Défense (Délégation aux études générales et Direction des affaires stratégiques). Il rejoint ensuite une société privée d’intelligence économique en tant que directeur général.
Lisez la suite et soutenez un média indépendant sans publicité
S’abonnerAccès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous

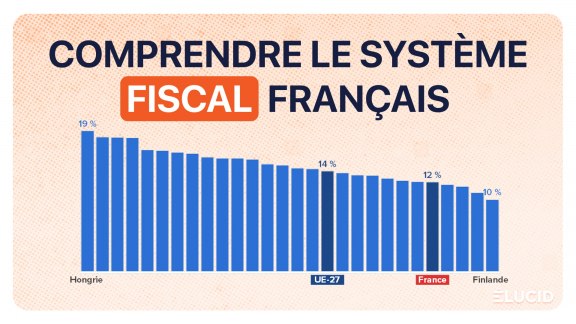





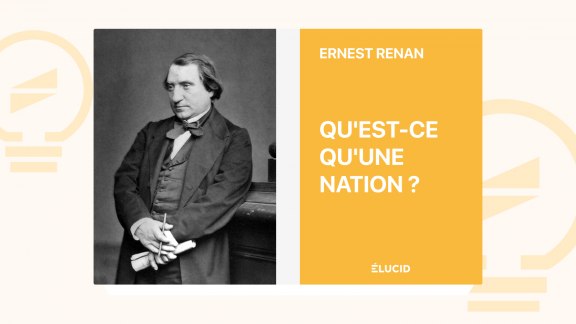
1 commentaire
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.
S'abonner