Les élections européennes n’ont jamais suscité l’enthousiasme des foules. Cela tient davantage à leur nature particulière qu’à une condamnable indifférence civique. Elles constituent cependant une photographie du rapport des partis politiques à l’Union européenne, qui en dit long sur le retournement idéologique en cours.

Les élections au parlement européen, au suffrage universel depuis 1979, sont d’une nature spécifique, qui les distinguent de toutes les autres. Les citoyens français sont en effet appelés à y désigner, sur une base nationale, leurs représentants dans un hémicycle présenté comme le cœur vivant de la démocratie européenne.
Il y a dans cette manière de voir quelque chose de spécieux, tout à fait caractéristique du projet européiste dans sa dimension rampante. Son objectif final – la dépossession démocratique des peuples au profit d’une oligarchie illégitime – n’étant pas ouvertement assumable, il n’a pu progresser au fil des décennies qu’en semant la confusion et en s’appropriant indûment des qualités propres à assurer son succès.
Une élection à nulle autre pareille
Le parlement européen constitue l’exemple achevé de ces supercheries conceptuelles et idéologiques. Il est censé concrètement accélérer la naissance d’un peuple européen voué à s’affirmer chaque année un peu plus, dans le cadre d’un transfert d’allégeance civique des nations vers « l’Europe ». Cette ambition est tout à fait inepte dans une perspective historique : les 80 ans écoulés depuis le commencement de la construction européenne n’ont pas permis d’avancer d’un pas dans cette direction, pas davantage que le changement de nom de « l’assemblée parlementaire européenne » – devenue parlement en 1962 – ou son élection au suffrage universel.
Hier comme aujourd’hui, les parlementaires européens sont placés dans une situation confuse : d’un côté, élus sur une base nationale, ils jouissent d’une légitimité dont ne disposent pas les technocrates de la Commission ; regroupés au sein de partis transnationaux, dépositaires de l’intérêt supérieur de « l’Europe », ils sont d’un autre côté les représentants d’un peuple qui n’existe pas. Difficile dans ces conditions de conférer à cette institution des pouvoirs substantiels. Si ces derniers se sont élargis au cours des deux dernières décennies, ce n’est aujourd’hui encore que par abus de langage que cette institution est nommée « parlement ».
Lisez la suite et soutenez un média indépendant sans publicité
S’abonnerAccès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous


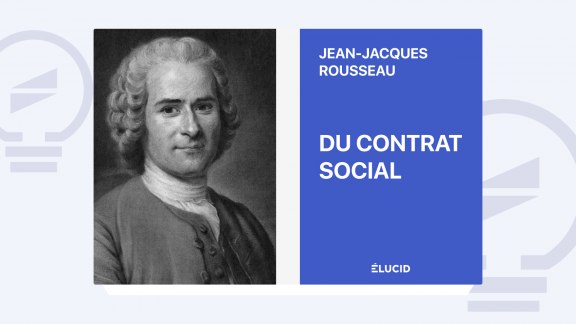

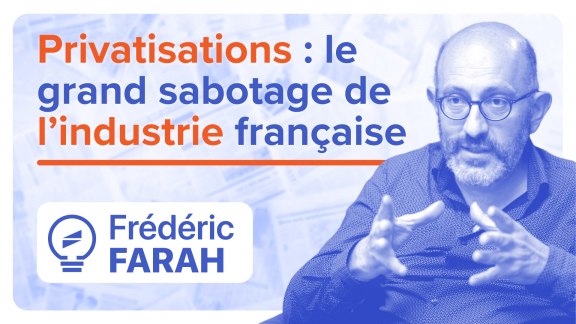



4 commentaires
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.
S'abonner