Fin 2021, nous vous proposions un article d'analyse sur le vocabulaire de l'impuissance politique. Celui-ci propose la même exploration lexicale dans le champ spécifique des relations internationales où, plus qu’ailleurs, l’enfer est pavé de bonnes intentions. Il cherche à montrer combien et pourquoi la France s’enferme à l'intérieur d'alliances fantasmées au détriment de ses intérêts stratégiques. Un second article interrogera ensuite, toujours à travers le prisme du langage, la manière dont les Occidentaux ont remplacé le concept d’ennemi par la notion d'agresseur, à travers une vision policière des relations internationales.

Les États, dit-on, sont des monstres froids les uns par rapport aux autres. Ils se soucieraient uniquement de défendre leurs intérêts nationaux. Si les circonstances l’exigent, ils iraient même pour ce faire jusqu’à pactiser avec le diable.
À rebours de ce réalisme teinté de machiavélisme, le vocabulaire géopolitique des représentants du peuple français se caractérise pourtant d’abord par sa sentimentalité et son moralisme. Il s’est reconfiguré autour des pôles de l’amitié et de la peur, de la solidarité et de l’ostracisme, de l’amour et de la haine.
La famille occidentale
Les discours prononcés par Nicolas Sarkozy, à l’occasion du retour dans le commandement intégré de l’OTAN, contenaient des mots qui en disaient déjà très long sur la représentation du monde et de soi des élites françaises. Le président avait alors évoqué la réintégration de la nation au sein de la « la famille occidentale », une expression rare, mais aux déclinaisons fréquentes dans la sphère médiatico-politique.
La métaphore de la famille était celle utilisée au XIXe siècle par Ernest Renan dans sa célèbre conférence sur la nation. En effet, famille et nation sont toutes deux des communautés « pour la vie et pour la mort » fondées sur une même origine, la conscience d’une identité commune, le partage de mœurs, d’une même approche « du juste, du vrai, du beau » et d’une volonté de demeurer ensemble. La solidarité y transcende le calcul des intérêts, les membres de la famille venant en aide aux plus en difficultés, comme les régions les plus riches subventionnent indirectement les plus pauvres pour compenser les divergences économiques induites au sein d’une nation.
Lisez la suite et soutenez un média indépendant sans publicité
S’abonnerAccès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous






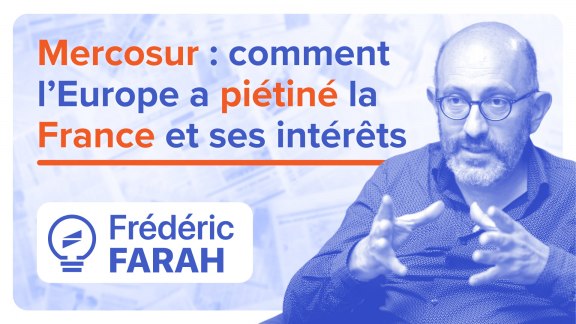

1 commentaire
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.
S'abonner