Article élu d'intérêt général
Les lecteurs d’Élucid ont voté pour rendre cet article gratuit.
Cet automne, à trois reprises, des élections tenues dans des États de l’est de l’Europe ont créé la surprise, du fait du score élevé de candidats qualifiés de pro-russes. En Moldavie, en Géorgie, puis en Roumanie, les résultats inattendus de ces scrutins se sont soldés par un concert d’accusations d’ingérence russe, relayées par certains partis politiques et par les pays occidentaux. Que faut-il en penser ?



Abonnement Élucid
Qu’on se le dise : le front uni contre la Russie dans l’est de l’Europe n’est pas en train de se lézarder. Dans les scores élevés des candidats pro-russes aux élections récemment organisées en Moldavie, en Géorgie et en Roumanie, qui ont provoqué stupéfaction et panique en Occident, il ne faudrait en aucun cas voir l’expression de la volonté des peuples de ces pays. Non, ces incidents seraient à attribuer au Kremlin, et à son insidieuse et toute-puissante ingérence. Ils seraient à attribuer à la fraude électorale causée par ses agents, tapis dans l’ombre, prêts à tout pour détruire la démocratie.
De fait, c’est bien possible. Pourquoi pas ? Il serait bien naïf de penser que la Russie n’a pas d’intérêt à déstabiliser l’Europe. Bien que les dirigeants européens s’en défendent encore parfois, il est évident que dans le contexte du conflit en Ukraine et ses répercussions, ils perçoivent désormais ouvertement la Russie comme l’ennemi ; et il serait pour le moins impoli de la part de la Russie de ne pas leur rendre la pareille. Cyberattaques, espionnage, influence dans les élections : la Russie peut faire tout cela. Pourquoi s’en priverait-elle ?
Mais cette situation pose un problème, car les scores obtenus par les candidats anti-européens aux élections moldaves, géorgiennes et roumaines ne représentent pas seulement un indicateur de l’étendue de l’influence russe. La fraude électorale ne peut pas tout ; ces candidats existent bel et bien, et des citoyens européens ont bel et bien voté pour eux. Jusqu’à quel point ce vote est-il le leur ?
Le risque, pour l’Europe, est de se focaliser sur un arbre qui cache la forêt. Mettre sur le dos de la fraude russe tous les résultats électoraux qui s’opposent au camp pro-occidental expose l’Europe à s’aveugler quant à la popularité réelle du camp anti-occidental au sein de sa propre population. Si fraude il y a, il convient d’élucider avec clarté où, sous quelles formes, et à quel point ; faute de quoi, s’indigner de façon répétée devant le résultat de votes moins favorables que prévus risque fort d’agacer encore davantage l’électorat, et d’accroître le phénomène, sans que la Russie n’ait à lever le petit doigt...
Allégations de fraude électorale : vrai ou faux ?
La rhétorique relative à la « guerre hybride » et à « l’ingérence russe » concernant ces trois scrutins est omniprésente dans les médias et les chancelleries occidentales. Et comme souvent, dès qu’il est question d’une implication de la Russie, la question de la preuve de ces allégations semble avoir perdu toute importance. Or, dans un contexte où la confiance du public envers les médias et les institutions est déjà fortement érodée, il convient de faire l’effort d’apporter des éléments de preuve. Dans le cas des récentes élections en Moldavie, en Géorgie et en Roumanie, une aubaine se présente : les élections tenues dans ces États sont traditionnellement suivies par des observateurs de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, ou OSCE.
L’OSCE constitue l’une des rares organisations réunissant toujours la totalité des pays européens, Russie comprise, en compagnie des États-Unis, du Canada, de la Turquie, de la Mongolie et des États du Caucase et d’Asie Centrale. Ses observateurs, provenant de tous ses États membres, émettent régulièrement des rapports sur les élections qui s’y tiennent, au travers du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme. Désormais rarement mentionnés en Occident, ces rapports constituent l’un des rares outils d’évaluation d’un processus électoral dont la neutralité politique demeure absolument certaine, et n’est remise en question par personne.
En Moldavie, au premier comme au second tour de l’élection présidentielle, l’élection s’est déroulée dans le calme et sans incident majeur. Durant la campagne, les observateurs de l’OSCE ont toutefois constaté une forte tendance des médias, notamment des chaînes de télévision, à dépeindre les candidats de manière partiale, avec un favoritisme net en faveur de la présidente, Maia Sandu, par rapport à son adversaire, Alexandr Stoianoglo. La rhétorique médiatique, très majoritairement pro-européenne, s’est ainsi avérée suffisamment biaisée pour que le rapport de l’OSCE mentionne qu’elle risquait de compromettre l’équité du scrutin. Plus grave, les observateurs rapportent également un biais pro-gouvernemental semblable au sein de la Commission électorale centrale, l’organisme ayant orchestré le scrutin.
Concernant les allégations d’ingérence russe pesant sur l’élection et le référendum, les observateurs de l’OSCE ont bien relevé des éléments « crédibles » alléguant de tentatives d’achat de votes, au premier tour comme au second, notamment en faveur du « non » au référendum sur l’adhésion à l’Union européenne. Le rapport relève un total de 350 occurrences d’achats de vote répertoriées par la police moldave au second tour de l’élection présidentielle, bien qu’il précise en parallèle que la méthodologie de la police moldave pour qualifier l’infraction paraissait douteuse.
Ainsi, en ce qui concerne le scrutin en Moldavie, s’il y a bien eu des dysfonctionnements du processus électoral, ceux-ci sont à imputer à la fois au camp pro-européen et au camp anti-UE. Les accusations d’achats de vote par le camp anti-UE sont d’autant plus graves qu’elles ont été vérifiées par des observateurs indépendants. Toutefois, le biais médiatique et institutionnel en faveur du camp pro-européen constitue également un sérieux problème, même s’il n’est évidemment guère surprenant que nul média occidental ne s’en soit fait l’écho.
Pour ce qui est des élections législatives en Géorgie, la situation est plus nébuleuse. Si le rapport de l’OSCE conclut là encore que le scrutin s’est déroulé normalement dans l’ensemble, il observe toutefois un nombre notable d’irrégularités. Ce cas de figure n’est pas inhabituel dans le cas de la Géorgie ; l’OSCE avait émis une opinion similaire aux précédentes législatives de 2020 et 2016. Notamment, si le rapport ne relève pas de favoritisme rhétorique en faveur du parti au pouvoir, Rêve Géorgien, celui-ci a tout de même fait l’objet d’une couverture médiatique disproportionnée.
Toutefois, la majeure partie des incidents allégués par les observateurs de l’OSCE sont relatifs à l’atmosphère très tendue dans laquelle s’est déroulé le scrutin, marqué par plusieurs échauffourées entre partisans et opposants à Rêve Géorgien. Les observateurs rapportent néanmoins une « évaluation négative » du processus électoral le jour de l’élection – signifiant que les standards de l’OSCE n’ont pas été atteints – dans 6 % des bureaux de vote observés, ce que l’OSCE considère comme « significatif ». Le rapport mentionne également, mais sans entrer dans les détails, quelques suspicions d’achats de votes, ainsi qu’une unique occurrence observée de bourrage d’urnes ayant résulté en l’annulation des résultats du bureau de vote concerné.
Ainsi, si le processus électoral ne s’est de toute évidence pas déroulé de façon idéale, ce qui reste courant en Géorgie, le portrait qui en est dressé par le rapport de l’OSCE demeure assez éloigné des accusations de fraude massive émises par la présidente Salomé Zourabichvili et l’opposition et relayées en Occident. S’il n’est pas possible d’exclure une possible ingérence russe, il est toutefois difficile d’imaginer qu’une fraude électorale de l’ampleur alléguée par les opposants à Rêve Géorgien ait pu passer totalement inaperçue aux yeux des observateurs de l’OSCE, lesquels ont visité près de 2 000 bureaux de vote, sur les quelques 3 000 que comptaient le pays.
Enfin, concernant la Roumanie, le rapport préliminaire de l’OSCE n’est malheureusement pas encore disponible à l’heure où nous écrivons ces lignes. Les sources actuellement accessibles concernant le premier tour de l’élection présidentielle ne disposent donc pas du même degré de neutralité. À vrai dire, les accusations d’interférence russe dans l’élection semblent toutes avoir la même origine : les déclarations du gouvernement roumain, sur la base de « documents » des services secrets, déclassifiés le 4 décembre dernier.
Ces documents détaillent les suspicions des services secrets roumains relatives au candidat arrivé en tête du premier tour, Calin Georgescu. La popularité de ce dernier sur le réseau social Tiktok au cours des dernières semaines de la campagne électorale a été décrite comme hors normes, ce qui a démultiplié sa visibilité en dépit d’une campagne officiellement très modeste, n’ayant pas déclaré de dépenses. Un entrepreneur roumain, Bogdan Peschir, a également été identifié comme ayant rémunéré quelques influenceurs roumains, à la hauteur de quelques centaines de milliers d’euros, pour faire la promotion du candidat. Les services secrets roumains considèrent une intervention russe ayant favorisé le candidat sur Tiktok comme étant probable.
Le gouvernement roumain, farouchement pro-européen et venant de voir son candidat, le Premier ministre Marcel Ciolacu, être sèchement éliminé au premier tour, ne peut évidemment pas être considéré comme une source neutre. Néanmoins, ses informations étant les seules disponibles, il convient de les prendre en considération, car c’est subséquemment sur leur base que les institutions roumaines se sont fondées pour prendre une décision sans précédent : l’annulation pure et simple du scrutin.
La réaction pro-européenne : faire feu de tout bois
Cette décision de la Cour constitutionnelle roumaine, prise quatre jours après la validation du scrutin par cette même Cour, a pris tout le monde de court. Même les juristes occidentaux s’accordent à dire qu’une telle annulation de l’élection constitue une mesure sans précédent. Il n’est d’ailleurs pas certain que la Cour dispose bel et bien du pouvoir de la prononcer ; du moins, il s’agirait là d’une interprétation très extensive de son champ d’action.
La Cour semble d’ailleurs être consciente de la faillibilité de son raisonnement d’un point de vue juridique. Plutôt que le droit, elle semble mobiliser des considérations morales et politiques pour expliquer sa décision, invoquant notamment sa responsabilité de défendre la démocratie. Elle reprend en cela la rhétorique du gouvernement roumain, ce qui n’est guère surprenant : la Cour est proche du pouvoir, ses membres étant nommés pour un tiers par le Président, pour un tiers par le Sénat, et pour un tiers par la Chambre des députés. Son membre actuel ayant le plus d’ancienneté a été nommé en 2016. Or, le président roumain, Klaus Iohannis, est en poste depuis 2014 ; et les deux partis actuellement en coalition au gouvernement, au Sénat et à la Chambre détiennent la majorité dans ces deux enceintes depuis 2016.
Si les faits allégués par le gouvernement roumain sont vérifiés, il ne fait effectivement guère de doute qu’il y aurait eu fraude électorale de la part de Calin Georgescu. Néanmoins, la réaction normale, dans un tel cas, consiste à ouvrir une enquête en vue d’éventuelles poursuites ; c’est d’ailleurs ce qu’a fait le parquet roumain, perquisitionnant plusieurs locaux liés au candidat. La réaction normale ne consiste pas à annuler purement et simplement le scrutin. Une telle décision constitue pour ainsi dire du jamais-vu en Europe, et le fait qu’elle ait été prise deux jours avant le second tour, sur la base d’informations rendues publiques dans l’entre-deux-tours, et surtout après l’élimination du candidat du parti au pouvoir, la rend extrêmement discutable, voire suspecte.
En effet, que se serait-il passé si Calin Georgescu n’était arrivé qu’en seconde position, voire s’il ne s’était même pas qualifié pour le second tour ? L’ampleur des faits allégués serait restée exactement la même, seules leurs conséquences auraient changé. Dans un tel cas de figure, s’il n’y avait pas eu de menace sérieuse d’arrivée au pouvoir de Calin Georgescu, le gouvernement roumain aurait-il rendu publics les documents déclassifiés le 4 décembre ? La Cour constitutionnelle aurait-elle pris la décision d’annuler le scrutin ? Il est permis de supposer que non, au vu même de l’argumentaire des deux entités, qui se retranchent derrière le bouclier inattaquable que constitue la défense de la démocratie.
Autrement dit, le problème du gouvernement roumain et de la Cour constitutionnelle roumaine n’est pas l’éventuelle ingérence russe dans la campagne présidentielle en tant que telle ; leur problème est qu’une telle ingérence ait fonctionné. L’ingérence en elle-même, aussi inacceptable soit-elle si elle en vient un jour à être démontrée, ne constituait pas le véritable problème aux yeux du pouvoir : le problème était l’arrivée potentielle d’un candidat potentiellement pro-russe aux rênes de la Roumanie. Toute justification était de toute évidence la bienvenue pour éviter une telle issue. Rappelons que le président roumain, Klaus Iohannis, s’est porté candidat il y a seulement quelques mois au Secrétariat général de l’OTAN. L’orientation stratégique de la Roumanie aux côtés de l’Occident constitue un enjeu crucial pour le gouvernement roumain.
Le problème est exactement le même en Moldavie. L’Occident ne s’est ému d’aucune des irrégularités pointées du doigt par l’OSCE et qui favorisaient le camp pro-européen : le biais médiatique, le biais institutionnel, le traitement déséquilibré en faveur d’un candidat durant la campagne. Sans les rapports de l’OSCE, ces irrégularités seraient même passées totalement inaperçues. Pourtant, le déséquilibre en faveur d’un candidat au cours de la campagne est précisément ce que la Roumanie et l’Europe reprochent à l’utilisation de Tiktok en faveur de Calin Georgescu ! Non, les seules irrégularités pertinentes, inacceptables, dignes d’indignation, sont celles ayant favorisé les opposants au camp pro-européen, au premier rang desquels Alexandr Stoianoglu.
Quant à la Géorgie, les rôles sont inversés : c’est précisément le parti au pouvoir, dont l’orientation anti-européenne est progressivement devenue plus évidente, qui l’a emporté. L’opposition, soutenue par la présidente géorgienne Salomé Zourabichvili et par un Occident désormais conscient que l’orientation stratégique de la Géorgie se joue sur le résultat de ce scrutin, a alors cherché à provoquer l’annulation de l’élection sur la base de soupçons de fraude, souhaitant un scénario semblable à celui qui s’est déroulé en Roumanie quelques semaines plus tard. Mais la Cour constitutionnelle géorgienne a refusé d’accéder à leurs exigences.
De ce fait, la situation en Géorgie est nettement plus tendue, d’autant plus que le Rêve Géorgien semble bel et bien avoir bénéficié de certaines irrégularités durant la campagne et le jour de l’élection, même si à en croire l’OSCE, celles-ci sont insusceptibles d’avoir influencé de façon significative le résultat du scrutin. Ainsi, l’absence de preuves tangibles attestant d’une fraude véritablement massive ou d’une ingérence extérieure reste patente : l’OSCE n’a rien constaté de tel, et la présidente géorgienne, pourtant convoquée par le bureau du procureur d’État pour étayer ses accusations, a refusé de répondre à cette demande. Cela n’empêche pas la rhétorique d’une élection volée par la Russie d’être constamment relayée, sans remise en question, partout en Occident...
Ignorons la démocratie pour mieux la sauver
Face aux tentatives de Rêve Géorgien de passer outre et de normaliser la situation, la présidente géorgienne en exercice durant les élections législatives contestées, Salomé Zourabichvili, a annoncé à la surprise générale qu’elle refuserait de quitter le pouvoir tant que de nouvelles élections législatives ne seraient pas organisées, provoquant une crise institutionnelle. Le 14 décembre 2024, lors d’un scrutin boycotté par l’opposition, le nouveau président géorgien, Mikhaïl Kavelachvili, a été élu au suffrage indirect par le collège électoral. Si Salomé Zourabichvili exclut toujours de quitter son poste lorsque son mandat prendra fin, le 29 décembre, l’impasse politique en Géorgie deviendra bientôt encore plus inextricable.
Lorsqu’on prend soin de rappeler que Salomé Zourabichvili n’a obtenu la nationalité géorgienne qu’en 2003, à plus de cinquante ans, et qu’elle a auparavant fait toute sa carrière au Quai d’Orsay, servant les intérêts de la France, la situation s’éclaire quelque peu. De toute évidence, devant l’impossibilité de forcer l’organisation de nouvelles élections législatives, l’objectif de l’opposition, dont la présidente s’érige en figure centrale, est maintenant de parvenir à ses fins en dehors de la voie constitutionnelle en renversant le gouvernement. Le mouvement de protestation dans les grandes villes géorgiennes, largement acquises aux partis d’opposition, est à cet égard un adjuvant puissant, tout comme la rhétorique occidentale unanime dénonçant une élection volée. Une telle issue n’a rien d’improbable ; il conviendra de suivre avec attention l’évolution de la situation, notamment si Salomé Zourabichvili refuse de baisser pavillon.
Et tout cela s’effectue au nom du noble principe qu’est la défense de la démocratie. Peu importe que, dans une démonstration de la plus totale absurdité, la défense de la démocratie implique le maintien d’un président à son poste au-delà de son mandat en l’attente d’un renversement du gouvernement, comme en Géorgie, ou encore l’annulation pure et simple des élections quand les résultats ne sont pas les bons, comme en Roumanie.
L’existence de fraudes et d’ingérences lors de ces élections n’est certes pas contestable, même si elles ne semblent pas du tout avoir été aussi omniprésentes ou déterminantes que ne le proclame le discours occidental. Mais la fraude électorale est du ressort du système judiciaire ; et l’ingérence, du ressort de la diplomatie. La réaction habituelle, raisonnable, face à ces deux problèmes, ne consiste pas à piétiner la constitutionnalité.
Bien sûr, on pourra répondre « mais ils sont pro-russes ! » C’est vrai. Et le pro-russe, en Europe, aujourd’hui, c’est le presque-ennemi, le presque-traître, le presque-fou. Le pro-russe est disqualifié d’avance, il n’y a même pas besoin de l’écouter, de le prendre en compte. Et si le peuple vote pour lui, c’est que le peuple a tort, qu’il a été dupé, et qu’il faut l’ignorer. Pourquoi se fatiguer à expliquer pourquoi la Russie est l’ennemi à ceux qui pourraient être tentés de soutenir des pro-russes ?
Il y a indéniablement un arrière-goût de mépris de classe, dans cette logique. C’est particulièrement visible dans le cas de la Roumanie. La surexposition de Calin Georgescu sur Tiktok est désignée comme l’unique responsable de sa victoire au premier tour ; comme si les Roumains qui lui ont donné leurs votes n’étaient tous que des simples d’esprit qui votent pour le visage qu’ils connaissent le plus. Non pas que l’Occident ait le moindre problème avec cette idée, à en voir les commentaires de l’OSCE concernant la partialité des médias et des institutions durant les élections en Moldavie ; seulement, en Roumanie ce n’était pas le bon visage, voyez-vous.
Serait-il si difficile de faire preuve d’honnêteté ? Si on ne souhaite pas que des pro-russes arrivent au pouvoir en Europe, disons-le clairement. Après tout, ce n’est pas un message inaudible, au vu des circonstances internationales ; mais assumons-le, et expliquons-le. Sinon, autant restaurer le suffrage censitaire ; là, au moins, protégée du vote du peuple, la démocratie sera sauvée.
Peut-être qu’agir comme le fait actuellement l’Europe face aux pro-russes qui risquent d’arriver au pouvoir protège les citoyens européens d’un danger qui leur échappe. Peut-être. Mais ce qui est certain, c’est que s’enorgueillir de protéger la démocratie lorsqu’on piétine le vote du peuple, même pour les meilleures raisons du monde, ne pourra jamais être perçu positivement par ceux dont les voix sont ainsi réduites au silence. En Occident, la confiance des peuples envers les institutions est déjà à l’agonie. En faisant preuve d’une telle hypocrisie, on risque fort de finir par lui porter l’estocade.
Photo d'ouverture : Bureaux de vote pour les élections présidentielles, le 24 novembre 2024, Cluj-Napoca, Roumanie - Bogdan Totoran - @Shutterstock
Cet article est gratuit grâce aux contributions des abonnés !
Pour nous soutenir et avoir accès à tous les contenus, c'est par ici :
S’abonner
Accès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous






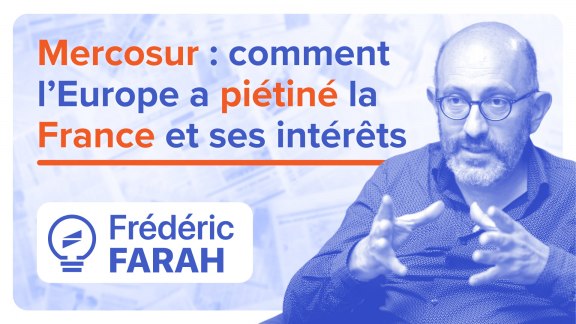

13 commentaires
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.
S'abonner