La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a maintenu un cap résolument libéral lors de son discours sur l'état de l'Union européenne 2025, marqué par la promotion du libre-échange (accords comme Mercosur) et l'obsession du marché unique. Elle défend notamment l'élargissement de l'UE aux Balkans et à l'Ukraine malgré les risques de dumping social, tout en esquissant de nouvelles ambitions pour la défense européenne. L'ensemble de ces annonces illustre une fuite en avant de Bruxelles qui renforce toujours plus les pouvoirs de la Commission européenne au détriment des souverainetés nationales.



Abonnement Élucid
Ursula von der Leyen a récemment prononcé son discours sur l’état de l’Union 2025 au Parlement européen de Strasbourg, en tant que présidente de la Commission européenne. Ce rendez-vous annuel, instauré par le traité de Lisbonne sur le modèle américain, vise à dresser un bilan de l’année écoulée et à annoncer les priorités de la Commission pour les mois à venir. Le discours est suivi d’un débat – jugé assez vain – où chaque chef de groupe politique interpelle successivement Ursula von der Leyen. Ce rituel a lieu chaque année depuis 2010.
Le premier réflexe face à cette parodie d’imitation des institutions américaines serait sans doute la moquerie. Fake it until you make it (« fais semblant jusqu’à ce que tu réussisses ») semble être la devise des institutions européennes se rêvant en « États-Unis d’Europe ». Ce serait risible, si tout ce cirque n’avait pas d’impact bien réel sur notre vie économique et démocratique.
Pourtant, il faut prendre ce discours au sérieux, car il contient plusieurs annonces importantes. Les thèmes qu’il aborde – défense, compétitivité, politique étrangère, médias, agriculture, etc. – montrent l’étendue des pouvoirs de la Commission européenne, et dans chacun de ces domaines les mesures annoncées sont loin d’être cosmétiques.
Bien sûr, il serait impossible de commenter ici en détail la trentaine d’annonces faites par Ursula von der Leyen. Plusieurs portent sur la situation internationale (la guerre à Gaza, l’Ukraine), sur la transition climatique ou sur un soutien très modéré à l’industrie sidérurgique, automobile et agricole. Nous nous concentrerons donc sur quelques points saillants : les volets commerciaux, le marché unique, la « protection de la démocratie », ainsi que les sujets de défense et d’élargissement.

On peut d’ores et déjà identifier un fil rouge à travers toutes ces annonces : elles conduisent toutes à renforcer les prérogatives de la Commission européenne et le poids du droit de l’Union dans notre ordre juridique national, réduisant comme peau de chagrin le nombre de domaines qui y échappent encore.
Le libre-échange, toujours le libre-échange
La première chose à retenir de ce discours, c’est que le cap du libre-échange est pleinement confirmé et demeure l’horizon indépassable de la politique commerciale de l’UE. On ne change pas une équipe qui perd. Les multinationales doivent, au nom de la compétitivité et à tout prix, pouvoir garder leurs chaînes d’approvisionnement internationalisées. Ainsi, selon Ursula von der Leyen :
« Nous devons redoubler d’efforts en matière de diversification et de partenariats […]. Alors que le système commercial mondial menace de s’effondrer, nous assurons les règles mondiales au moyen d’accords bilatéraux – comme avec le Mexique ou le Mercosur – […] afin de réformer le système commercial mondial, à l’instar du PTPGP. Car le commerce nous permet de renforcer nos chaînes d'approvisionnement, d'ouvrir des marchés, de réduire les dépendances. En fin de compte, il s'agit de renforcer notre sécurité économique. »
Tout est dit : elle invoque la « sécurité économique » plutôt que l’autonomie ou la souveraineté économique – la nuance est immense. Plutôt que de produire localement (l’approche la plus résiliente pour l’emploi et la croissance en Europe), il s’agit de trouver de nouveaux partenaires d’importation. Plus loin dans son discours, Ursula von der Leyen a également tenu à préciser :
« Mesdames et Messieurs les députés, je ne suis pas partisane des droits de douane. Les droits de douane sont des taxes. […] Pensez aux répercussions d'une guerre commerciale totale avec les États-Unis. Imaginez le chaos. […] L'Europe restera toujours ouverte. Nous aimons la concurrence. »
Le protectionnisme reste donc un tabou absolu à Bruxelles. Hors de question d’introduire la moindre réciprocité envers ceux qui taxent nos produits : l’Europe doit rester ouverte et éviter à tout prix la « guerre économique ». Pourtant, nous unir pour être plus forts face aux autres blocs – en d’autres termes, faire l’Union pour peser dans la guerre économique – était la promesse faite aux Français lors de Maastricht. Or, toute l’histoire de l’Union européenne ressemble plutôt à un désarmement unilatéral dans cette guerre économique, l’accord récent avec les États-Unis en étant une énième preuve.
La doctrine commerciale – véritable ADN de l’UE – demeure invariablement le libre-échange, envers et contre tout. Tant pis pour le secteur automobile, tant pis pour les agriculteurs, tant pis pour la sidérurgie, qui tous n’auront droit qu’à quelques protections cosmétiques en guise de consolation. Pour l’acier, la Commission annonce « un nouvel instrument commercial à long terme » afin de prolonger les mesures de sauvegarde arrivant à expiration ; pour l’agriculture, elle promet « d’examiner la mise en œuvre » de la législation contre les pratiques commerciales déloyales. Autant dire des mesurettes. Ursula von der Leyen confirme d’ailleurs au passage la finalisation prochaine de l’accord Mercosur, ainsi que de deux autres traités avec le Mexique et l’Inde (sans compter celui déjà conclu avec l’Indonésie). Manifestement, aucune leçon n’a été tirée en matière de résilience depuis la crise du Covid.
Comment expliquer une telle fuite en avant ? L’économie allemande est en voie d’effondrement et a besoin de nouveaux débouchés pour écouler ses voitures, quitte à sacrifier d’autres secteurs. Ces derniers serviront de variable d’ajustement au profit de l’industrie automobile d’outre-Rhin et, plus largement, des multinationales qui sont les vraies gagnantes de ces accords. La course à la compression des coûts peut encore durer un moment, tant qu’il restera des accords de libre-échange à conclure à travers le monde et tant que l’emploi européen continuera d’être traité comme négligeable. L’Europe n’est pas naïve au point de ne faire que des perdants : simplement, les gagnants ne sont pas les peuples à qui l’on avait vendu une « Europe qui protège ».
En revanche, une nouveauté ressort des annonces de Mme von der Leyen concernant la politique commerciale : la volonté affichée de reproduire le modèle du PTPGP (Partenariat transpacifique global et progressiste). Le PTPGP est un méga-accord de libre-échange entre une dizaine de pays du Pacifique (et du Canada), comprenant des engagements d’accès aux marchés sur le commerce des marchandises et des services, sur l’investissement, la mobilité de la main-d’œuvre et les marchés publics – bref, un abaissement généralisé des barrières douanières et réglementaires. On devine que la Commission européenne veut ainsi pallier la paralysie de l’OMC en relançant la négociation d’accords commerciaux multilatéraux via ce type de coalition.

Depuis 2010, Bruxelles a déjà conclu plusieurs accords dits de « nouvelle génération », c’est-à-dire des traités qui ne se limitent pas à éliminer les droits de douane, mais harmonisent aussi certaines normes (sociales, environnementales…). Jusqu’à présent, ces accords ont toujours été négociés sur une base bilatérale (par exemple le CETA avec le Canada). Désormais, il s’agit de passer à la vitesse supérieure et de négocier de véritables méga-accords multilatéraux de nouvelle génération. Comme le CETA, de tels accords ne manqueront pas de poser problème vis-à-vis de nos préférences collectives, puisqu’ils nous contraignent à reconnaître des normes que nous avions choisi de rejeter (par exemple le bœuf aux hormones). Sans surprise, c’est aussi la question de la concurrence déloyale et de l’impact environnemental de ces accords qui finira par être soulevée.
Tout sacrifier au nom du marché unique
Nous avions déjà décrit l’obsession de la Commission européenne pour l’achèvement du marché unique, qui sert de prétexte à la destruction de toutes les protections nationales en matière de droit du travail, de santé ou d’environnement (voir notre article « Le marché unique : une success-story européenne de destruction du progrès social »). Cet objectif – moins souvent critiqué dans le débat public – est plus que jamais central dans la stratégie de Bruxelles, qui entend fournir aux multinationales de nouveaux outils pour supprimer ou limiter les normes nationales perçues comme des entraves au commerce intra-européen.
La rengaine est connue : les différences de réglementation entre États membres empêcheraient la libre circulation des biens et services au sein de l’Union. Ainsi, Ursula von der Leyen a rappelé que, selon le FMI, les barrières subsistant au sein du marché unique équivaudraient à des droits de douane de 45 % sur les marchandises et 110 % sur les services. Or, ces chiffres sont tirés d’un rapport du FMI (octobre 2024) qui s’appuie sur une étude de 2021 (1) concluant exactement l’inverse : les barrières non tarifaires entre pays européens sont équivalentes ou inférieures à celles existant entre États américains. Autrement dit, le marché intérieur européen est déjà plus intégré que le marché intérieur des États-Unis. Cette conclusion concorde d’ailleurs avec celle d’une autre étude parue la même année (2), que nous avions déjà citée.
À supposer même que les chiffres du FMI soient valides, la comparaison resterait douteuse : l’Union européenne n’est pas un pays unique, mais un ensemble de 27 nations ayant chacune leur histoire et leurs choix de société. La plus grande barrière au commerce intra-européen, c’est la langue (24 langues officielles !) – et toutes les harmonisations du monde n’y changeront rien. Pour Ursula von der Leyen :
« Le marché unique reste incomplet, en particulier dans trois domaines : la finance, l'énergie et les télécommunications. Nous devons nous fixer des délais politiques clairs. C'est pourquoi nous présenterons une feuille de route pour le marché unique à l'horizon 2028. Elle concernera les capitaux, les services, l'énergie, les télécommunications, le 28e régime et la cinquième liberté en matière de connaissance et d'innovation. »
Autrement dit, Bruxelles prévoit d’ici 2028 un programme global de libéralisation des services et des professions réglementées. Nous attendons donc cette « feuille de route » avec impatience… La grande question étant : quelles professions seront dans le viseur de la Commission ? Dans un article précédent sur les recommandations européennes, nous avions signalé que via le semestre européen, la Commission prévoyait déjà de libéraliser certains métiers – en ce qui concerne la France, elle ciblait notamment les agents immobiliers, les architectes et les comptables.
En matière de finance, il s’agit maintenant de réaliser « l’union de l’épargne et de l’investissement ». Concrètement, Bruxelles veut libéraliser la titrisation (le mécanisme à l’origine de la crise des subprimes) et faire sauter certains verrous de régulation financière. Cette dérégulation serait justifiée, selon la Commission, par un manque d’investissements en Europe dû à un excès de barrières : le marché unique financier serait, d’après elle, insuffisamment intégré.
Là encore, comme pour le marché unique en général, la véritable cause du manque d’investissement est passée sous silence. Ce grand absent, c’est dix années d’austérité qui ont brisé le dynamisme de l’économie européenne. C’est l’éléphant au milieu de la pièce, et ce n’est pas en dérégulant la finance qu’on changera ce constat de départ.
Sur les télécommunications, la tendance est tout aussi inquiétante. Il est question d’un projet de Digital Network Act (DNA), qui consisterait à assouplir le droit européen de la concurrence afin de permettre une consolidation du secteur des opérateurs télécoms en Europe. D’après le rapport Letta, il y aurait actuellement 27 opérateurs en Europe – bien trop, et il faudrait s’empresser de copier le modèle d’oligopole américain (4 opérateurs) où les tarifs mobiles et internet avoisinent les 70 € par mois (soit les prix qui existaient en France vers 2005).
En réalité, ce Digital Network Act n’est rien d’autre qu’une opération destinée à enrichir considérablement quelques géants européens des télécoms, au détriment du consommateur, en mettant en place un oligopole. Un oligopole, certes… mais un oligopole européen ! Du haut de son immense expertise, la Commission juge sans doute que les Européens croulent sous le pouvoir d’achat, et qu’il conviendrait de reverser une partie de cette manne aux pauvres opérateurs que sont Orange ou Telefónica.

Europe de la défense : encore plus de Commission
Nous avons déjà abondamment commenté les projets de la Commission européenne en matière de défense. Une annonce nouvelle a toutefois retenu l’attention : la création d’un semestre européen de la défense. Pour mémoire, le semestre européen est une procédure par laquelle la Commission et le Conseil de l’UE adressent chaque année aux États des recommandations de réformes, recommandations qui deviennent obligatoires si l’État est en situation de déficit excessif (c’est-à-dire s’il viole la règle des 3 % de déficit).
S’agissant de la défense, on sait que Bruxelles cherche à se poser en intermédiaire et coordinateur incontournable – une sorte de sous-OTAN bis. Avec le règlement EDIP (3), la Commission veut d’abord collecter des données sensibles (par exemple sur les stocks d’armes) pour pouvoir ensuite jouer un rôle de coordinateur. On sait aussi qu’elle ambitionne de devenir la centrale d’achat d’armements pour le compte des États membres.
Dans cette logique, la Commission pourrait s’appuyer sur le semestre européen existant pour recommander aux États les équipements militaires dont ils doivent se doter. Il ne serait pas surprenant que les matériels d’origine allemande soient particulièrement mis en avant dans ces futures « recommandations » – si toutefois ce projet voit le jour (cela reste à ce stade une spéculation). Une telle évolution concrétiserait en tout cas le scénario redouté par le Sénat français, à savoir une Commission européenne devenue coordinatrice et centrale d’achat en matière de défense. Il faudra attendre que les annonces se précisent pour juger sur pièces.
Sur un terrain connexe, Ursula von der Leyen propose également de passer à la majorité qualifiée en politique étrangère, supprimant ainsi le veto national. Dans un tel scénario, une diplomatie européenne belliciste majoritaire pourrait entraîner des États minoritaires dans des guerres qu’ils n’ont pas voulues. Ce risque est toutefois à relativiser fortement : de nombreux pays s’opposent à l’abandon de l’unanimité, et il faut… l’unanimité pour instaurer la majorité qualifiée en la matière. Autant dire que ce changement n’est pas pour demain – heureusement.
Le dumping social permanent
Enfin, la présidente de la Commission a confirmé que l’élargissement de l’UE aux Balkans et à l’Ukraine est bien une priorité :
« Une Union plus vaste et plus forte est une garantie de sécurité pour nous tous. Et parce que pour l'Ukraine, pour la Moldavie et pour les Balkans occidentaux, l'avenir est au sein de notre Union. Faisons de la prochaine réunification de l'Europe une réalité ! »
Il s’agit donc de poursuivre la fuite en avant actuelle et de reproduire (en pire) les erreurs de l’élargissement de 2004-2007 aux pays d’Europe de l’Est. En effet, les salaires dans ces pays candidats sont en moyenne quatre fois inférieurs aux nôtres. Une telle concurrence – un tel dumping social – ne laissera aucune chance aux travailleurs d’Europe de l’Ouest.
À l’heure de la démondialisation, l’Union entend recréer à l’échelle du continent une mini-mondialisation où les pays d’Europe de l’Ouest pourront délocaliser le peu d’industrie qui leur reste vers ce nouveau vivier d’emplois à bas coût. Nous assisterons même probablement à des relocalisations d’usines aujourd’hui implantées en Europe de l’Est (jugées bientôt « trop chères ») vers ces futurs nouveaux États membres.

Un discours qui porte bien son nom
Ce discours porte finalement bien son nom, car il dresse un tableau fidèle de « l’état de l’Union » – un mauvais état. On y retrouve toutes les obsessions de l’Union européenne : le libre-échangisme forcené, la préférence étrangère sur nos marchés, le dumping social, et un rôle toujours plus envahissant de la Commission européenne dans nos vies.
Une dernière anecdote illustre parfaitement le fonctionnement des institutions européennes tel que symbolisé par ce discours. À propos du chantier de l’intelligence artificielle, Ursula von der Leyen a fanfaronné pendant son allocution du 10 septembre 2025 : « Je vais d'ailleurs rencontrer tout à l'heure les PDG d'entreprises figurant parmi les plus grands champions technologiques européens ». Or, nous n’avons trouvé aucune trace d’une telle réunion dans son agenda officiel ni dans le registre de transparence. Deux options : soit cette réunion n’a pas eu lieu (et alors, pourquoi l’annoncer ?), soit elle n’a pas été déclarée – ce qui est strictement interdit. Dans un cas comme dans l’autre, l’opacité et la connivence entre la Commission européenne et les industriels se seront même invitées au cœur de ce discours.

Notes
(1) « The United States of Europe: A Gravity Model Evaluation of the Four Freedoms » de Keith Head et Thierry Mayer parue en 2021 au Journal of Economic Perspectives, Volume 35, Number 2, Spring 2021, Pages 23-48.
(2) Parsons, Matthijs et Springer, Why Did Europe’s Single Market Surpass America’s, 2021.
(3) Proposition de Règlement du Parlement européenne et du Conseil relatif à l’établissement du programme pour l’industrie européenne de la défense et d’un cadre de mesures visant à assurer la disponibilité et la fourniture en temps utile des produits de défense.
Photo d'ouverture : La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, prononce son discours annuel sur l'état de l'Union lors d'une session plénière au Parlement européen à Strasbourg, dans l'est de la France, le 10 septembre 2025. (Photo de SEBASTIEN BOZON / AFP)
Cet article est gratuit grâce aux contributions des abonnés !
Pour nous soutenir et avoir accès à tous les contenus, c'est par ici :
S’abonner
Accès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous

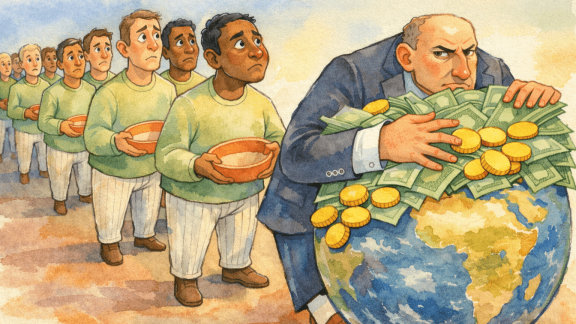
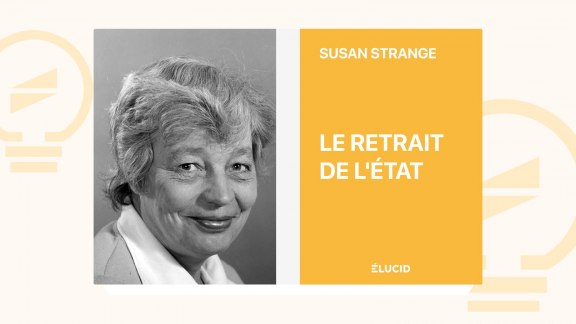


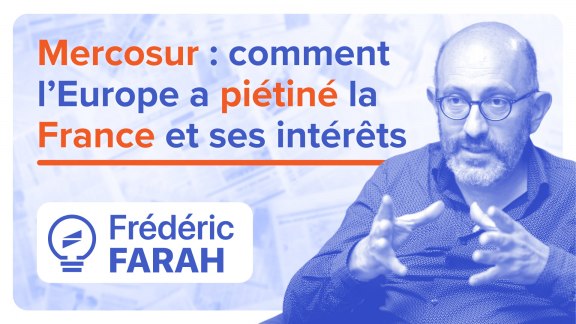


9 commentaires
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.
S'abonner