Le sensationnalisme est toujours la tare de l'autre alors qu'il est indissociable de la communication moderne. Yoan Vérilhac, maître de conférences en littérature à l'Université de Nîmes, sort ce concept d'une vision uniquement négative dans son livre Sensationnalisme, enquête sur le bavardage médiatique (Amsterdam, 2024), qui est aussi une réflexion sur le bavardage dont l'auteur souligne le caractère fédérateur.

Laurent Ottavi (Élucid) : Le sensationnalisme ne se laisse pas définir d'après vous, il est plus intéressant de chercher à le situer, d'autant plus qu'il a différentes formes selon les pays. Pouvez-vous, dans un premier temps, donner des exemples très divers de ce qui relève du sensationnalisme puis expliquer quels ont été à la fois votre démarche et votre objectif dans ce livre ?
Yoan Vérilhac : On a tendance à utiliser le mot de « sensationnalisme » comme s’il désignait une attitude générale et bien définie. Quand on voit un reportage à la télé, qui nous paraît exagérer les effets de dramatisation, nous jugeons spontanément que ce « sensationnalisme » est déplacé ou inadapté. Le sensationnalisme, on sait très bien ce que c’est, et c’est toujours chez les autres qu’on le repère et qu’on le dénonce : les journalistes le pointent chez leurs confrères, les intellectuels veulent en préserver les masses, les parents mettent en garde leurs enfants, les professeurs en montrent les dangers aux élèves… tout cela avant que chacun ne se délecte, en toute bonne foi, d’un débat enflammé, de telle fiction mélodramatique, d’une autobiographie racoleuse, etc. Or, lorsqu’on observe les différents objets et les différentes situations auxquels le mot de « sensationnalisme » s’applique, on découvre que c’est très variable, et même contradictoire.
D’abord, même si on associe plutôt le sensationnalisme au journalisme d’information, on doit bien reconnaître que certaines activités de loisirs sont aussi concernées par cette étiquette. Par exemple, les parcs d’attractions, les foires, les sports extrêmes (parapente, saut à l’élastique) sont aussi des divertissements fondés sur la stimulation de sensations fortes. Mais on peut aussi associer à cette idée des genres de fictions ou de spectacles : les films d’horreur, les mélodrames, les films pornographiques sont aussi des promesses de sensations fortes, comme tous ces spectacles de son et lumière auxquels nous allons assister pour Noël, en foule, pour en prendre « plein la vue ». D’ailleurs, la publicité qui accompagne toutes ces activités pour vanter leurs qualités exprime très clairement la continuité entre elles. Si vous vous amusez à taper « sensationnel » dans Google, vous trouverez mille affiches vantant des œuvres très différentes à travers cette étiquette.
Lisez la suite et soutenez un média indépendant sans publicité
S’abonnerAccès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous

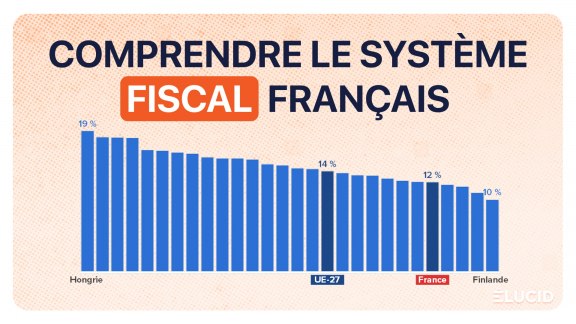
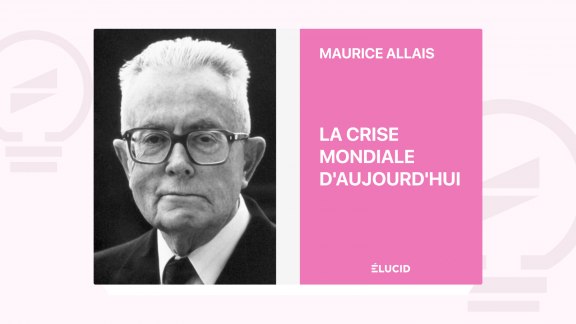

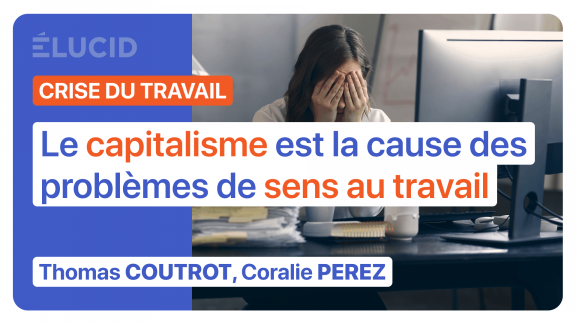

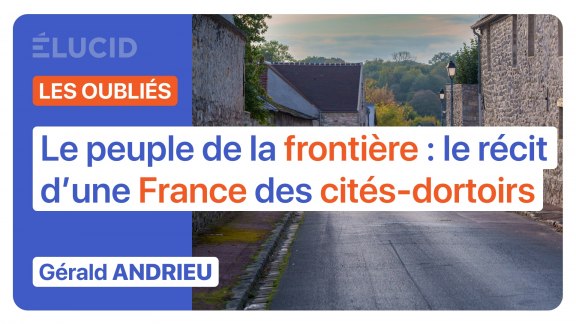

0 commentaire
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.
S'abonner