Article élu d'intérêt général
Les lecteurs d’Élucid ont voté pour rendre cet article gratuit.
Lors de la Première Guerre mondiale, les États-Unis n’ont pas joué le rôle décisif qui leur est aujourd’hui prêté. Dominique Lormier, essayiste, auteur de très nombreux ouvrages, parmi lesquels Le mythe du sauveur américain (Pierre de Taillac, 2017) et qui fait prochainement paraître Les vérités cachées de la Libération (éditions du Rocher) et Nouvelles histoires extraordinaires du débarquement et de la Libération (Alisio), souligne au contraire la contribution décisive des Français et des Italiens à la victoire contre l’Allemagne en 1918. Il analyse également les causes de cette mésinterprétation de l’Histoire.
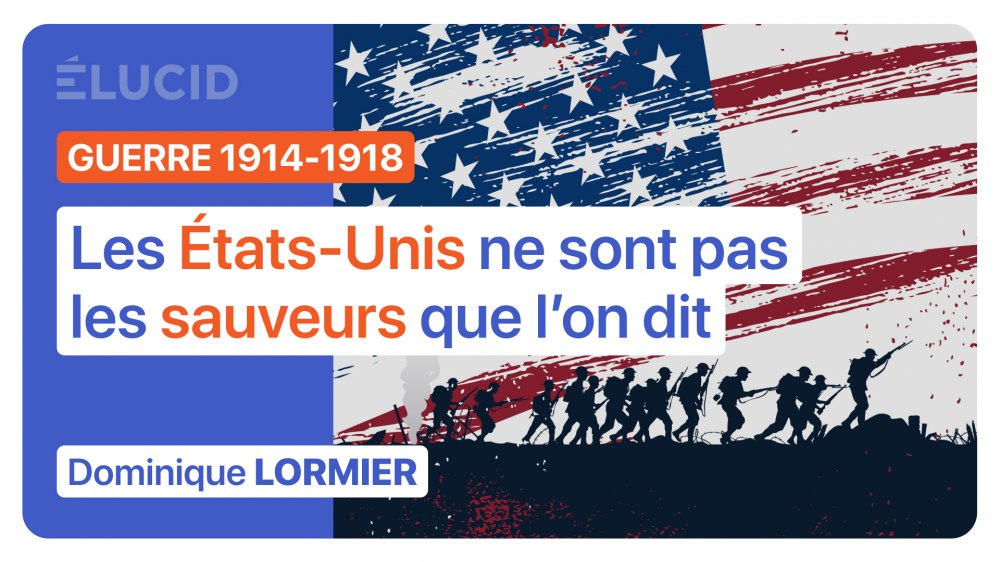


Abonnement Élucid
Laurent Ottavi (Élucid) : Pour se faire une idée de la participation des États-Unis lors de la Première Guerre mondiale, vous estimez qu’il faut poser un regard panoramique sur l’état des forces en 1917-1918. Pouvez-vous relativiser l’ampleur des troupes déployées lors de la Première Guerre mondiale par les Américains, leur qualité et surtout situer où elles ont été positionnées ?
Dominique Lormier : Les premières divisions américaines interviennent seulement en première ligne à partir de l’été 1918. Sur la totalité des trois fronts (occidental, italien, balkanique), les armées américaines sont présentes à hauteur de 405 000 soldats, contre 2,8 millions de soldats français, 2,2 millions de soldats italiens et 1,9 million britanniques. Lors de la seconde bataille de la Marne – le véritable tournant de la guerre sur le front occidental – l’armée américaine n’est pas présente. Au moment de la signature de l’armistice, on compte environ 110 divisions françaises, à peu près une soixantaine de divisions britanniques, une cinquantaine de divisions italiennes, et 16 divisions américaines en première ligne, dont 8 ont réellement l’expérience du combat.
Entre 32 et 42 divisions américaines sont situées dans des camps d’entraînement en France, censées intervenir en mars 1919. Elles ont affaibli l’encadrement de l’armée française, car celui-ci a été mobilisé pour les former au combat. La majorité des morts américains se produisent d’ailleurs à l’arrière, en raison d’accidents ou de la grippe « espagnole » de 1918. Ces chiffres montrent d’emblée que les États-Unis ne sont pas les sauveurs que l’on dit.
De plus, les armées américaines ne disposent que de très peu d’officiers qui connaissent la guerre moderne. Elles sont composées pour l’essentiel de soldats inexpérimentés. Elles n’ont pas non plus d’armement digne de ce nom. L’apport de l’industrie des États-Unis tarde en effet à se faire sentir, notamment dans le domaine de l’artillerie lourde. L’armée française se charge donc d’équiper l’armée américaine et de former ses soldats.
« En 1918, la France s’avère être l’armée la plus puissante du monde. »
Élucid : Vous réévaluez précisément le rôle joué par la France dans la victoire. Où se situe-t-elle dans le rapport de force en 1918 ?
Dominique Lormier : Durant les mois de mars et d’avril 1918, les Allemands sont libérés du front russe et engagent massivement leurs troupes pour attaquer ce qu’ils appellent « le maillon faible », c’est-à-dire le front tenu par les Britanniques dans les Flandres et en Picardie. Ils engagent douze offensives contre le secteur britannique. Les Anglais sont sauvés alors à deux reprises par l’engagement de 40 divisions françaises de réserve constituées par Pétain qui a anticipé que les Allemands libérés du front russe allaient jouer le tout pour le tout pour séparer les Français des Britanniques et frapper ensuite la France. Aucune troupe américaine n’est présente à ce moment-là, les seuls régiments sur le pays étant alors dans l’est de la France.
Ensuite, au mois de mai et durant tout l’été 1918, l’Allemagne porte ses coups contre l’armée française en Champagne. Les Français réussissent à contenir quasi seuls les troupes allemandes lors de la Seconde bataille de la Marne en juin-juillet 1918. 60 divisions françaises y sont engagées, contre à peine 2 à 5 divisions américaines. Les chars Renault FT-17, les premiers à utiliser une tourelle pivotante, s’avèrent décisifs. Ils sont utilisés massivement en appui d’infanterie.
À ce moment-là, les Allemands comptent seulement une quarantaine de chars – contre à peu près 3000 pour les Français, dont plus de la moitié sont des Chars Renault FT-17 – et ils ne jouent pratiquement aucun rôle durant les combats. La bataille de la Marne, dont j’ai déjà souligné le caractère décisif, condamne l’Allemagne à une guerre défensive. En 1918, la France s’avère donc l’armée la plus puissante du monde.
« La bataille de l’Isonzo fut plus meurtrière que celle de Normandie en 1944 et des Ardennes en 1945 réunies. La 11e offensive fit 323 000 morts et blessés chez les Italiens contre 250 000 chez les Austro-Hongrois. »
Plus inattendu que la valorisation des Français, vous soulignez également la contribution importante des Italiens à la victoire. De quelle contribution parlons-nous et pourquoi est-elle dénigrée par l’historiographie ?
L’Italie est entrée en guerre en mai 1915. Le front italien, le plus difficile de tous, est devenu le deuxième en importance du côté des Alliés, encore plus du fait de la défection de la Russie. Il a fixé une vingtaine de divisions austro-hongroises en 1915, une quarantaine en 1916, une cinquantaine en 1917 et une soixantaine en 1918, autant de troupes qui ne peuvent intervenir sur le front français. Le front italien a nécessité le plus de divisions des puissances centrales (l’Autriche-Hongrie, l’Allemagne et la Turquie, sans oublier la Bulgarie engagée sur le troisième front dans les Balkans). Il a notamment mobilisé une cinquantaine de divisions italiennes, soutenues par deux divisions françaises et quatre divisions britanniques, pour un régiment américain seulement, qui ont affronté des positions montagneuses très favorables à la défense austro-hongroise.
En 1918, sur le front des Balkans, l’armée italienne est la troisième contributrice en effectifs militaires alliés avec 144 000 soldats, derrière la France (210 000 soldats), la Grèce (157 000 soldats) et devant la Grande-Bretagne (138 000 soldats) et la Serbie (119 000 soldats). Sur l’ensemble des trois fronts, elle est la deuxième plus grande contributrice en soldats engagés, juste derrière la France. L’image de piètre combattant des Italiens est due en partie à la défaite de Caporetto en 1917, mais on oublie la bataille de l’Isonzo, avec ses 11 offensives, l’une des plus meurtrières de la Première Guerre mondiale, avec notamment la onzième offensive qui a fait 323 000 morts et blessés chez les soldats italiens contre 250 000 chez les Austro-Hongrois. Si l’on prend en compte la totalité des tués dans les deux camps lors de la bataille de l’Isonzo, elle fut plus meurtrière que celle de Normandie en 1944 et des Ardennes en 1945 réunies.
Les Italiens ont ensuite remporté quasi seuls la victoire de Vittorio Veneto, qui a contraint l’Autriche-Hongrie à capituler, ce qui a accéléré la demande d’armistice de la part de l’Allemagne, car elle aurait sinon dû faire face à la menace d’envahissement de la Bavière par les Italiens. L’injustice historique avec laquelle sont traités les Italiens s’explique notamment par le complexe de supériorité raciste des Anglo-américains vis-à-vis des populations du Sud latines, que le wasp (le protestant blanc anglo-saxon) se représente comme des peuples peu travailleurs, mafieux et mauvais soldats. À l’époque, les généraux et même des maréchaux autrichiens avaient au contraire salué la bravoure des soldats italiens.
« Les gouvernements français et britanniques exagèrent la puissance militaire américaine pour soutenir le moral de leur nation et impressionner l’ennemi. »
Le mythe du sauveur américain, qui va de pair avec la marginalisation des Français et des Italiens, n’est pas né après la guerre, mais pendant. À quoi doit-il son émergence ?
En 1917-1918, les gouvernements français et britanniques exagèrent la puissance militaire américaine pour soutenir le moral de leur nation et impressionner l’ennemi. Les Alliés extrapolent aussi l’appui des États-Unis pour donner l’impression que la défaite de l’Allemagne serait due uniquement aux Alliés. La presse française extrapole par ailleurs la valeur de l’armée américaine et se persuade que son intervention est décisive alors que la guerre est déjà gagnée lors de l’été 1918, tandis que l’entrée massive des armées américaines ne survient qu’en 1919.
Sur l’arrière du front, il y a enfin beaucoup de camps américains et de nombreux défilés qui accréditent l’idée que le « rouleau compresseur » yankee, d’autant plus fascinant qu’il se compose de jeunes soldats, s’apprête à frapper l’ennemi. L’arrivée massive de navires américains dans les ports français fascine aussi la population.
Ce mythe du sauveur américain s’est-il intensifié par la suite et, si oui, pour quelles raisons ?
Dès les années 1920 et 1930, la culture américaine pénètre la population française, notamment urbaine, à travers le jazz, symbole de liberté, même si les États-Unis pratiquent alors la ségrégation raciale. Elle va devenir encore plus présente après la Seconde Guerre mondiale. La montée en puissance de l’économie américaine dans le monde contribue elle aussi à donner plus d’importance à une relecture très favorable du rôle des États-Unis lors de la Première Guerre mondiale.
Il y a déjà un certain nombre de politiques français fascinés par tout ce qui vient d’outre-Atlantique, une puissance industrielle et jeune, et qui ont tendance à dénigrer ce qui est français, peut-être parce que la France est sortie exsangue d’un conflit où elle a perdu beaucoup de soldats. Le soft power américain, avec toute l’industrie culturelle, n’a fait qu’accentuer encore les choses. L’historiographie dominante a également orienté le regard sur le passé car, du fait de l’importance de la langue anglaise, elle a des débouchés au niveau international et influence donc les autres pays.
« Contrairement à la représentation qu'on s'en fait aujourd'hui, le débarquement en Normandie en 1944 est composé à 60 % de soldats canadiens et britanniques. »
Vous abordez à peine le traité de Versailles dans votre livre. Là aussi, le regard porté sur ce sujet est-il parasité par le mythe du sauveur américain ?
Une offensive est normalement prévue en novembre 1918 qui doit permettre l’entrée des troupes françaises en Allemagne. Cela aurait détruit dans l’œuf le mythe, mis en avant par les nazis, du « coup de poignard dans le dos », selon lequel l’Allemagne qui n’a pas perdu est trahie par les hommes politiques. L’offensive n’a pas lieu sous la pression des Anglo-américains et également du général Foch qui voulait éviter de nouvelles pertes françaises, contre l’avis de Pétain.
Concernant le traité de Versailles, le président Wilson veut ménager l’Allemagne. Il a des arrière-pensées commerciales et aussi l’espérance d’une entente possible, à partir du lien réel au niveau racial entre les Américains et les Allemands, au détriment des peuples latins, y compris la France. Les Anglais, eux, ont toujours voulu éviter que la France prenne trop de puissance en Europe et beaucoup étaient germanophiles, quitte à réduire la France à un second plan. Churchill, plutôt francophile, estime pour sa part que la France devait avoir une armée puissante, mais il n’est pas majoritaire.
Qu’en est-il du « mythe du saveur américain » pour la Seconde Guerre mondiale ?
La guerre en Ukraine a eu tendance à faire passer au second plan l’apport de l’URSS lors du conflit. Sur les 5,5 millions de soldats allemands morts, 4 millions sont tombés sous les coups de l’armée soviétique. Elle a affronté 60 % de l’armée allemande. D’autre part, le débarquement en Normandie, contrairement à la représentation qu’on s’en fait aujourd’hui, est composé à 60 % de troupes canadiennes et britanniques. Elles ont fixé la majorité des panzer-divisions présentes en France, facilitant la percée victorieuse de l’armée américaine, tout comme l’armée chinoise a fixé 75 % des divisions japonaises en Asie et dans le Pacifique. Celui en Provence comportait 250 000 Français, contre 150 000 soldats américains. Tout le sud et le grand sud-ouest du pays est libéré par les maquis. Sur les 400 000 Allemands présents dans le sud de la France, 200 000 sont mis hors de combat par l’armée de De Lattre et par les maquis du sud-ouest. À nouveau, les chiffres tranchent très nettement avec l’idée d’un sauvetage américain.
Propos recueillis par Laurent Ottavi.
Photo d'ouverture : seita - @Shutterstock
Cet article est gratuit grâce aux contributions des abonnés !
Pour nous soutenir et avoir accès à tous les contenus, c'est par ici :
S’abonner
Accès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous


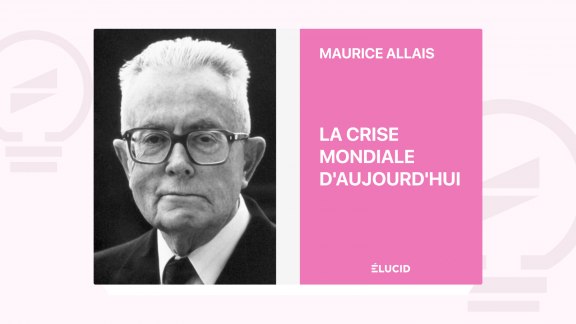

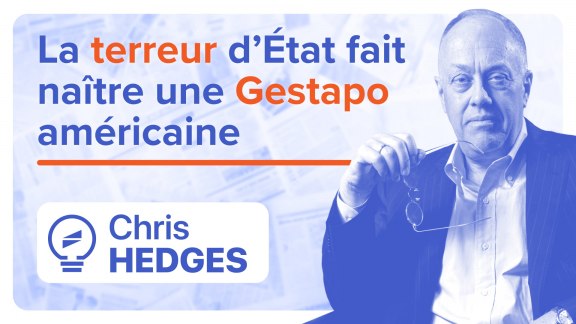
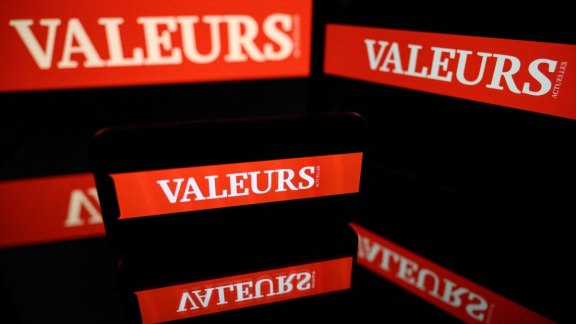
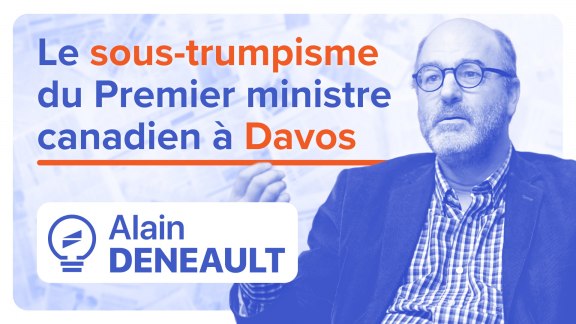
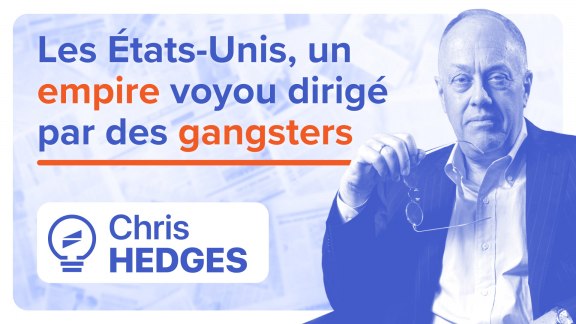
1 commentaire
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.
S'abonner