Si la figure de De Gaulle reste aujourd’hui largement plébiscitée, si celle de Clemenceau est régulièrement exhumée, Léon Gambetta de son côté, est tombé dans un anonymat à peu près complet. Si la plupart des Français connaissent ce nom donné à nombre de boulevards, de places et de rues, ils ignorent ce que ce personnage a eu d’essentiel dans l’histoire contemporaine de notre pays, et ce qu’ils lui doivent en tant que citoyens.

Comment faut-il l’appeler : Père fondateur de la République ? Apôtre du suffrage universel ? Grand défenseur des libertés parlementaires ? Chantre de l’unité nationale, de la défense de la patrie ? Il est tout cela à la fois. Jean-Marie Mayeur, son biographe, préfère pour sa part le qualifier de « héros démocratique », œuvrant pour le salut du peuple face à l’ennemi extérieur, pour son triomphe au plan intérieur et aimé par lui en retour. Principal animateur du camp républicain au cours des années 1870, il joue un rôle décisif dans la fondation et l’affermissement d’une République née inopinément, en pleine guerre contre la Prusse. En une décennie, cette nouvelle République acquiert une légitimité telle qu’elle se confond dès lors avec la France, conformément au vœu le plus cher des Républicains ardents, qui voyaient dans le triomphe de ce régime le couronnement de notre histoire nationale.
De ce triomphe, Gambetta est largement responsable. Les réussites tactiques des autres chefs du camp républicain, l’engagement actif de centaines de milliers de citoyens, l’adhésion finale du pays à la cause de Marianne : rien de tout ceci n’eût été possible si un homme hors du commun, par ses qualités propres, n’avait pas assuré dans les faits la direction du mouvement historique profond qui rendit la France républicaine. Brillant orateur, lutteur infatigable, d’un républicanisme ardent et inextinguible, Gambetta n’est pas un porteur de flambeau : il est le flambeau lui-même, brandi par tout un peuple.
Retour sur les principales étapes de sa vie au service de la République.
Lisez la suite et soutenez un média indépendant sans publicité
S’abonnerAccès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous


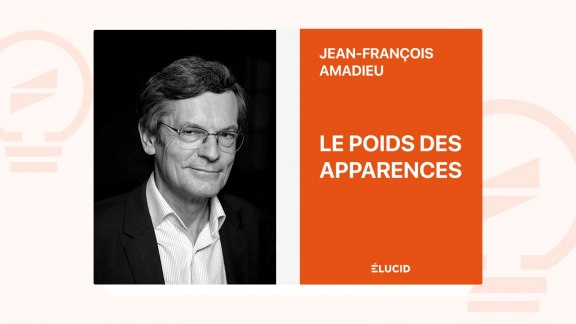
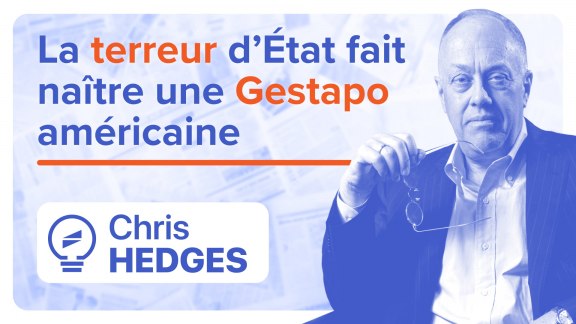
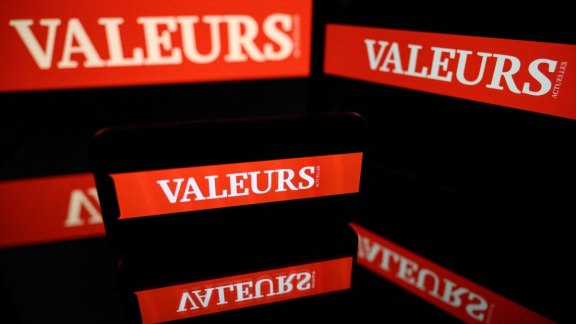
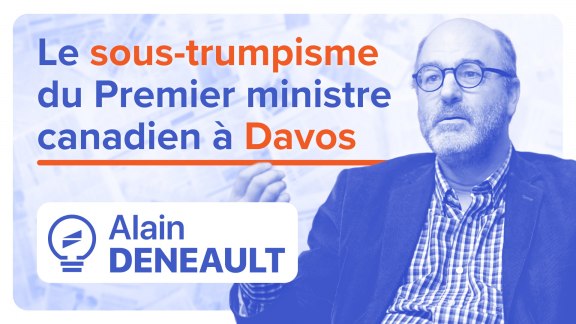
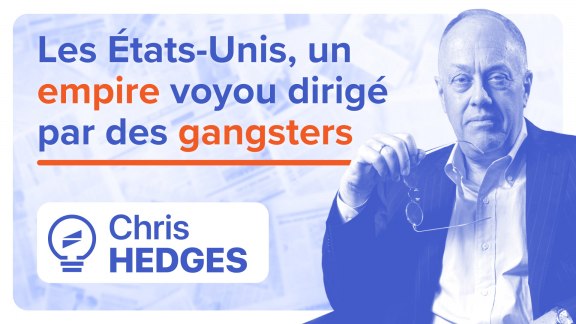

0 commentaire
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.
S'abonner