Le soutien militaire de la France au gouvernement rwandais, entamé en 1990, a continué malgré l’intensification des exactions contre les Tutsi, y compris lors du génocide commis en 1994. Le journaliste Laurent Larcher, auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet, dont le dernier Papa, qu’est-ce qu’on a fait au Rwanda ? (Seuil, 2024), relate l’enchaînement des événements, détaille les informations dont disposaient les dirigeants français, et explique les raisons du soutien au gouvernement rwandais.

Laurent Ottavi (Élucid) : Comment la France en vient-elle à soutenir le gouvernement rwandais en 1990 et pour quels motifs ?
Laurent Larcher : En octobre 1990, François Mitterrand décide d’envoyer des parachutistes pour empêcher l’effondrement de l’armée rwandaise, bousculée par un raid mené depuis l’Ouganda par le FPR (le Front Patriotique Rwandais), un mouvement politico-armé composé d’exilés tutsi ayant fui les pogroms et les persécutions et cherchant à revenir dans leur pays. Le président français répond à une sollicitation du président du Rwanda, Juvénal Habyarimana. L’intervention des parachutistes français vise officiellement à protéger les Européens sur place. En réalité, elle sauve le régime du président Habyarimana en permettant à l’armée rwandaise de se remobiliser et de repousser l’offensive du FPR.
Cette opération militaire « Noroît », censée durer quelques semaines puis quelques mois, a été prolongée par l’Élysée jusqu’à la fin de l’année 1993. La Belgique, qui était aussi intervenue au Rwanda, s’est retirée dès la fin du mois d’octobre après avoir constaté que le gouvernement rwandais commettait des exactions contre les Tutsi (arrestations massives, tortures, exécutions).
Élucid : La France est-elle alors informée des intentions et des actes du gouvernement rwandais ?
Laurent Larcher : Fin décembre 1990-début janvier 1991, le général Jean Varret, chef de la coopération militaire – c’est-à-dire patron de tous les militaires français (environ 800, principalement en Afrique) envoyés dans les ex-colonies françaises au titre de la coopération – est alerté par son attaché Défense en poste à Kigali des exactions commises par l’armée et le régime rwandais sur les Tutsi. Il s’y rend pour évaluer ce qu’il s’y passe et rencontre les chefs de l’armée rwandaise. Au cours de l’une de ces réunions, ces derniers lui réclament plus de soutien militaire, plus d’armes, de l’artillerie, des blindés, des bazookas, plus de grenades, plus d’obus…
Lisez la suite et soutenez un média indépendant sans publicité
S’abonnerAccès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous


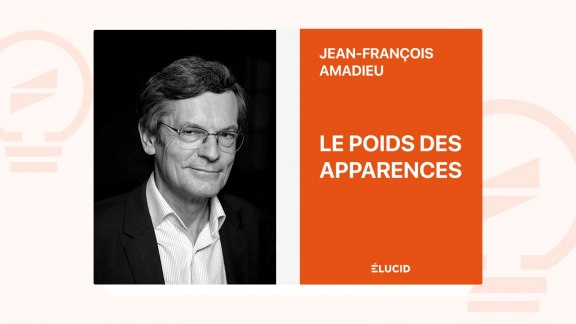

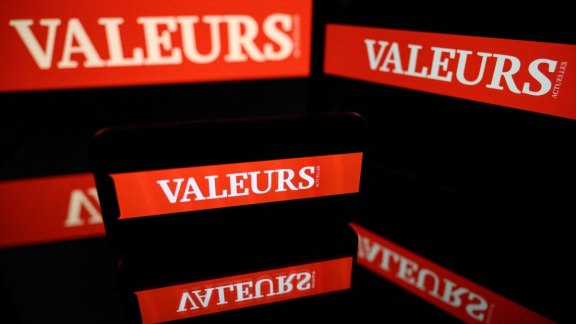
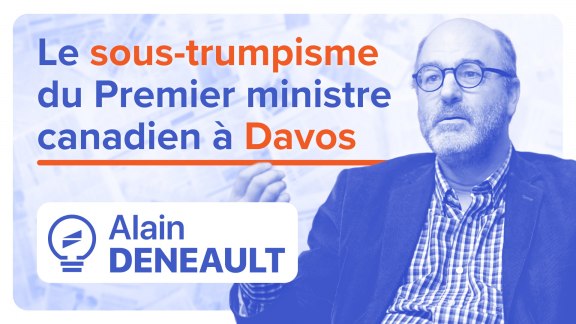
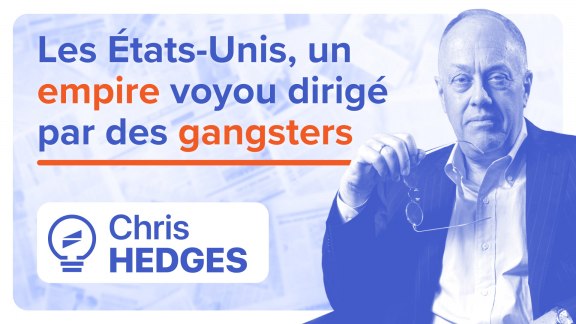

7 commentaires
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.
S'abonner