La relation historique entre les États-Unis et l’Union européenne est en train de se déliter à très grande vitesse depuis l’arrivée au pouvoir de la nouvelle administration à Washington. Après le revirement total qu’a opéré Trump sur le soutien à l’Ukraine, les pays de l’Union européenne semblent prendre tout à coup conscience de leur dépendance totale à l’égard des États-Unis. Si l’enjeu de la « souveraineté » revient sur le devant de la scène, le travail à faire reste colossal. Car l’une de ses dimensions essentielles est la dépendance numérique dans laquelle se trouve l’Union européenne à l’égard des États-Unis.

Le 24 février au soir, peu après l’annonce des résultats aux élections fédérales allemandes, le dirigeant de la CDU – parti conservateur arrivé premier – Friedrich Merz annonce : « Ma priorité absolue sera de renforcer l’Europe le plus rapidement possible de manière à ce que nous obtenions peu à peu une véritable indépendance vis-à-vis des États-Unis. […] Il est devenu clair que les Américains, ou en tout cas cette partie des Américains, ce gouvernement, sont largement indifférents au sort de l’Europe ».
Friedrich Merz est pourtant considéré comme « le plus pro-américain des politiques en Allemagne », selon le correspondant de Die Zeit, Jörg Lau.
L’ingérence étrangère du gouvernement Trump-Musk
Au cours des trois derniers mois, Elon Musk s’est immiscé dans les élections parlementaires allemandes, mettant Twitter au service de l’AfD, parti d’extrême droite, et cela commence à inquiéter sérieusement les dirigeants européens. François Bayrou le disait lui aussi dans son discours de politique générale du 15 janvier dernier :
« L'offensive monétaire, la captation de la recherche mondiale, la poursuite de l'application extraterritoriale de leurs droits, la domination technologique par des entreprises de taille planétaire et le pouvoir que tout cela donne d'intervenir dans la vie démocratique d'autres États. Ce nouvel ordre mondial, ou plutôt ce nouveau désordre mondial qui menace tous les équilibres et toutes les règles de la décence, il y a un certain nombre de figures qui l'incarnent sans complexe, comme celle de Monsieur Elon Musk. »
Lisez la suite et soutenez un média indépendant sans publicité
S’abonnerAccès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous





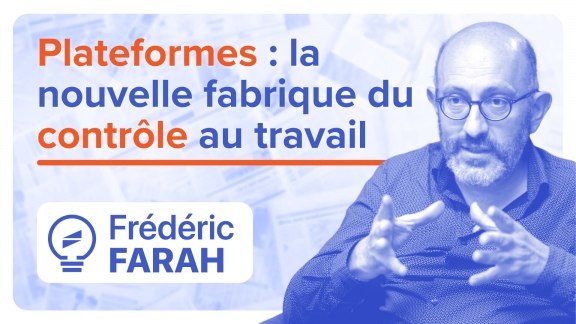

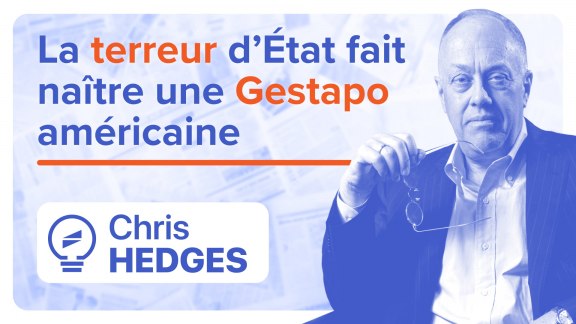
9 commentaires
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.
S'abonner