Les longs jours de tractation pour réussir à faire naître le nouveau gouvernement conduit par Michel Barnier ont été aussi l’occasion de la mise en scène d’une dramaturgie désormais européenne, celle des déficits et de la dette. Avant nous à l’automne 2009, les Grecs avaient déjà ouvert la porte sur l’enfer en annonçant des déficits et une dette plus élevée que prévu. En 2011, en Italie, la dette du pays est entrée dans un tourbillon spéculatif qui a contraint à la démission du gouvernement Berlusconi, remplacé par l’ancien Commissaire européen Mario Monti. Ce dernier n’avait alors pas hésité à infliger une violente cure d’austérité à son pays.



Abonnement Élucid
Le dérapage des comptes publics a largement dépassé la sphère très technique des finances publiques pour entrer dans le domaine politique. Après tout, cela se comprend, puisque la définition et le vote du budget par un Parlement constituent le sel de la démocratie parlementaire. N’oublions pas que la politique est un système d’équité, c’est-à-dire une répartition plus ou moins équitable du partage des ressources et des charges selon les catégories de la population. Or, l’invocation de la dette, des déficits et de leurs périls supposés permet de réduire les ardeurs dépensières de certains ministères et surtout, elle sert à maintenir un ordre économique bien souvent profitable au plus petit nombre, surtout en matière fiscale.
L’histoire économique récente montre combien le storytelling de la dette et des déficits est au service d’un conservatisme économique qui tente de rendre légitime la coupe dans les dépenses sociales et de justifier nombre de reniements politiques. On le comprend mieux lorsque l’on garde à l’esprit que l’essentiel de la dépense publique est fait de dépenses sociales majoritairement liées à la retraite et à la maladie. Les dépenses sociales sont bien souvent les revenus de ceux qui n’ont rien.
Ainsi à l’automne 1995, revenant d’un voyage en Allemagne et d’une discussion avec le chancelier Kohl, Jacques Chirac annonçait à Alain Duhamel que la lutte contre les déficits devait l’emporter sur la préoccupation de la fracture sociale. En 2006, le rapport Pébereau (du nom de l’ancien président de la BNP) se voulait être un coup de semonce pour rappeler comment la dette publique s’était construite en France et les moyens de la réduire. Sans compter l’antienne couramment répétée que « voilà 50 ans que la France n’a pas présenté un budget en équilibre », sans que l’on sache l’intérêt ou la pertinence d’une telle performance. On peut aussi rappeler le couplet sur les « dettes laissées aux générations futures », dont l’avenir se noircirait et accablées par le fardeau de l’endettement.
L’assomption de l’obsession budgétaire depuis la naissance du traité de Maastricht a créé un nouveau fétiche : le fameux « 3/60 » cher aux fonctionnaires européens, à savoir la règle des 3 % de déficit et des 60 % de dette publique rapportée au PIB – omettant au passage d’indiquer l’aberration statistique que cet indicateur représente. En effet, lorsque les étudiants découvrent l’économie, il leur est appris que comparer un flux et un stock est incorrect. Or, le PIB est un flux de revenus et la dette un stock. Dire que la dette représente telle part du PIB est un peu idiot, car cela laisse entendre par exemple qu’il faudrait rembourser en une année une dette publique accumulée depuis des années. La dette publique n’est autre que la mémoire des déficits cumulés.
Voilà trente ans que nous sommes désormais gouvernés par des objectifs intermédiaires : la maîtrise des comptes publics et de la dette. Or, une politique budgétaire est articulée autour d’instruments, comme le budget et la fiscalité, au service d’objectifs intermédiaires, comme l’équilibre des comptes publics, et surtout d’objectifs finaux comme la croissance et l’emploi pour n’en citer que deux. Mais les objectifs intermédiaires l’ont finalement emporté sur les objectifs finaux. Voilà encore un effet des choix européens qui ont été retenus par l’ensemble des différents gouvernements depuis le début des années 1990. C’est une « gouvernance par les nombres », pour reprendre les termes du juriste Alain Supiot.
Au regard de l’histoire de la pensée économique, nous assistons dans ce domaine au retour d’archaïsmes qui nous renvoient à la pensée budgétaire d’avant 1945. À cette période, le budget de l’État était assimilé à une famille : l’État ne devait pas dépenser plus qu’il ne gagnait. Ce type d’obsession a conduit à de nombreuses politiques déflationnistes qui ont amplifié la crise des années 1930.
Avant même de discuter de l’actualité d’un budget qui concentre nombre de périls, il faut bien garder en tête combien faire du budget un terrible épouvantail politique est utile pour rendre toute alternative impossible. Le Nouveau Front Populaire faisait face au feu roulant des critiques de ceux qui estimaient qu’il ne pouvait y avoir qu’une voix budgétaire possible, celle plus ou moins déguisée d’une austérité. Modifier la fiscalité, revenir des avantages fiscaux donnés aux plus aisés, revaloriser le SMIC ou encore le salaire des fonctionnaires, tout cela devenait comme autant de déviances de l’orthodoxie budgétaire proclamée, mais jamais atteinte.
Cette petite musique budgétaire pouvait paraître encore plus crédible et audible par le grand nombre par l’invocation de nos engagements européens. Il en allait de la crédibilité du pays, de sa note – puisque désormais ce sont les marchés financiers qui nous financent. La question de la dette et du déficit prend toute sa force lorsque nous savons que nous ne disposons plus de l’arme monétaire et que le financement des besoins de la nation est réalisé par des acteurs étrangers, exposant la nation à une vulnérabilité considérable. C’est donc cet ensemble de considérations qui doivent éclairer tout débat budgétaire pour saisir l’ampleur des contraintes et surtout du discours alarmiste qui entoure cette question. Plus que jamais, l’économie est un rapport de forces.
Un budget impossible à réaliser
Avant même d’aborder les masses à l’œuvre et la tendance austéritaire qui se prépare, il faut dire encore un mot de politique puisque le gouvernement de Monsieur Barnier devra faire des arbitrages sous la surveillance du Rassemblement national, qui peut décider souverainement de sa survie ou de sa perte. Les risques de dérapage politique peuvent se présenter assez vite.
Plus encore, le nombre d’impératifs qui attend la nation rend le budget particulièrement périlleux, puisqu’il s’agit de faire tenir ensemble la poursuite de l’assainissement budgétaire, la préservation d’un État social garant à sa manière de la paix sociale et d'assurer des investissements d’avenir qui vont aussi bien des dépenses en matière éducative, que militaire ou écologique. Cette pléthore d’objectifs trouve difficilement un relais au niveau européen, puisque le plan de relance engagé lors de la phase du Covid n’aura pas de suite dans la nouvelle mandature d'Ursula Von der Leyen. Désormais, c'est la question du remboursement de ce plan qui se pose aux États membres.
Si la loi de finances de 2023 pouvait apparaître en hausse de 65 milliards par rapport à 2022, cette augmentation a été largement absorbée par celle des prix. Une fois l’effet prix retiré, c’est le contraire d’une augmentation qui s’observe : les dépenses publiques vont stagner – soit une progression de +0,1 point entre 2022 et 2023. Si l’on observe plus largement les choses, on remarque que seul le budget pré-gilets jaunes présentait une progression aussi faible. Si 2024 présentait ce visage, l’inquiétude ne peut qu’être légitime pour 2025. D’autant que l’Union européenne a engagé une procédure pour déficits excessifs à l’égard de la France.
Dans la précédente loi de finances, le gouvernement indiquait « sur la période 2022-2027, une croissance moyenne de la dépense publique de +0,6 % », ce qui constitue un effort significatif en comparaison des évolutions lors des précédents quinquennats. Cette maîtrise de la dépense sera portée par l’ensemble des administrations publiques. Dans l’exercice budgétaire précédent, le gouvernement sortant prévoyait une diminution des recettes publiques de 45,2 % à 44,7 %.
Comme le levier de réduction des dépenses semble être largement privilégié, la pression sur les services publics ne pourra être que considérable aussi bien sur la qualité future de ces derniers, que sur la situation de leurs agents.
Et l’austérité déjà là est renforcée par les mesures d’économies additionnelles de 10 milliards d'euros dans nombre de secteurs. Ainsi, la baisse de 1 % pour l'hébergement, le parcours vers le logement et l'insertion des personnes vulnérables se traduit par la fermeture de 20 000 places. De même, on observe une baisse de 23,8 % sur les crédits alloués à la stratégie interministérielle de prévention et de lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes. Tout un programme...
Le maintien de la politique de l’offre envers et contre tout, sous surveillance européenne
Le budget à venir doit être bouclé dans des conditions particulières, tant le nouveau gouvernement a tardé à être constitué après la nomination plus que polémique de Michel Barnier en tant que Premier ministre. En effet, le temps manque. Mais dans la mesure où le Premier ministre semble compatible avec les orientations économiques du président de la République, la question de la rupture de politique économique n’est plus à l’ordre du jour. Le budget à venir doit rassurer les marchés financiers et la Commission européenne.
C’est un effort budgétaire majeur qui va être attendu alors que le chômage remonte, et que la politique monétaire fait ressentir ses effets sur la croissance. La baisse des taux d’intérêt n’est pas encore perceptible dans l’activité. On peut largement se douter que le choix retenu pour entrer dans les clous européens et ramener les déficits dans les périmètres de Maastricht sera celui d’une austérité dont l’ampleur reste à déterminer.
Si les règles européennes sont respectées, 30 milliards d’économies devront être engagées en 2025 et 100 milliards en 2028. Le Conseil d’analyse économique, dans un rapport de juillet 2024, invite à l'objectif d’un excédent primaire de 1 %, c’est-à-dire un excédent hors intérêt à payer. Mais cette trajectoire ne sera pas simple à tenir et la casse sociale risque d’être élevée. Il appartiendra à l’État social de remplir son rôle de voiture-balai, pour amortir les effets de la rigueur. Ce terme doit être pris avec précaution; il s’agira de voir quels sont les ministères et les types de dépense qui connaîtront un rabot.
Plus que jamais, nos sociétés sont confrontées à ce trilemme impossible : respecter les équilibres budgétaires, assurer la pérennité de l’État social et engager les dépenses d’avenir. Au moment où la réindustrialisation du pays n’est pas au rendez-vous, où le chômage repart lentement à la hausse, où la productivité se tasse et où la démographie devient atone, ajouter une austérité budgétaire semble imprudent pour ne pas dire irresponsable...
Cet article est gratuit grâce aux contributions des abonnés !
Pour nous soutenir et avoir accès à tous les contenus, c'est par ici :
S’abonner
Accès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous


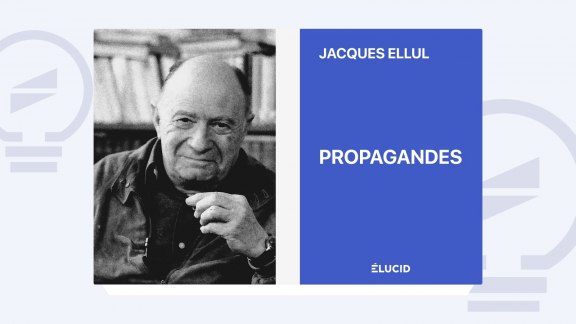





3 commentaires
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.
S'abonner