Il existe une version plus récente de cet article sur La balance des paiements de la France
Nous vous recommandons de lire notre article actualisé sur daté du
La balance des paiements de la France connaît un déficit historique malgré certaines forces de l'économie française que sont le commerce des services et les revenus reçus de l'étranger. Les difficultés énergétiques de 2022 ont conduit l’État à s’endetter encore plus auprès de l’étranger, ce qui à fait exploser notre dette extérieure. L’État français doit désormais près de 1 500 milliards d'euros à l’étranger, créant une situation très dangereuse pour notre souveraineté.

Nous avons récemment étudié la balance commerciale française, dont le déficit 2022 a frôlé le record à peine croyable de 200 milliards d'euros (Md€). Cependant, pour comprendre les problèmes de paiements qu’un tel déficit impose, il convient d’élargir le spectre d’analyse, en nous intéressant à la balance des paiements de la France.
Historiquement, les États-nations ont d’abord affirmé leur existence en définissant leurs limites géographiques et donc économiques : pas de frontière = pas d’État. Comme les paiements internationaux s’effectuaient en or, les économistes des XVIe et XVIIe siècles considéraient qu’une nation s’enrichissait lorsqu’elle accumulait des métaux précieux à l’intérieur de ses frontières. Ils s’intéressaient donc de très près aux flux avec l’extérieur, beaucoup plus qu’à la production de richesses à l’intérieur du pays.
La notion de balance des paiements apparaît dès le début du XIXe siècle, plus d’un siècle avant la comptabilité nationale et le PIB. Plus ancien document statistique à caractère macroéconomique, elle présente l’ensemble des opérations entre une économie et le reste du monde durant une période donnée. Elle ne comptabilise pas des stocks, mais des flux transfrontaliers : ceux de marchandises, de services, de revenus et de capitaux qui ont affecté le patrimoine des résidents (entreprises et personnes physiques).
La balance des paiements
Comme elle recense toutes les opérations avec l’étranger, une représentation classique de la balance des paiements additionne 3 éléments :
Lisez la suite et soutenez un média indépendant sans publicité
S’abonnerAccès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous


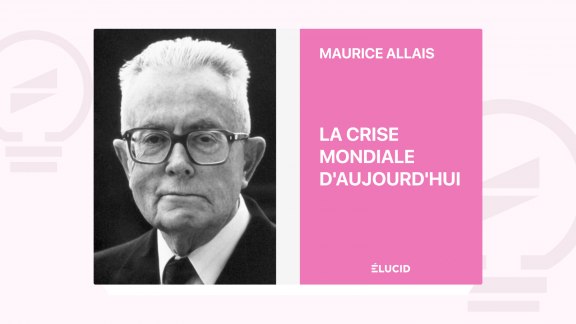




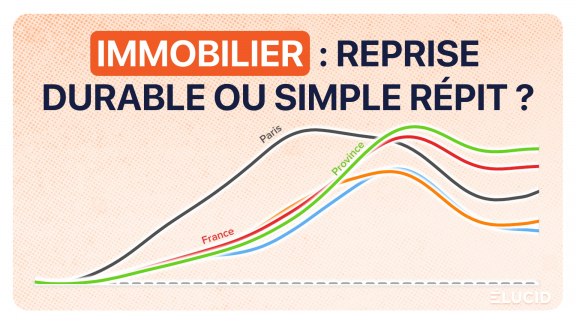
7 commentaires
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.
S'abonner