« Ce qu'on retient de notre rendez-vous avec Emmanuel Macron, c'est un immense mépris quand on lui parle du dogme du libre-échange ». Ces mots sont ceux de Thomas Gibert, Secrétaire général de la Confédération paysanne, après sa rencontre du 14 février dernier avec Emmanuel Macron. En cause, des accords de libre-échange dont l’Union européenne détient le record de signatures, avec pas moins d’une quarantaine à ce jour – un nombre qui croît sur un substrat dogmatique, leur intérêt n’ayant jamais été démontré, comme le regrette un récent rapport de l’Assemblée nationale.

En réponse aux agriculteurs sur le resserrement de l’étau exercé par une concurrence internationale, souvent déloyale et subie dans le cadre du libre-échange, le couperet présidentiel néolibéral est tombé : « il y a des gagnants et des perdants »… une énième nuance de mépris envers la population paysanne qui peine à vivre de son métier.
Mais des perdants, il n’y en a pas que parmi les agriculteurs. C’est la France tout entière qui est à la peine avec une part de marché dans les exportations mondiales réduite de moitié depuis 2010, et une balance commerciale de plus en plus déficitaire depuis 2003.
La petite phrase du président résume bien le rôle de variable d’ajustement de l’agriculture, dans le cadre des accords de libre-échange – une situation déplorée par les rapporteurs de l’Assemblée nationale. Ces accords imposent une concurrence déloyale à nos agriculteurs. De fait, nos « partenaires » commerciaux ont tout loisir de ne pas respecter les mêmes normes sociales (salaires beaucoup plus bas), sanitaires, phytosanitaires et environnementales.
Des différences de réglementation qui réduisent leurs coûts de production et qui sont décuplées par des effets d’échelle impossibles à développer en France. Sans compter que les accords signés par l'Union européenne ne prévoient pas la possibilité de diligenter des enquêtes en cas de non-respect des clauses et que les contrôles sont très rares.
Résultat : du fait de l’absence de clauses miroirs, l'hexagone importe massivement des produits moins chers, moins-disants socialement et environnementalement, et qui font disparaître nos capacités de production… Une situation tragique que la majorité présidentielle semble très bien accepter, notamment lorsque le député Renaissance Pascal Canfin, droit dans ses bottes, justifie la concurrence déloyale au motif que la France... ne dispose plus de capacités de production.
Lisez la suite et soutenez un média indépendant sans publicité
S’abonnerAccès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous


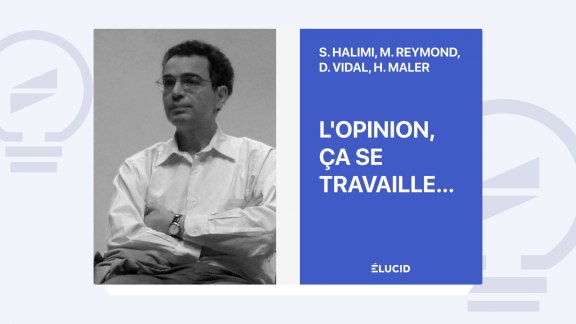





1 commentaire
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.
S'abonner