Les énergies renouvelables, et notamment l’énergie éolienne, constituent actuellement une des meilleures alternatives pour la décarbonation de nos économies et la diminution de notre dépendance aux hydrocarbures importés. Portée par un boom à l’issue de la crise Covid, la hausse de la production éolienne semble pourtant absente en Europe...

Portée par un boom à l’issue de la crise Covid, la hausse de la production éolienne semble pourtant absente en Europe. Sur les 180 TWh de hausse de la production au niveau mondial en 2022 (soit l'équivalent de la moitié de la production d’électricité française), le continent européen n’en a représenté que 23 TWh, contre 52 TWh pour les États-Unis et… 106 TWh pour la Chine.


Quand la Commission européenne s’en mêle…
Cette situation est d’autant plus surprenante que la Commission européenne a fait du développement de l’énergie éolienne son cheval de bataille, notamment dans la perspective de diminuer la dépendance de l’Europe aux hydrocarbures importés. Le déclenchement de la guerre en Ukraine et la perturbation des flux gaziers et pétroliers avec la Russie, ont en effet poussé la Commission à lancer en mai 2022 le plan REPowerEU, qui vise à porter à 45 % d’ici à 2030 la part des énergies renouvelables (ENR) dans la consommation finale d’énergie (avec un objectif contraignant à 42,5 %). Ce rehaussement n’est pas le premier du genre, puisque l’objectif initial forgé en 2018 était de 32 % d’ENR à 2030, augmenté à 40 % en 2021 dans le cadre du Pacte vert pour l’Europe.
Malgré ce soutien politique de façade, les fabricants de turbines éoliennes en Europe, par la voix de leur association professionnelle « WindEurope », s’alarment du fait que la puissance éolienne nouvellement installée en 2022 (d'environ 16 gigawatts) est clairement insuffisante pour atteindre les objectifs climatiques et énergétiques de l’Union européenne à horizon 2030. Pour parvenir à atteindre ces objectifs, WindEurope évoque un rythme d'installation minimum d'au moins 31 gigawatts chaque année entre 2023 et 2030.
Lisez la suite et soutenez un média indépendant sans publicité
S’abonnerAccès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous
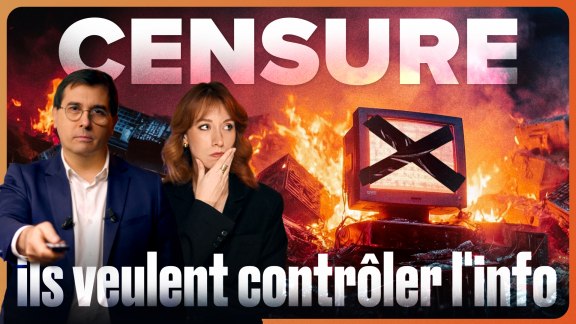







3 commentaires
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.
S'abonner