Bullshit Jobs (2018) nous amène à une réflexion profonde, à la fois sociologique, historique et philosophique, pour penser l’émergence et la prolifération du phénomène des jobs à la con, emplois totalement inutiles, mais valorisés économiquement et socialement.

Podcast La synthèse audio
De nombreux récits de personnes titulaires de tels emplois parsèment l’ouvrage, permettant de saisir la complexité du phénomène, mais aussi la logique qui permet son existence et son maintien.
Ce qu’il faut retenir :
Un Bullshit jobs est un emploi inutile et superflu qui, même lorsqu’il demande des efforts intellectuels ou physiques, ne remplit aucune fonction sociale et constitue un gâchis de temps, d’énergie et de travail. Les « jobs à la con », inutiles et néfastes, prolifèrent dans nos sociétés contemporaines sous différentes formes (larbin, petit chef, etc.). Fondés sur une certaine « religion du travail », selon laquelle le travail comme fin en soi se rémunère de lui-même, sans besoin de payer en argent, ils permettent la perpétuation d’un système de néo-féodalité managériale, justifiant la redistribution de la rente.
Engendrant une grande violence spirituelle, les « jobs à la con » affaiblissent tant les titulaires de ces emplois que la jeune génération, dégoûtée de la pauvreté intellectuelle du monde du travail. Dès lors, incapable de s’émanciper, maintenue dans cet état par le concours de la classe politique, la jeune génération ne constitue plus un danger de changement pour le pouvoir ; son esprit de contestation est tué par la médiocrité, par l’ennui et par l’inutilité de la valeur du travail.
Les conséquences psychologiques des bullshit jobs sont ainsi catastrophiques, produisant un sentiment d’humiliation, souffrance de ne pas agir sur le monde, etc. Se met en place une mécanique d’animosité. Le titulaire d’un bullshit job a nécessairement du ressentiment pour les titulaires d’un emploi utile.
Lisez la suite et soutenez un média indépendant sans publicité
S’abonnerAccès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous


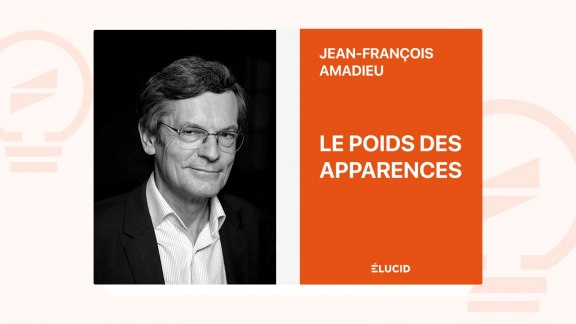

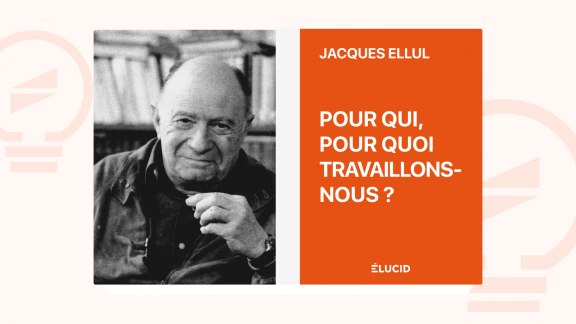

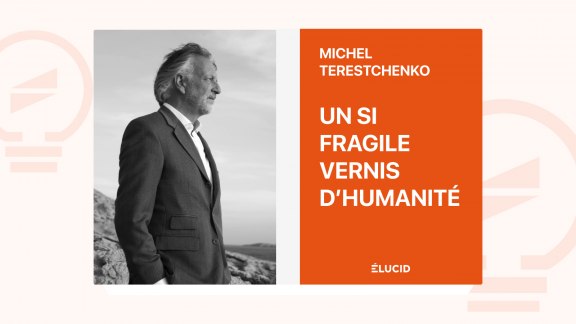
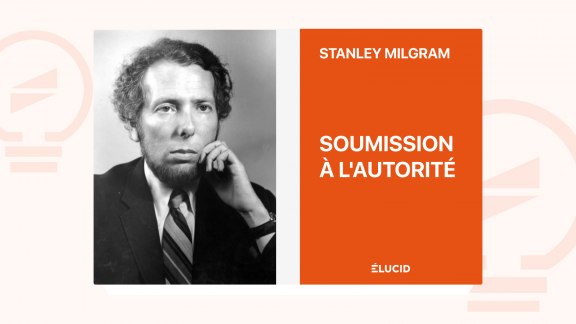
3 commentaires
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.
S'abonner