Pamphlet célèbre du jeune communiste Paul Nizan, Les Chiens de garde (1932) expose les méfaits de la Philosophie et des philosophes bourgeois. La philosophie idéaliste que la révolution bourgeoise a engendrée ne s’intéresse qu’à l’abstrait et à la Raison, ignorant les hommes concrets et leurs souffrances.
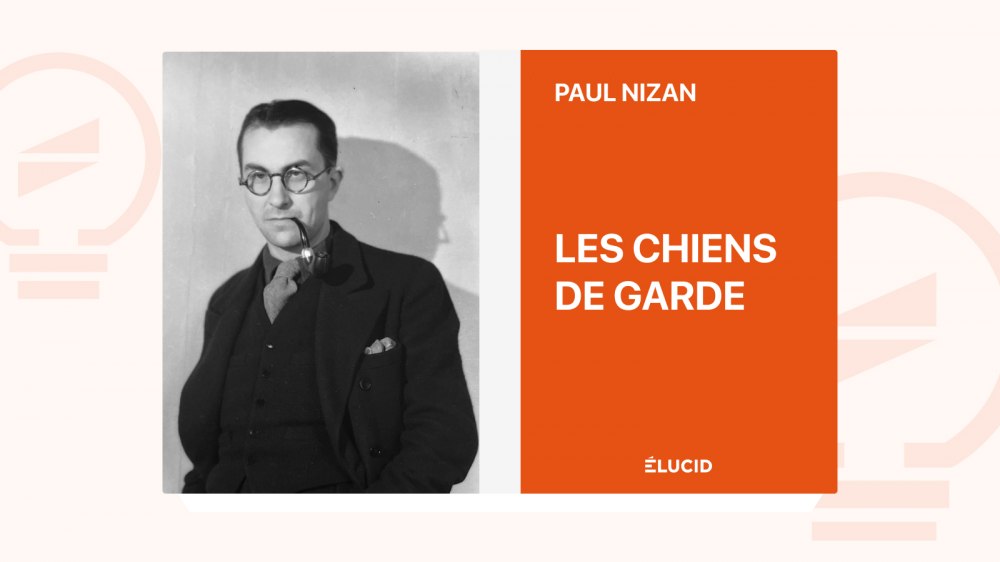
Podcast La synthèse audio
Revendiquant Marx et Lénine, Nizan appelle à dénoncer les illusions prodiguées par les philosophes, et à instituer les premières fondations d’une philosophie révolutionnaire, au service des prolétaires.
Ce qu’il faut retenir :
La Philosophie, bourgeoise, prétend être universelle et univoque et, à ce titre, impose des vérités permanentes pour le bien de l’Homme. Or, il n’existe pas de telles vérités, mais seulement une réalité vécue par les hommes, constituée aujourd’hui par la souffrance des prolétaires. En dépit de sa promesse de travailler pour un monde meilleur, l’écart entre ce que la Philosophie revendique pour l’Homme et ce que l’Homme vit en pratique est immense.
La bourgeoisie pressent cependant que, pour garantir sa domination matérielle, elle doit s’assurer l’adhésion de l’opinion. La Philosophie permet d’obtenir cette adhésion et, pour ce faire, dispose d’un véritable appareil de propagande d’État, représenté par l’Université.
Philosophie ancienne et bourgeoise doit être détruite pour laisser place à une philosophie qui défend véritablement les hommes, une philosophie révolutionnaire qui s’identifie à la classe des opprimés. Cependant, avant la victoire du prolétariat, il faut dénoncer les illusions et les perceptions fausses qui caractérisent la Philosophie bourgeoise.
Biographie de l’auteur
Paul Nizan (1905-1940) est un romancier et un journaliste français. Diplômé de l’ENS en 1929, il passe l’agrégation de philosophie et enseigne un an avant de devenir permanent du Parti communiste en 1932. Il débute, la même année, une carrière de critique littéraire. Il est brièvement journaliste politique pour L’Humanité en 1935. Puis en 1939, lorsqu’est signé le pacte germano-soviétique, il démissionne du PC, ce qui lui vaudra d’être accusé de trahison envers le Parti. Il meurt au combat en 1940, durant l’offensive allemande contre Dunkerque.
Lisez la suite et soutenez un média indépendant sans publicité
S’abonnerAccès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous


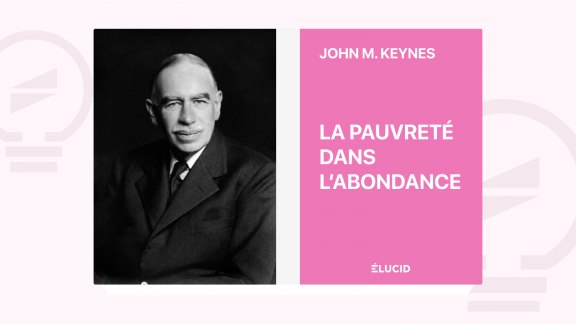

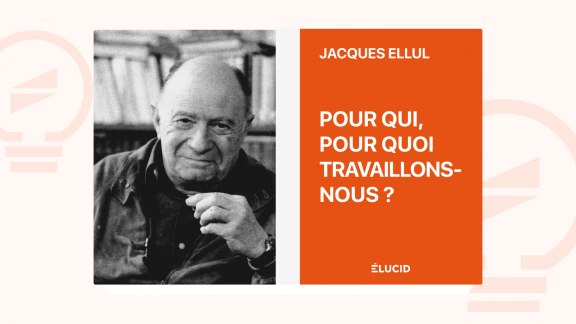

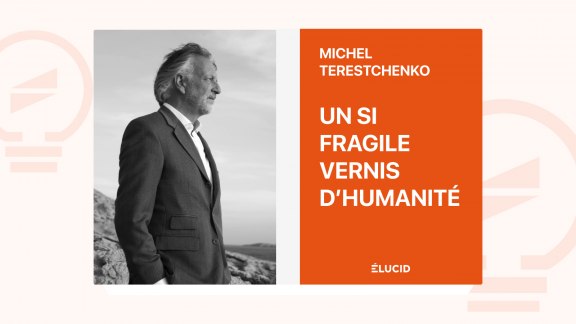
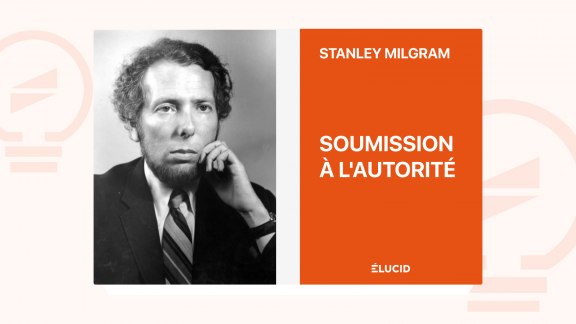
1 commentaire
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.
S'abonner