Pour sa vingtième édition, le dialogue de Shangri-la – le rendez-vous annuel des ministres de la Défense asiatiques et occidentaux à l’hôtel éponyme de Singapour – s’annonçait délicat. En amont du principal forum de sécurité d’Asie, le général Li Shangfu (le ministre de la Défense chinois), rejetait toute possibilité de rencontre bilatérale avec son homologue américain, Lloyd Austin. Cette rebuffade illustre la détérioration des liens entre les deux super puissances. Aujourd’hui, Pékin et Washington ne s’accordent pratiquement que sur un seul point : jamais leurs relations diplomatiques n’ont été si mauvaises depuis leur établissement en 1979.

« Plus nous parlerons, plus nous pourrons éviter les malentendus et les erreurs d’appréciation qui pourraient déboucher sur une crise ou un conflit », lançait innocemment Lloyd Austin, le secrétaire d’État à la Défense des États-Unis, lors de son élocution du 3 juin au dialogue de Shangri-la. Selon les apparences, Lloyd Austin détenait le beau rôle. Mais le refus cinglant du général Li Shangfu de le rencontrer en tête à tête était prévisible. Depuis août 2022, les communications entre les états-majors chinois et américains sont rompues, et ceci à l’initiative de Pékin.
Toutefois, cette rupture fait suite au séjour de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, à Taïwan. En amont de cette visite officielle, dont personne ne niera l’aspect provocateur, Pékin avait prévenu qu’il y aurait des rétorsions. Celles-ci se concrétisèrent par des exercices tactiques d’une ampleur inégalée. L’île « rebelle » au regard de Pékin fut encerclée par la marine chinoise, qui procéda à une répétition grandeur nature et à balles – et missiles – réelles de son éventuelle « libération » selon le point de vue pékinois. En sus, les contacts militaires avec les États-Unis furent interrompus et n’ont pas repris à ce jour.
Provocations partagées
Restons lucide, les torts sont partagés : provocation d’un côté, surréaction de l’autre et vice-versa. Ces gesticulations caractérisent les rapports sino-américains actuels. Parmi les faits marquants, notons la « nanoguerre économique » déclenchée par les États-Unis autour des semi-conducteurs, ces fameuses puces électroniques essentielles à l’industrie. Notons aussi l’épisode calamiteux de la destruction du ballon-espion chinois survolant les États-Unis en février 2023.
Lisez la suite et soutenez un média indépendant sans publicité
S’abonnerAccès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous


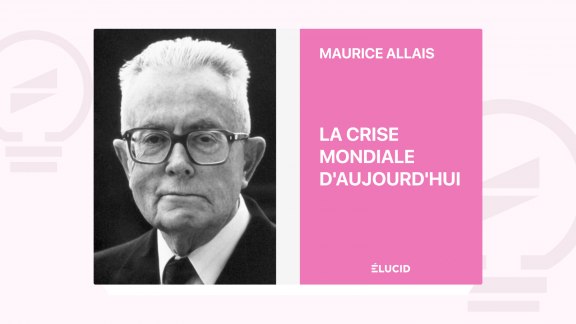
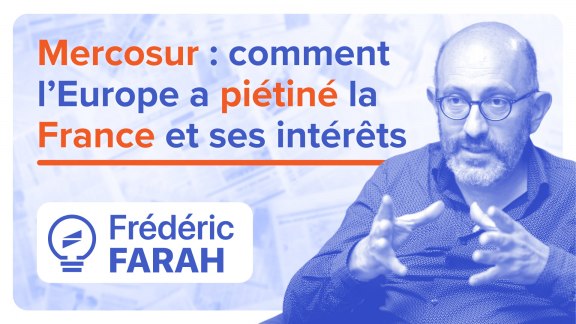


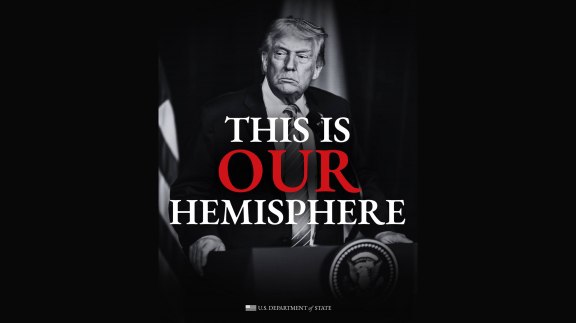

0 commentaire
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.
S'abonner