Dans une tribune publiée dans Le Monde, trois responsables centristes de Normandie ont dénoncé le dumping social qui règne dans le transport maritime, autrement dit, la persistance d’une concurrence déloyale entre les opérateurs du secteur. En effet, en mars 2022, plus de 800 marins de la compagnie britannique P&O Ferries – qui bat pavillon chypriote – ont été licenciés pour être remplacés par des marins dont le coût d’embauche et de rémunération était plus faible. Pire, cette main-d’œuvre ne dispose pas de droits sociaux dignes de ce nom, puisque contrainte à travailler sept jours sur sept pendant quatre mois. Et il s'avère que la compagnie Irish Ferries utilise les mêmes procédés...

Les auteurs de cette tribune insistent très légitimement sur les distorsions de concurrence avec les entreprises françaises du secteur, qui sont placées en situation de désavantage par rapport à leurs concurrents. Plus encore, après avoir déploré le manque de volonté au niveau national pour lutter contre les pratiques du dumping et offrir aux salariés des conditions de travail dignes, ils s'alarment du fait que les révisions des directives européennes en matière de transport maritime ne contiennent pas de dispositifs pour lutter contre pareilles pratiques.
Le texte se termine par le souhait de voir l’Union européenne s’emparer du sujet au plus vite, sans quoi le populisme anti-européen prendrait encore de l’ampleur. Autant le corps de la tribune nous parait juste, autant la fin nous laisse sceptiques devant la naïveté ou le cynisme des auteurs.
La réalité est que le dumping social, loin de constituer une anomalie, est un condensé de ce qu’est l’Union européenne et plus particulièrement depuis 1986. C'est aussi l’illustration jusqu’à la caricature des politiques low cost en matière de travail, dénoncées par Bruno Palier et par le député François Ruffin dans son récent ouvrage.
Le dumping social, une logique si européiste
Dès le début de la construction européenne, la question était posée en raison de l’hétérogénéité des systèmes sociaux à l’œuvre sur le continent, et aussi par le fait que les politiques sociales ne relevaient que des attributs nationaux.
Deux positions étaient concurrentes : la première exigeait une intégration sociale avant l’intégration économique sans quoi la concurrence jouerait négativement contre les travailleurs, et la seconde pensait que l’intégration économique permettrait des gains sociaux. L’un des témoignages de ces tensions de l'époque – pour ne pas dire inquiétudes – se retrouve dans le discours de Pierre Mendès France qui, en 1957, livrait des critiques acerbes contre le marché commun :
Lisez la suite et soutenez un média indépendant sans publicité
S’abonnerAccès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous






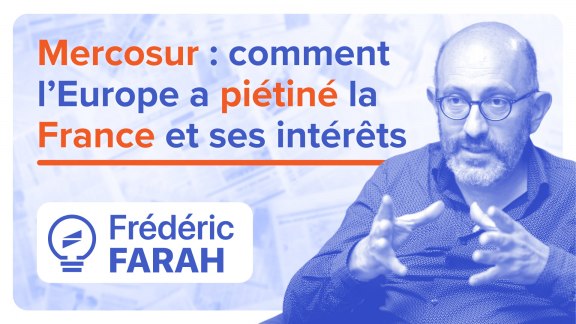

0 commentaire
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.
S'abonner