Jean-Pierre Chevènement nous livre le récit d’une gauche qui n’a pas fait les bons choix. Dans cet entretien inédit réalisé par Olivier Berruyer en 2012, l’ancien homme politique nous raconte comment, entraînée par les tourbillons de la construction européenne, la gauche française a préféré la voie du néolibéralisme.



Abonnement Élucid
Né en 1939, Jean-Pierre Chevènement, ancien élève de l’ENA, a été affilié au PS pendant la majeure partie de sa carrière politique, avant de créer le Mouvement des citoyens (MDC) en 1993 et puis Mouvement républicain et citoyen (MRC) en 2003. Durant cette carrière politique riche, il occupe les fonctions de ministre de la Recherche et de l’Industrie (1981-1983), ministre de l’Éducation nationale (1984-1986), ministre de la Défense (1988-1991) et ministre de l’Intérieur (1997-2000).
Outre ces fonctions ministérielles, il a été élu député du Territoire de Belfort entre 1973 et 2002, avec des interruptions lorsqu’il intègre le gouvernement. Après la fin de son mandat de sénateur, de 2008 à 2014, il cesse d’occuper des fonctions électorales.
Olivier Berruyer (Élucid) : M. Chevènement, quel regard portez-vous sur la crise que nous traversons ?
Jean-Pierre Chevènement : C’est une crise du néolibéralisme — l’Union européenne ayant joué un rôle majeur dans la survenance de celui-ci.
En effet, on a mis en place, au tournant des années 1980-90, une organisation néolibérale qui échappe à la critique parce que l’Europe, au nom de laquelle elle s’est faite, est sacrée. On n’a pas le droit de critiquer cette Europe alors qu’elle est en fait la couverture du néolibéralisme. Cependant, une autre Europe pourrait être imaginée. L’idée européenne mérite mieux que ce qu’on en a fait à travers la construction européenne actuelle.
Un basculement est intervenu très tôt. Lorsque j’étais secrétaire national du Parti socialiste au programme, j’ai préparé le programme « Changer la vie » de 1972 qui a servi de base à la négociation du programme commun. J’ai ensuite écrit en 1979 le projet socialiste dont Mitterrand s’est servi pour définir ses cent dix propositions de 1981. Déjà, nous étions assez loin du texte du projet socialiste. Arrivée au pouvoir, la gauche qui était restée vingt-trois ans dans l’opposition avait une conversion à faire. Elle aurait pu faire une conversion républicaine, mais elle a choisi une conversion libérale : elle a entériné, pour la France et l’Europe, la victoire du néolibéralisme qui avait déjà pris place dans le monde anglo-saxon.
J’ai raconté dans plusieurs livres (La France est-elle finie ? (2011) est le dernier) comment les choses se sont passées de 1981 à 1983. Le ministère des Finances était alors occupé par Jacques Delors et le gouvernement de Pierre Mauroy était à Matignon. Le tournant de mars 1983 a été voulu, préparé et exécuté à Matignon et à Rivoli contre l’intuition de Mitterrand, qui voulait initialement quitter le système monétaire européen.
Dès juin 1981, je lui avais conseillé une forte dévaluation. J’avais pris l’exemple de Pompidou en 1969 pour lui expliquer qu’il fallait donner de l’air à notre industrie et qu’il valait mieux faire une forte dévaluation au départ et ensuite en engranger les bénéfices, plutôt que se trouver réduit à faire de petites dévaluations qui ne rattraperaient pas le haut niveau de l’inflation. C’est exactement ce qui s’est produit : de petites dévaluations. L’inflation était à 13 % en 1980, à 9 % en 1981, puis peu à peu elle a rejoint les 5 %.
O. Berruyer : Quel regard portez-vous, avec une trentaine d’années de recul, sur les mesures prises en 1981 ?
J-P Chevènement : On met beaucoup l’accent sur les erreurs commises, mais la gauche a appliqué son programme. Il y a d’abord eu une certaine distribution de petits « cadeaux » (relèvement du SMIC, des allocations familiales, etc.), entre les élections présidentielles et les législatives. Le budget a été mis en déficit selon une approche keynésienne, mais d’une manière un peu trop précipitée et prématurée par rapport à la reprise mondiale qui ne s’est vraiment manifestée qu’en 1982 aux États-Unis.
Il y a donc eu une erreur de « timing » : c’est une forte relance du budget qui a été opérée. C’était un choix politique. Par exemple, lorsque j’étais ministre de la Recherche et de la Technologie, j’ai vu mes crédits bondir de 17 % environ. Si Mitterrand avait privilégié la recherche et la culture, tous les ministères ont vu leurs moyens augmenter.
« François Mitterrand n’était pas un économiste, mais un très grand politique, un homme d’intuition, de culture. Il n’a pas voulu faire un choix qu’il ne maîtrisait pas complètement sur le plan intellectuel. »
Comment expliquez-vous qu’au bout de deux ans, la gauche ait appliqué le programme de la droite avec ce tournant néolibéral ? L’indice de la libéralisation financière calculé par le FMI montre que la gauche a effectué les deux tiers de la dérégulation dans notre pays...
Le tournant libéral est intervenu sous la pression du cabinet de Pierre Mauroy et de Jacques Delors dans des conditions que j’ai longuement décrites. Le contexte international — Thatcher en Grande-Bretagne, Reagan aux États-Unis — a été déterminant.
François Mitterrand était hésitant. Il était conseillé par Jean Riboud, un de ses amis, industriel et patron de Schlumberger qui avait derrière lui la banque Lazard, et parmi les ministres par Bérégovoy, Fabius et moi-même. Nous ne tenions pas tous le même langage. J’étais pour une sortie, au moins provisoire, du SME (Serpent Monétaire Européen) qui nous permettrait d’engranger une dévaluation de 15 à 20 % et de rattraper notre retard de compétitivité sur l’Allemagne.
Mitterrand a constaté que l’application en était très difficile. Il a demandé à Bérégovoy de devenir Premier ministre pour appliquer cette politique, puis il s’est ravisé ; il l’a finalement proposé à Jacques Delors, qui voulait le ministère de l’Économie et des Finances. Finalement, il s’est rabattu sur Pierre Mauroy qui était déjà Premier ministre depuis 1981.
Ce choix était celui du franc fort. Mitterrand l’avait déjà prôné sous l’influence de Michel Rocard et de Jacques Attali en 1974 lors de sa première campagne présidentielle. Il fallait tenir par rapport au Mark. Mon collègue allemand, Otto von Lambsdorff, me disait en 1982 : « Le système monétaire européen est un système de subvention à l’industrie allemande parce que vous avez une inflation beaucoup plus forte que nous, et par conséquent vous perdez en compétitivité. » On peut tenir aujourd’hui le même raisonnement pour la monnaie unique.
François Mitterrand n’était pas un économiste, mais un très grand politique, un homme d’intuition, de culture. Il n’a pas voulu faire un choix qu’il ne maîtrisait pas complètement sur le plan intellectuel. Il s’est rabattu sur ce que Jacques Delors et Pierre Mauroy lui proposaient avec le soutien de Bruxelles et de la chancellerie allemande. Helmut Kohl avait été élu à peine six mois auparavant.
C’est donc ce concours de force qui explique le tournant dès 1983. Mitterrand était mal à l’aise parce qu’il sentait qu’il devait changer de cap. À la rentrée de septembre 1983 seulement, lors de l’émission de François de Closets « Vive la crise », il a expliqué qu’il fallait faire le choix du profit. On pouvait croire qu’il reprenait l’antienne de Guizot : « Enrichissez-vous ! », mais en oubliant que celui-ci ajoutait « par le travail et par l’épargne », ce qu’on ne dit jamais.
J’avais quitté le gouvernement dès la fin du mois de mars parce qu’en tant que ministre de l’Industrie, je ne voulais pas endosser le tournant libéral. Je savais que le Franc fort allait lourdement peser sur notre industrie. À cette époque déjà, en 1980, le projet socialiste alertait sur la perte d’emplois industriels et les plans sociaux qui se multipliaient. On était au début de la grande phase de désindustrialisation que la France connaît depuis trente ans. Bref, c’était la fin de la « politique industrielle ».
Également, en 1984 avec la loi sur les banques, on a instauré le système de la banque universelle : on ne sépare plus la banque de dépôt, la banque d’affaires, la banque d’investissements, et le trading pour compte propre qui va prospérer par la suite.
C’est un des combats actuels. Qu’en pensez-vous ?
Il aura fallu attendre trente ans pour revenir à la question du modèle de banque universelle. Je pense qu’on va simplement séparer certaines activités considérées comme visiblement « polluantes ». C’est pour ne pas cautionner le projet de loi de 2013 que je me suis abstenu…
« Le choix de l’Acte Unique est le choix de la libéralisation non seulement des biens et des services, mais aussi des mouvements de capitaux. »
Pensez-vous qu’il faille revenir à l’ancienne séparation des activités, par prudence ?
Il est étonnant que la gauche ait instauré en 1984 le modèle de la banque universelle alors que depuis la Libération on avait séparé les banques de dépôts et les banques d’affaires.
Je ne suis pas l’ennemi de l’adaptation en politique. Il fallait recadrer les choses. Une politique d’argent cher pouvait se justifier un temps pour remettre un peu d’ordre. Je voulais qu’on réhabilite l’entreprise, mais aussi l’industrie, que la France reste un grand pays industriel et se diversifie.
Mais, pourquoi avoir ainsi abandonné la politique du crédit sélectif ? Par dogmatisme libéral : les choix effectués à partir de 1983 ont été dans un sens tout à fait différent de la préférence exprimée par un État stratège par le projet socialiste. On n’a pas simplement recadré le système. On a été beaucoup plus loin ; on a dérégulé le système, principalement à travers l’Acte Unique.
À ce sujet, les mémoires de Jacques Delors sont très intéressants et instructifs. Le choix de l’Acte Unique est le choix de la libéralisation non seulement des biens et des services, mais aussi des mouvements de capitaux. Il se traduit à partir du 1er janvier 1990 par une totale libéralisation des mouvements de capitaux, y compris vis-à-vis des pays tiers ; on rentre donc dans un système totalement dérégulé.
Le thème de la désintermédiation bancaire est agité dès 1982, car on veut faire jouer aux marchés financiers le rôle que jouaient les banques sous prétexte que c’est moins cher, que les entreprises pourront se procurer les ressources dont elles ont besoin à meilleur marché, etc. Le MATIF est créé en 1984.
Ce qui ne manque pas de sel après avoir nationalisé les banques en 1981…
Jacques Delors ne fera rien des nationalisations bancaires qui d’ailleurs n’étaient pas nécessaires : les grandes nationalisations bancaires avaient été faites à la Libération. On a nationalisé de nombreuses petites banques régionales. Cela ne répondait à aucune logique économique.
En 1984, Delors devient président de la Commission européenne. En accord avec Kohl et Mitterrand, qui voient l’aspect politique de la chose, il produit le texte de l’Acte Unique qui prône d’aller au bout de la logique du marché commun vers le marché unique en 1992. Plus de trois cents directives ont été prises par la commission de Bruxelles, désormais érigée en gardienne de la concurrence, qui s’affirme dès lors comme un des acteurs principaux du système.
Les dérégulateurs ont toujours agi avec une bonne conscience inaltérable. Beaucoup étaient démocrates-chrétiens. Leur discours pieux déconnectait parfaitement l’économique et le social, et ils étaient sans doute convaincus que l’autorégulation des marchés tendait à favoriser la croissance. Leur dogmatisme libéral sans peur et sans reproche, le tout enrobé de bonne conscience chrétienne moralisante, fait toujours plaisir à voir…
Le système néolibéral n’avait alors plus qu’à se mettre en place : les flux de capitaux étaient libres depuis le 1er janvier 1990, une inégalité fondamentale s’était instaurée entre le travail et le capital. Le capital circule à la vitesse de la lumière, le travail est assigné au local comme le manant l’était à la glèbe. Les banques, les acteurs financiers et les fonds d’investissement ont peu à peu pris le pouvoir et instauré le régime qualifié de « capitalisme patrimonial » par M. Minc. Il s’agit en fait d’un capitalisme actionnarial. Tout cela s’est mis en place dans le courant des années 90.
L’État a vu son rôle se réduire à celui d’accompagnateur ; l’État stratège a disparu. Sa politique ne consistait plus qu’à rendre le territoire national aussi attractif que possible pour les IDE (investissements directs extérieurs). On a ensuite défini des pôles de compétitivité et engagé des politiques de promotion des territoires en concurrence avec d’autres territoires. Un système mondialisé s’est mis en place après l’effondrement de l’URSS en 1991 et la découverte par la Chine du modèle de croissance par l’exportation avec Deng Xiaoping et la libéralisation de son économie. Les inégalités au niveau des coûts de production ont commencé à orienter les investissements.
Propos recueillis par Olivier Berruyer le 19 novembre 2012
Découvrez la suite de cet entretien en cliquant ICI
Photo d’ouverture - Congrès d’Épinal du Parti Socialiste, 8 mai 1981 - Jean-Claude Delmas - @AFP
Cet article est gratuit grâce aux contributions des abonnés !
Pour nous soutenir et avoir accès à tous les contenus, c'est par ici :
S’abonner
Accès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous


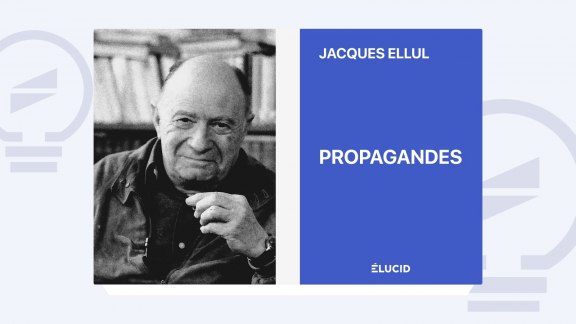





1 commentaire
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.
S'abonner