Tandis que le président français propose une énième refondation du projet européiste, la perplexité s’installe à propos de sa volonté d’étendre à l’Union européenne la dissuasion française ; la Pologne, de son côté, voit son rapport à « l’Europe » changer significativement.

Face aux difficultés de son propre camp, et pour sacrifier une nouvelle fois à son Grand Œuvre, Emmanuel Macron s’est à nouveau livré à un solennel exercice de communication sur le thème de « l’Europe », dans le cadre prestigieux de la Sorbonne – où il s’était déjà exprimé en 2017 peu de temps après son arrivée au pouvoir. Deux heures d’un discours-fleuve, dont les médias ont eu quelques difficultés à retenir des éléments saillants.
Sorbonne bis
Dans ce domaine plus que dans les autres, la parole présidentielle a quelque chose de spectaculaire, sa dimension logorrhéique atteignant des sommets pour masquer le vide où elle se déploie. Peut-être devrait-on voir dans ce discours l’archétype de la communication politique post-moderne, où les mots et les postures, la griserie rhétorique et l’enfermement conceptuel placent à distance un réel trop peu compatible avec l’exaltation idéologique.
Quoi qu’il en soit, avant de tenter d’évoquer le contenu de ce discours, il convient de faire le bilan du précédent : sur quoi les grandes annonces du discours de 2017 ont-elles débouché ? La réponse tient en quatre lettres : rien. Aucun des grands domaines dans lesquels le président a multiplié à l’époque les propositions et les objectifs ambitieux dans l’espoir de « refonder l’Europe » n’a connu de changements notables. Pour ne prendre qu’un exemple caractéristique, « l’armée européenne » évoquée à plusieurs reprises par le chef de l’État a cessé de l’être au bout de quelques années, une fois acquise l’idée de son impossibilité pratique.
Lisez la suite et soutenez un média indépendant sans publicité
S’abonnerAccès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous

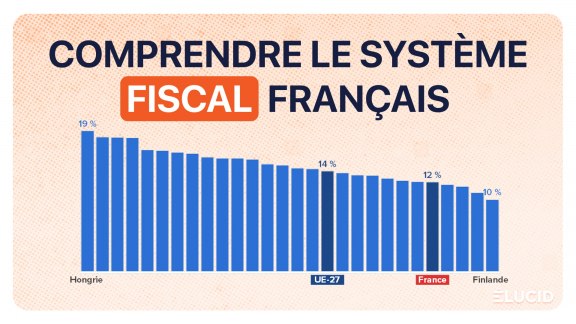






2 commentaires
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.
S'abonner