Tandis que la nouvelle Commission européenne se dote bizarrement d’un poste à la Défense, le Conseil d’État plaide en faveur de la souveraineté nationale contre les empiétements de Bruxelles. Parallèlement, l’espace Schengen est frontalement remis en cause au moment même où, sur un autre plan, le rapport Draghi s'illustre comme un aveu d’échec pour l’Union européenne.

La Commission européenne comprend désormais un commissaire à la Défense. Ainsi en a décidé Ursula von der Leyen sur un mode discrétionnaire, après avoir été reconduite pour un deuxième mandat.
Un commissaire à la Défense au mépris du droit
Une telle nouveauté a quelque chose de spectaculaire, non pas dans sa portée concrète, mais dans ce qu’elle permet de comprendre de la dynamique propre à la construction européenne. En se dotant d’un poste spécifiquement dédié aux questions de Défense, la Commission tente de s’approprier des compétences dans un domaine qui constitue le cœur de la souveraineté des États, un domaine dans lequel l’Union européenne était jusqu’à présent à peu près inexistante.
Ce changement interpelle donc d’abord à ce titre : il témoigne de la volonté des organes communautaires d’accroître toujours davantage leur pouvoir pour peser toujours plus sur des États dont on espère secrètement qu’à terme, dans une optique fédéraliste, ils se trouveront réduits à la sujétion sans même y avoir pris garde. Ce fédéralisme rampant est consubstantiel à la construction européenne. Outre que sa visée ultime – la dépossession souveraine des peuples – est inacceptable, il a ceci de repoussant qu’il progresse en catimini, par discrètes modifications institutionnelles, sans que les peuples concernés soient en mesure d’exprimer leur volonté à ce sujet.
Il faut dire que leur réponse est connue : aucun peuple ne souhaitant son suicide politique – quelle que soit la grande cause censée le motiver –, il est exclu d’obtenir leur accord explicite vers le fédéralisme. Puisque la voie référendaire est impraticable, puisque celle de la modification des traités l’est tout autant, il ne reste plus aux instances bruxelloises que le grignotage de fait.
Lisez la suite et soutenez un média indépendant sans publicité
S’abonnerAccès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous
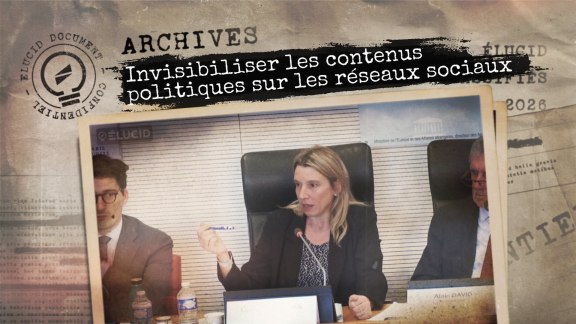

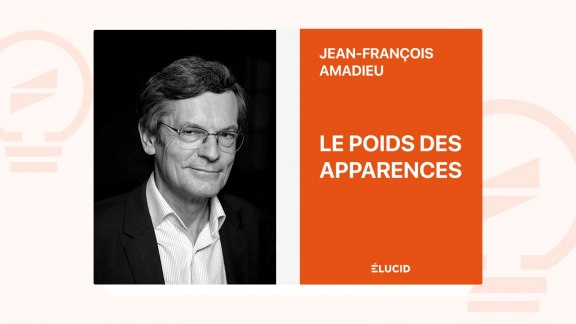
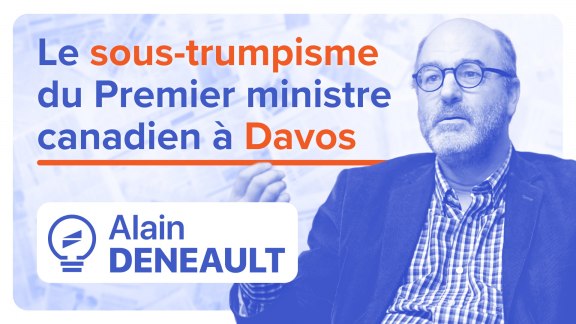


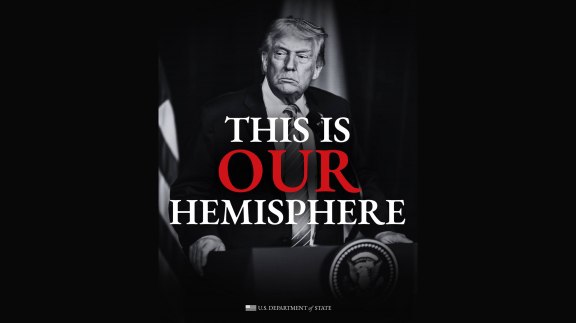

4 commentaires
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.
S'abonner