Le 6 mai 2025, Donald Trump annonçait en fanfare la victoire des forces américaines sur les Houthis, après une campagne de bombardements au Yémen débutée en janvier 2024. Mais comme souvent, lorsqu’il est question de diplomatie trumpienne, les choses s’avèrent en réalité un peu plus compliquées que la seule annonce ne le laisserait entendre. Analyse.

Officiellement, l’affrontement entre les forces américaines et les rebelles Houthis, au Yémen, s’est soldé par une victoire américaine claire et nette. Donald Trump a présenté la fin des combats, actée le 6 mai dernier, comme une « capitulation » des Houthis, qui ne « veulent tout simplement plus se battre ». Et il y a sans doute une part de vrai là-dedans. Les bombardements américains et israéliens sur le Yémen étaient particulièrement lourds depuis la mi-mars, et si les Houthis ont depuis longtemps l’habitude de vivre sous le feu de l’aviation saoudienne, les États-Unis sont un ennemi d’une tout autre ampleur.
L’accord a été annoncé le lendemain même de la dévastation de tout l’aéroport de Sanaa, la capitale du Yémen, par des frappes de missiles israéliens qui ont pu aider à faire pencher la balance.
Mais quelque chose, dans la mise en scène, ne semblait guère convaincant. Ce retrait en toute hâte, faisant immédiatement suite à un satisfecit simpliste de Donald Trump aux airs de méthode Coué, n’a été qu’une pâle et très discrète copie des extravagantes célébrations dont les présidents américains sont coutumiers à la suite de ce qu’ils veulent présenter comme une victoire militaire – qui a oublié la bannière « Mission Accomplished » bien prématurément déployée par George W. Bush en mai 2003, au sujet de la guerre d’Irak ?
La volonté de ne pas s’appesantir sur les raisons du retrait, et encore moins sur le contenu exact de l’accord conclu avec les Houthis était palpable, comme si l’objectif était de passer au plus vite à autre chose et de cacher la poussière sous le tapis.
Lisez la suite et soutenez un média indépendant sans publicité
S’abonnerAccès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous
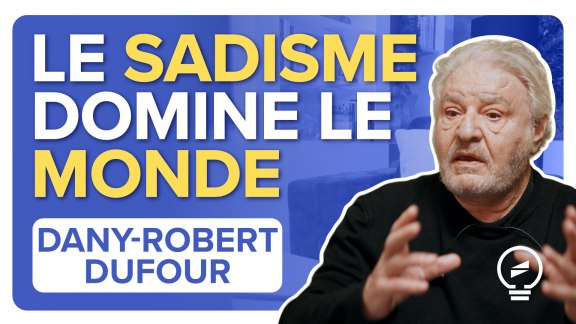
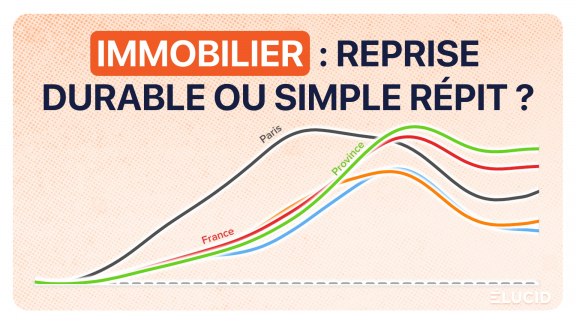
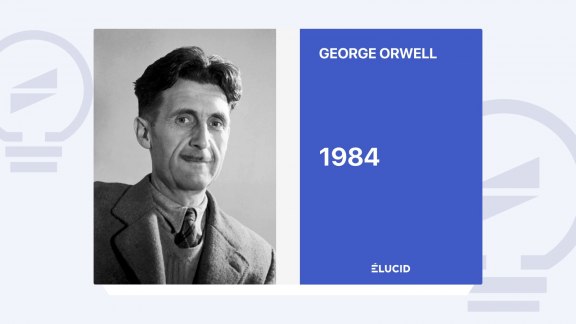


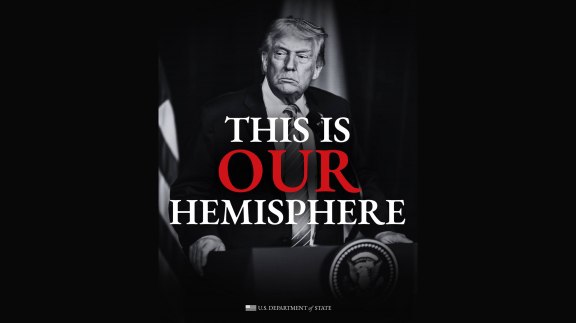

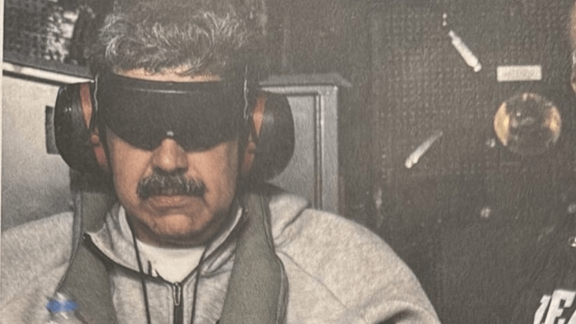
0 commentaire
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.
S'abonner