Le projet critique, qui cherche à explorer l’essence cachée des choses, triomphe en même temps qu’il bute sur ses limites. Le philosophe et juriste Laurent de Sutter, auteur de Superfaible : penser au XXIe siècle aux éditions Flammarion (Climats, 2023), met en lumière la force excessive inhérente à ce projet, la logique mortifère qui l’imprègne et réfléchit à une manière d’en tourner la page en évitant le travers de la critique de la critique.
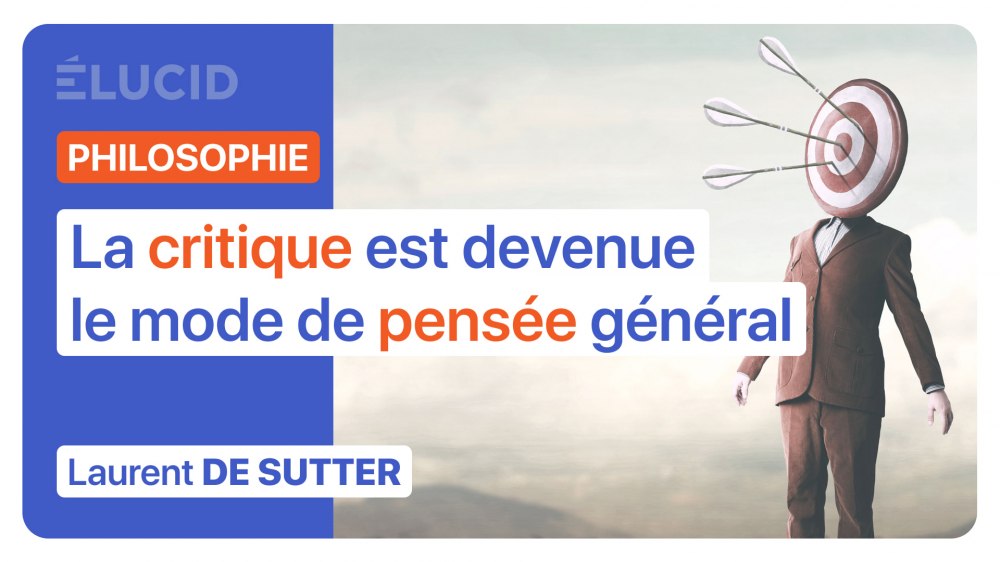
Laurent Ottavi (Élucid) : À quand remonte le projet critique ? Quels chemins et plus précisément quelles lectures vous ont amené à vous intéresser à ce sujet ?
Laurent de Sutter : Le projet critique est né dans la culture occidentale entre la toute fin du XVIe siècle et la fin du XVIIIe siècle. Il est toujours notre actualité et sans doute nous empreigne-t-il encore davantage aujourd’hui que par le passé. Je fais moi-même partie d’une génération qui a grandi intellectuellement avec les instruments hérités de la tradition critique telle qu’elle s’est métamorphosée depuis le XVIIIe siècle sous l’effet notamment de Marx, de l’École de Francfort et de la pensée critique française des années 1960.
Ils ont permis d’ébranler les idées officielles d’une certaine manière, celles de l’université, et tout particulièrement des facultés de droit, des idées du libéralisme des années 1980 représentées par des figures comme Habermas ou Rawls, cherchant à donner une justification théorique à un état des choses politico-moral masquant bien mal les mécanismes de domination et de violence. Il n’empêche que les instruments de la tradition critique, intellectuelle, philosophique, de théorie politique, de théorie morale et d’épistémologie, commencent à ne plus fonctionner aussi bien.
Bruno Latour, dans un article retentissant en anglais et, de manière symptomatique, jamais traduit, décrivait leur puissance et leur force particulières. Les instruments de la tradition critique, expliquait-il, confèrent à celui qui les utilise une puissance démesurée, en l’occurrence la puissance d’avoir toujours raison. Avoir les lunettes critiques signifie exposer un fait, décrire toutes les déterminations externes au fait, qui expliquent que le fait n’est pas du tout un fait, mais le produit de toute une série de processus historiques.
Lisez la suite et soutenez un média indépendant sans publicité
S’abonnerAccès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous


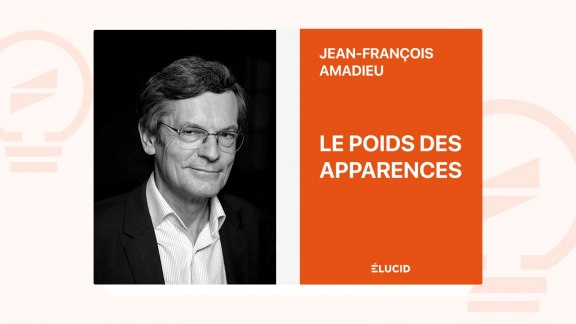
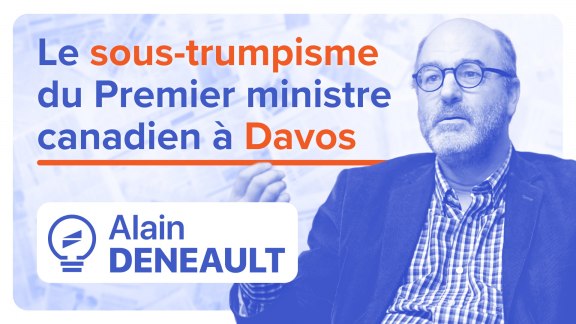

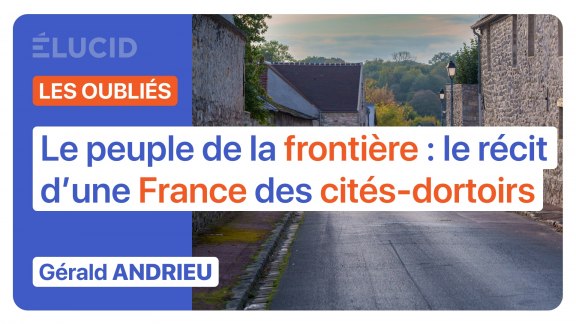

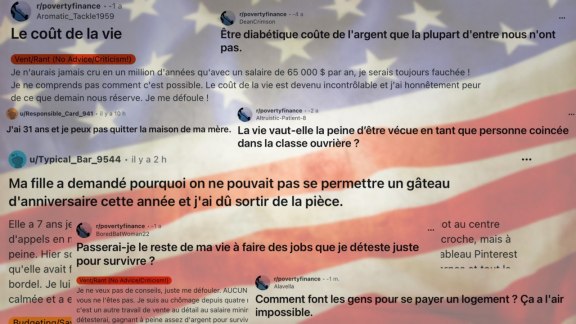
4 commentaires
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.
S'abonner