L’émancipation de la femme telle qu’elle est véhiculée par le néolibéralisme n’en est pas une, car il la soumet aux normes de l’hyper-consommation. La psychologue sociale Marilia Amorim explore la culture contemporaine, dans son livre L’hypermédiatisation de la sexualité féminine (Érès, 2024), à travers le prisme d’un corpus de textes du magazine féminin Marie Claire. Elle y démontre que l’appel incessant à la « transgression » des tabous est surtout un moyen de créer de nouveaux marchés et traduit une haine de la sexualité.



Abonnement Élucid
Laurent Ottavi (Élucid) : Pouvez-vous, dans un premier temps, expliquer quelles ont été la visée et les méthodes que vous avez déployées dans votre ouvrage ?
Marilia Amorim : L’histoire de ce livre commence au Brésil, pays dont je suis originaire. Je suis tombée sur une couverture de Marie Claire dans une salle d’attente de médecin. Quand j’ai lu le titre « Qu’est-ce qu’il se passe dans une soirée sado-maso ? », je me suis dit que c’était typique du Brésil. La sexualisation du corps y est très forte, surtout à Rio, que ce soit par l’exposition de la nudité ou par la chirurgie esthétique. De retour en France, j’ai cependant jeté un coup d’œil dans un kiosque à la couverture de Marie Claire. Et là, je lis : « La saga érotique d’une femme pour atteindre son premier orgasme » ! À chaque numéro, je retrouvais ce genre de titres et je me suis donc dit que cela faisait système. J’ai commencé alors à travailler sur Marie Claire, même si d’autres magazines comme Elle faisaient dans le même esprit.
J’ai une formation de psychologie sociale, mais j’ai petit à petit intégré l’analyse de discours, qui est un champ de la linguistique. Elle me permet d’identifier les stratégies discursives, les formes, les formules, les façons de dire, qui visent à produire certains effets de sens. Avec l’approche dialogique qui est la mienne, qui est issue des auteurs russes du Cercle de Mikhaïl Bakhtine (1875-1975), il est également possible d’identifier les valeurs qui se trouvent en arrière-plan. Après l’analyse, j’en suis venue à interpréter, c’est-à-dire à restituer le corpus de Marie Claire dans le cadre global de la culture contemporaine néolibérale.
Élucid : Vous précisez que la sociologie de Marie Claire est très marquée (bourgeoisie) et vous expliquez avoir constaté seulement après 2013 que le discours du magazine imprégnait d’autres médias. Pourquoi avoir pensé, alors, que ce corpus de textes renseignerait sur la culture contemporaine ?
Marilia Amorim : Dès les premières lignes, on voit que le discours de Marie Claire se revendique comme « transgressif », pour « faire sauter les tabous » au nom de l’émancipation de la femme. Je me suis alors posé la question de la contradiction entre cette volonté et un discours très conservateur en ce qui concerne l’image de la femme. Le grand atout qui lui est prêté est son « pouvoir de séduction », que les pages du magazine invitent à « booster ». La femme est donc appelée à se donner du temps pour cela, à s’occuper de façon obsessionnelle de son corps et, surtout, à acheter des produits miracles. Elle est soumise aux normes de l'hyper-consommation !
Cela m’a nécessairement interpellé par rapport à notre société, par rapport au règne du « marché total » comme le dit Alain Supiot. La lecture du magazine m’évoquait aussi le travail du sociologue et économiste allemand Werner Sombart, auteur en 1912 d’un livre Amour, luxe et capitalisme dans lequel il souligne l’importance des produits de luxe dans les amours clandestines entre grands bourgeois et courtisanes, et leur rôle moteur dans le capitalisme.
J’ai travaillé sur un corpus de textes de 2011 à 2013 de Marie Claire puis j’ai arrêté, car j’avais assez de matière pour ma recherche. J’ai continué à regarder de loin ce que publiait le magazine et il me semble qu’il est moins systématiquement « sexualisé ». J’ai aussi arrêté parce que je constatais que d’autres médias, jusqu’à des journaux d’actualité comme Le Monde, commençaient à être imprégnés par ce même discours.
L’expansion de ce discours vers ce que j’appelle l’hypermédiatisation de la sexualité témoigne à mon sens de l’avancée de la logique néolibérale. Le marché veut être partout et ne supporte pas qu’il y ait une sphère indépendante de la consommation, qui pourrait être l’intimité. Si nous sommes autant espionnés sur nos téléphones et nos ordinateurs, c’est précisément pour chasser toute singularité, et même ce qu’on a de plus intime, pour que personne n’échappe aux offres du marché et pour que le plus grand nombre achète des produits semblables.
« Le discours "transgressif" contemporain évacue l’indicible, l’inconnu, le risque de la sexualité pour la contractualiser et fixer à l’avance ce qu’il faut faire ou ne pas faire. »
Dans les pages de Marie Claire, le sexe est présenté comme positif, rationnel, on pourrait même dire « social-démocrate » pour parler comme Philippe Muray qui a eu des réflexions très proches des vôtres sans toutefois les relier de manière systématique à la question du marché capitaliste. En quoi cela traduit-il une haine du sexe, là aussi une idée que soutenait comme vous Philippe Muray ?
D’autres auteurs, comme Günter Anders et Philippe Muray, ont d’une certaine façon anticipé ces réflexions, mais ils n’ont pas été contemporains comme nous pouvons l’être aujourd’hui de l’empire manifeste du marché. Désormais, la sexualité est objectivée, rationalisée, désubjectivée, technicisée, dénouée de toute sa part d’ombre, de ses contradictions, de ses conflits, au nom de la visibilité et de la transparence.
Il ne peut plus y avoir, dans ces conditions, d’altérité, au sens positif d’altération, impliquant une possibilité de devenir soi-même autre, de rencontrer l’altérité en soi. Il n’y a plus de dimension événementielle de la rencontre. Dans la sexualité, on ne sait ce qui peut apparaître en soi ou chez l’autre. Or, le discours « transgressif » contemporain évacue l’indicible, l’inconnu, le risque de la sexualité pour la contractualiser et fixer à l’avance ce qu’il faut faire ou ne pas faire.
« Le marché rentre par effraction dans l’imaginaire du corps désirant pour essayer de le découper et de le coloniser. »
Quelle part a ce que vous appelez la scientia sexualis dans cette haine du sexe ?
Dans la plupart des dossiers que j’ai analysés, il s’agit de pseudo-experts qui incitent à toujours consulter et consommer. Mais même quand il s’agit de recherches sérieuses, elles sont subtilement détournées vers l’incitation à consommer.
Récemment, l’Institut national de la recherche médicale, des vrais chercheurs donc, ont fait une série d’enquêtes sur la sexualité en général. Le Monde l’a publiée, mais petit à petit, l’enquête est devenue une série avec des épisodes (« la masturbation », etc.) où on n’entendait plus la voix des chercheurs, mais celle des patrons de club échangiste ou de boutique d’accessoires sado-maso. La pseudo-expertise, elle aussi, est mise en avant par les entreprises. J’ai appris récemment qu’il existait une marque spécifique pour les poils pubiens ! Le marché rentre par effraction dans l’imaginaire du corps désirant pour essayer de le découper et de le coloniser.
La sexualité telle qu’elle est présentée ne promeut pas le désir, l’érotisme. Elle est vidée de l’imaginaire du corps désirant : des images qui nous viennent, on ne sait pas d’où, nous traversent, on ne sait pas comment. Ces images ne sont pas forcément articulées et dicibles. Ce sont des fantasmes qui nourrissent l’érotisme et le désir. Or, qui dit fantasme dit singularité, car chacun a les siens. Ainsi, si discours il y a, il s’énonce nécessairement sur une scène singulière, de sujet à sujet – entre copines, entre amants… Ou alors, au niveau collectif, un seul genre discursif peut être véritablement porteur de fantasmes : l’art ! Alors que le genre discursif journalistique est nécessairement factuel et réaliste, car il relève de l’information.
Par exemple, Le Monde, dans sa colonne spécifique sur la sexualité, a publié une liste de « cadeaux coquins » pour Noël. Dedans, vous aviez un cours de masturbation. À côté de cela, l’exposition sur le surréalisme au Centre Pompidou a consacré toute une salle à l’érotisme. On y voit par exemple le tableau de Dali « Visage du grand masturbateur ». C’est du pur fantasme, le corps imagé du désir ! D’autres tableaux dans la salle correspondent à des parties du corps, mais, à travers elles, c’est tout le corps qui est fantasmé. Entre les cours de masturbation et la toile de Dali, il y a un monde !

Vous faites dans le livre le double constat d’une objectivation et d’une banalisation. Comment s’articulent-elles avec la « transgression » telle qu’elle est prônée dans la culture contemporaine ?
Le corps hyper-médiatisé de la femme est morcelé. On découpe la sexualité et le corps sexualisé en parties, en zones ou en gestes (la masturbation, la sodomie, etc.). Il n’y a donc pas de sujet, car le sujet suppose un axe qui totalise le corps. L’objectivation du corps de la femme va de pair avec toute une série de nouvelles normes, c’est pour cela que je parle de transgression normative.
Un dossier de Marie Claire est très emblématique de cette normativation. Il s’intitule « Aimez-vous votre sexe ? » au sens de la partie génitale de la femme avec des articles et des tests qui finissent par pousser à acheter des produits « adéquats ». Une étude de la sociologue Eva Illouz montre la diffusion de l’idéal de la « fente nette », ce qui renvoie évidemment aux chirurgies génitales esthétiques. Bref, la transgression normative crée un nouveau marché pour satisfaire à de nouvelles exigences de « beauté » !
La banalisation permet de son côté d’engager le plus grand monde vers la « transgression ». Des pratiques comme le sado-masochisme impliquent des problématiques pour le sujet. Pourtant, on évacue totalement la question de la subjectivité, on évacue la négativité. Je me rappelle d’un dossier qui s’intitule « Pourquoi on s’interdit encore ça ? » avec en sous-titre « les petits freins du quotidien » qui étaient autant de « tabous à faire sauter ». J’appelle ce genre de dossier des séries coq-à-l’âne. On a dans la liste des « petits freins » : « dîner seule dans un restaurant », « demander une augmentation », « se payer un homme », « ne pas être en couple », etc. « Se payer un homme » n’est quand même pas du même ordre que de dîner seule au restaurant. C’est pourtant ramené au même rang de « petits freins » et ainsi, devenu banal.
« L’ambiguïté, écrivez-vous, est le modus operandi du discours de Marie Claire ». Par quoi est-elle véhiculée et pour quels effets ?
L’ambiguïté est un procédé discursif qui permet de jongler avec la contradiction de fond entre le fait de vouloir se montrer émancipateur et transgressif et le fait d’enchaîner la femme à une image conservatrice d’hyper-consommation. Parmi d’autres procédés que je décris dans le livre, il y a ce que j’appelle le discours verbo-visuel, c’est à dire l’ensemble mots et image. Je prends deux exemples à ce propos. L’un où, par rapport au sujet abordé, la photo dit « oui » et le texte « non », l’autre où le texte dit « oui » et la photo « non », sachant que l’image est plus puissante que le texte.
Dans un article sur le sado-masochisme, par exemple, le texte donne le détail de pratiques, des récits enthousiastes, mais on sent quand même une distance du rédacteur, une pondération. La photo, par contre, qui s’étend sur presque toute une page, est totalement esthétisante, en noir et blanc, un peu flou, glamour et tout sauf réaliste. On ne voit pas un homme qui fouette une femme, ce qui serait violent et pourrait être décourageant, mais une femme élégante avec des habits de l’univers sado-maso, en cuir noir donc, et un collier en perles, car on est avec Marie Claire dans l’univers de la haute classe moyenne. La photo est ainsi valorisante et incitative.
Cas inverse : un article sur la sexualité à 70 ans. Le texte y est favorable, mais la photo est un repoussoir. La photo du couple est prise d’une façon que les corps apparaissent comme débordants et volumineux, en prenant presque toute la place de l’image. Leurs habits ternes ne favorisent aucune sensualité. La femme, totalement dépourvue de coquetterie, a des bigoudis dans les cheveux ! Compte tenu du contexte de la revue qui est très exigeant en matière de beauté, mode, sensualité, etc., on peut identifier un tabou de la revue qui curieusement demeure malgré l’injonction à s’en affranchir.
Vous abordez la place consacrée à l’humanitaire dans le magazine qui n’est pas sans rapport avec la question de l’hypermédiatisation de la sexualité féminine. Quelle place occupe-t-il dans le dispositif inégalitaire du capitalisme et dans les rapports de classe ?
Dans le contexte que j’ai analysé, les publicités pour des produits de luxe s’intercalent avec les reportages dont certains portent sur des femmes vivant dans des situations misérables dans des pays pauvres. L’humanitaire peut être interprété comme une protection contre une éventuelle culpabilité, une sorte d’échappatoire face aux excès de la consommation et le prix exorbitant des produits de luxe. J’y vois une belle illustration du concept freudien de dénégation. Le sujet affirme quelque chose malgré lui alors même qu'il nie.
L’exemple classique donné par Freud est celui d’un homme qui a un fort penchant vers sa mère et qui raconte son rêve avec une femme, en précisant d’emblée « vous allez croire que c’est ma mère, mais ce n’est pas elle !». De la même façon, on identifie ici une dénégation de l’inégalité. En mettant deux photos de grande misère et de publicité de luxe côte à côte sur une double-page de magazine, Marie Claire dit que les deux scènes peuvent aller parfaitement ensemble comme s’il n’y avait aucun rapport entre l’extrême richesse des uns et l’extrême pauvreté des autres. Le discours humanitaire permet ainsi de dépolitiser les choses.
L’homme est aussi réduit à des organes dans la culture contemporaine, a fortiori dans la pornographie, son corps est assimilé à une machine à suréquiper, à rendre performante, le tout au profit de certains marchés (aphrodisiaques, salles de sport, chirurgies, les consultations pour impuissance, etc.). Existe-t-il une spécificité de l’hypermédiatisation de la sexualité féminine par rapport à l’hypermédiatisation de la sexualité masculine ?
On peut effectivement parler de l’hypermédiatisation de la sexualité en général. Néanmoins, il y a une spécificité avec la femme. La sexualité de l’homme est visible. Chez lui, « ça » se voit ! Chez la femme, non. C'est probablement pourquoi on la montre tant. Pour essayer de rendre visible ce qui ne l'est pas. Qu'est-ce qu'elle cache ? Autant dans certains domaines, comme celui du travail de la femme, la visibilité est décisive pour son émancipation, dans le domaine de sa sexualité, la visibilité ne la protège pas nécessairement. N’oublions pas que ce qui n’est pas visible échappe au regard et au contrôle.
La transparence que vise l’hypermédiatisation de la sexualité féminine est une tentative de la soumettre au contrôle et, comme toujours avec le capitalisme, pour des questions de profit ! Regarder et quadriller la femme, c'est déjà ce que montre la gravure de Dürer que j'ai reprise en couverture de mon livre où on voit le peintre tenter de quadriller, au compas et à l'équerre, le désir de la femme.

Propos recueillis par Laurent Ottavi.
Photo d'ouverture : Marie Claire - Novembre 2011
Cet article est gratuit grâce aux contributions des abonnés !
Pour nous soutenir et avoir accès à tous les contenus, c'est par ici :
S’abonner
Accès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous


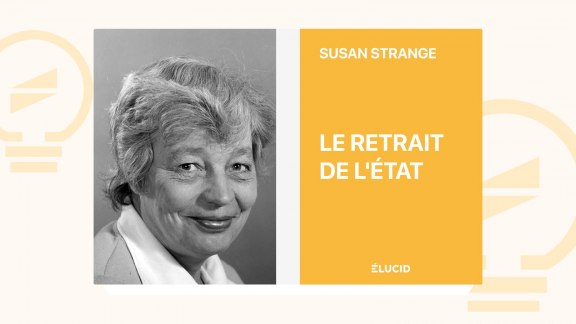
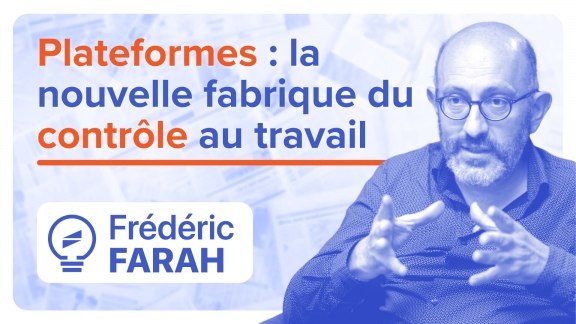

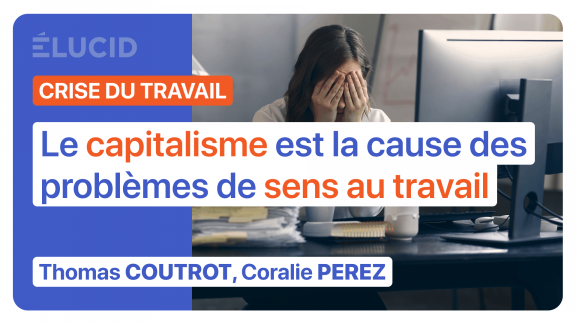

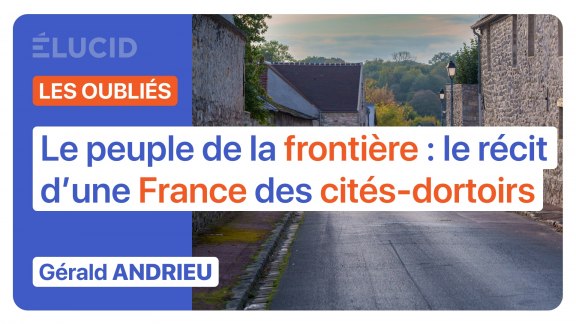
2 commentaires
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.
S'abonner