Il faut sortir de l’idée que la santé est un marché et que la concurrence est forcément bonne. La solidarité nous coûte moins cher que la concurrence. La santé et la qualité de la santé doivent être replacées au centre. Olivier Milleron, cardiologue hospitalier et membre du collectif inter-hôpitaux, co-auteur avec André Grimaldi du Guide des intox sur notre système de santé (Textuel, 2024), décrypte les idées reçues qui se rapportent au système de santé, le vocabulaire qui lui est associé et appelle à un changement d’état d’esprit pour l’améliorer.
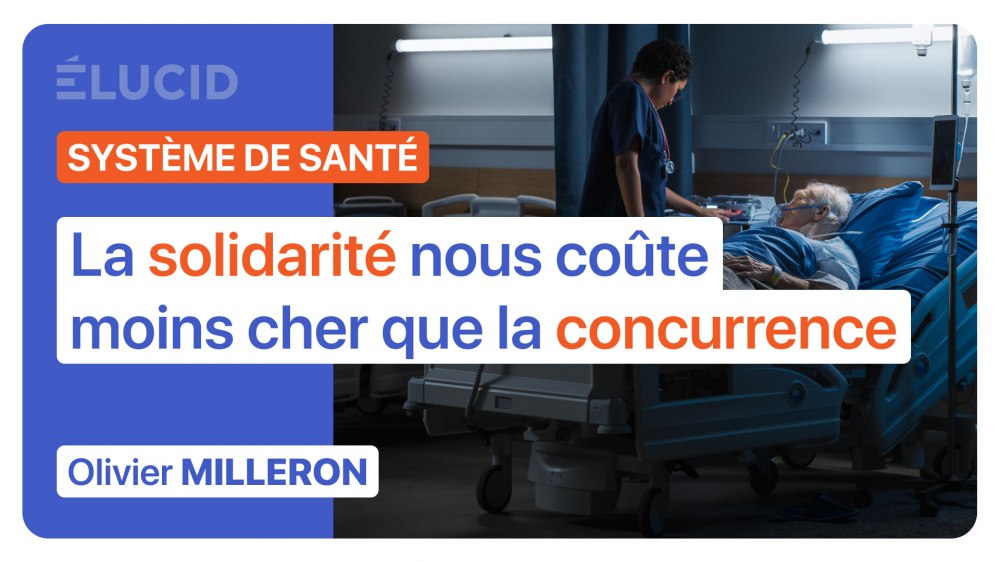
Laurent Ottavi (Élucid) : Les intox sur le système de santé ont-elles été à ce point intégrées qu’il devenait nécessaire de faire une grande clarification ?
Olivier Milleron : J’en suis venu à militer pour notre système de santé assez tardivement, après avoir milité dans d’autres domaines auparavant. J’ai commencé à le faire en 2018-2019 en participant à la création du collectif inter-hôpitaux, dans un contexte où nous n’étions plus en situation de soigner correctement les patients. Ce collectif visait à réunir les usagers et toutes les professions de l’hôpital pour échapper aux corporatismes habituels des syndicats de médecins ou de non-médecins, et même de syndicats de praticiens hospitaliers ou de professeurs, et à la situation d’éclatement des luttes qui en résultait. Nous nous sommes alors aperçus que le fonctionnement du système de santé était mal compris et que ce déficit de compréhension permettait de justifier des réformes éminemment politiques sous couvert de réformes techniques.
Ce livre a pour but de donner aux gens les éléments de compréhension de notre système de santé pour en refaire un sujet politique. Il répond à des questions simples : comment le système de santé fonctionne-t-il ? Comment est-il financé ? Qu’est-ce qu’une cotisation sociale ou une exonération de cotisation ? Etc. Il permet par exemple de contredire le discours selon lequel les riches financent les pauvres et les « assistés ». Quand on regarde qui paie quoi, on se rend compte que les actifs des quartiers populaires financent les retraites et les médicaments des séniors du Var, qui votent massivement pour les candidats… qui veulent détruire notre système de protection sociale !
Lisez la suite et soutenez un média indépendant sans publicité
S’abonnerAccès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous

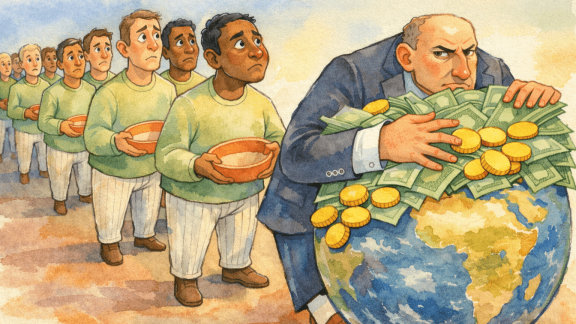
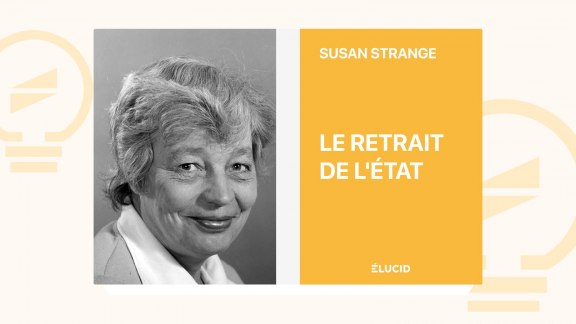


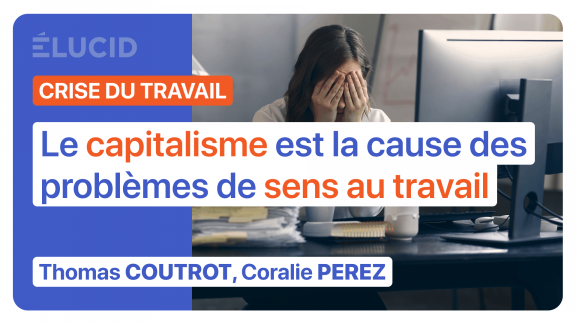

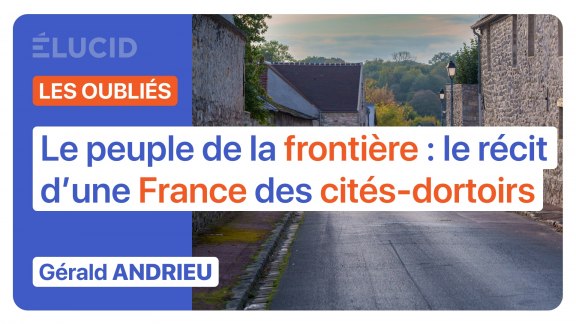
5 commentaires
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.
S'abonner