Depuis le début de l’année 2023, on observe un déclin continu du nombre d’appareils de forage aux États-Unis. Cette situation fait peser un risque sur la sécurité énergétique de l’Europe qui s’est rendue particulièrement dépendante des exportations américaines de pétrole, notamment suite au conflit en Ukraine.

Pourtant, l’avenir du pétrole de schiste américain est des plus incertain du fait des fragilités intrinsèques des techniques d’extraction employées. Réduire notre dépendance aux combustibles fossiles apparaît donc plus que jamais nécessaire pour nous protéger des chocs climatiques et boursiers à venir.
La production de pétrole aux États-Unis provient en majorité du pétrole de schiste qui nécessite, pour être extrait, de forer de manière intensive le sous-sol. En cas de ralentissement de l’activité de forage, la production peut donc arrêter de croître voire entrer en déclin. À cette pyramide de Ponzi énergétique, s’ajoute un impact environnemental et écologique très important. Le bassin Permien émettrait à lui seul 1 million de tonnes de méthane par an, un gaz à effet de serre très puissant, soit l’équivalent de 22 centrales thermique au charbon.
Approvisionnements pétroliers de l’UE : face à l’Ours russe, la tentation américaine
Avec le déclenchement du conflit ukrainien, les pays européens dont la France ont cherché à mettre fin le plus rapidement possible à la dépendance énergétique russe qui, outre le gaz naturel, nous fournissait environ un tiers de nos importations de pétrole brut. Pour cela, l’Union européenne s’est tournée vers les États-Unis et son importante production de pétrole de schiste.
Le 25 mars 2022, le président américain Joe Biden et la présidente de la Commission européenne Ursula Von der Leyen, ont décidé la création d’une « task-Force » conjointe sur la sécurité énergétique. Celle-ci vise principalement « à réduire la dépendance de l'UE vis-à-vis de l'énergie russe, notamment en diversifiant ses approvisionnements ».
Lisez la suite et soutenez un média indépendant sans publicité
S’abonnerAccès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous


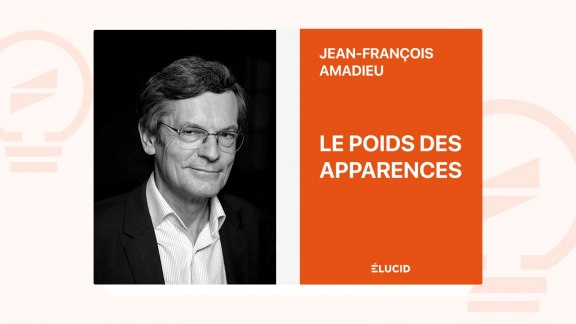





3 commentaires
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.
S'abonner