Éviter les pénuries énergétiques à long terme requiert une profonde remise en cause de nos modes de production et de consommation. Philippe Bihouix, ingénieur, auteur notamment de L’âge des low-tech, vers une civilisation techniquement soutenable (Seuil, 2014) et de Le bonheur était pour demain : les rêveries d’un ingénieur solitaire (Seuil, 2019), soulève les impasses de la « croissance verte » et envisage les contours d’une société soutenable écologiquement.



Abonnement Élucid
Laurent Ottavi (Élucid) : Pouvez-vous présenter votre parcours ? Manque-t-on aujourd’hui de spécialistes dans votre genre pour comprendre les enjeux énergétiques ?
Philippe Bihouix : Je suis ingénieur de formation. J’ai travaillé dans le secteur du bâtiment avant d’exercer une dizaine d’années dans le conseil, où je suis intervenu dans des secteurs industriels comme l’énergie, la chimie, les télécommunications… Puis j’ai rejoint la SNCF, d’abord dans le fret ferroviaire (essentiellement comme directeur international, pendant dix ans) et depuis 2020 chez AREP, agence d’architecture pluridisciplinaire, qui prend depuis 2019, sous l’impulsion de son président Raphaël Ménard, un virage « post-carbone ».
Je ne me définirais pas comme un spécialiste, mais généraliste au contraire, m’intéressant à l’ensemble de la « chaîne de valeur » de notre système industriel, de l’extraction de ressources au traitement des déchets et au recyclage, et aux implications dans les différents secteurs, de la production énergétique au numérique en passant par l’agriculture… Je ne suis pas certain qu’on manque de spécialistes sur ces questions. Toutes les « réponses » sont là, mais elles restent pour l’instant pour la plupart inaudibles, voire indicibles.
« Il n’y a aucune dématérialisation de l’économie, bien au contraire : le besoin en métaux augmente, à l’échelle mondiale, plus rapidement que le produit intérieur brut. »
Élucid : Vous vous opposez à la croyance selon laquelle les technologies vont nous sauver. Cela signifie-t-il que les énergies renouvelables ou un meilleur recyclage ne sont pas le remède à nos maux ?
Philippe Bihouix : Nous vivons dans une ambiance très « techno-solutionniste », pas seulement sur le sujet climatique d’ailleurs. Pensons par exemple à la numérisation de l’école, que l’on nous présentait, sous la présidence de François Hollande, comme la solution à la crise de l’école et l’outil pour « réduire les inégalités » : quelle farce, avec quelques années de recul !
Face aux enjeux environnementaux, nous comptons avant tout sur la production d’énergies renouvelables, l’hydrogène pour le stockage et le transport aérien, l’électrification du parc de véhicules, l’isolation des bâtiments, et, de façon un peu plus prospective, les villes intelligentes (smart cities) optimisées, les véhicules autonomes partagés, la capture et la séquestration du carbone… Pourtant, la course en avant technologique porte en elle autant de problèmes que de « solutions ».
On commence à comprendre que toutes ces technologies consomment des ressources. Il n’y a aucune dématérialisation de l’économie, bien au contraire : le besoin en métaux augmente, à l’échelle mondiale, plus rapidement que le produit intérieur brut. De nombreuses études (OCDE, Banque mondiale, Commission européenne, Agence internationale de l’énergie…) pointent la gigantesque accélération de l’extraction (cuivre, nickel, lithium, cobalt…) qui va être nécessaire pour nourrir la transition énergétique à base d’énergies renouvelables, de dispositifs de stockage, de solutions de mobilité électrique…
Le recyclage peut aider à limiter les besoins ; mais il est difficile de recycler correctement, sans perte de fonctionnalité ou de qualité, du fait de la diversité et de la complexité des usages (alliages, composites, nanomatériaux…) et des quantités infimes de métaux rares impliquées dans des produits et des composants électroniques toujours plus miniaturisés et intégrés – un « simple » smartphone contient ainsi une quarantaine de métaux, de quelques grammes à quelques dixièmes de milligrammes. À l’échelle mondiale, le taux de recyclage de 30 métaux sur 60, dont de nombreux métaux « emblématiques » des nouvelles technologies (terres rares, tantale, gallium, indium, germanium…) est inférieur à 1 % !
Et puis, si certaines technologies semblent intéressantes – toutes choses égales par ailleurs – leurs bénéfices environnementaux réels sont loin d’être évidents : les voitures autonomes réclament le déploiement d’infrastructures numériques (réseaux télécoms 5G voire 6G – attendue pour 2030… –, datacenters pour les calculs et le stockage des données) qui commencent par consommer beaucoup d’électricité pour leur fonctionnement (et de ressources pour leur fabrication), avant qu’on puisse déceler un quelconque avantage environnemental grâce à des services transformés ou de nouvelles pratiques. Le système digital mondial (équipements personnels, réseaux, datacenters) consomme déjà plus de 10 % de l’électricité et émet de l’ordre d’un milliard de tonnes de CO2 par an – nettement plus que le transport aérien d’avant la crise sanitaire.
Par ailleurs, l’efficacité technologique est souvent annihilée, au moins partiellement, par l’effet rebond (ou paradoxe de Jevons) : chaque produit ou service devient plus économe unitairement, mais il devient aussi moins cher donc plus accessible, on se met alors à en consommer davantage : globalement la « facture » environnementale continue à s’alourdir. Les voitures aux moteurs plus optimisés sont ainsi toujours plus lourdes, le volume de données digitales augmente plus vite que le gain d’efficacité des réseaux et des datacenters, les turboréacteurs moins gourmands en kérosène ont permis l’essor de l’aviation low-cost, les nouvelles lignes de train à grande vitesse ne vident pas les avions, mais provoquent de nouveaux déplacements…
« Avec 2 % d’énergie supplémentaire (qu’elle soit ou non renouvelable) utilisée chaque année, il faudrait disposer dans 1550 ans de la puissance totale de l’étoile solaire… »
Plus généralement, cela signifie-t-il que la croissance "verte" est un non-sens ?
C’est une absurdité, oui. Continuer à croître « quoiqu’il en coûte », tout en divisant par quatre ou six nos émissions de gaz à effet de serre, en réduisant la consommation de ressources non renouvelables et les pollutions engendrées, relève d’un véritable tour de force. Les économistes convoquent pour cela le deus ex machina du découplage entre croissance économique et consommation d’énergies fossiles et de ressources – un concept pas si nouveau.
Dès la fin des années 1930, l’architecte Richard Buckminster Fuller parlait d’ephemeralization, nommant ainsi le fait d’utiliser toujours moins de matières premières pour rendre des services équivalents ou meilleurs. Il prenait l’exemple des ondes radio remplaçant les câbles en cuivre du télégraphe, aujourd’hui nos économistes prennent celui de la fibre optique en verre qui remplace le câble de cuivre. « L’économie de la connaissance » deviendrait ainsi moins matérielle.
Hélas, les chiffres sont moins éloquents : on constate un certain découplage relatif entre le produit intérieur brut et la consommation d’énergie ou les émissions de CO2, mais c’est un découplage absolu qu’il faut obtenir : que le PIB croisse tandis que les émissions diminuent. Quand le découplage à l’échelle d’un pays semble fonctionner, comme en France, c’est que des activités polluantes ont été délocalisées et que les émissions de CO2 sont désormais « importées ».
Comment imaginer, de toute façon, une croissance « pérenne » sur le long terme ? Il est simple de montrer que le fonctionnement « accélérationniste » de notre économie – la croissance ou la mort – est absurde, une trajectoire exponentielle intenable. Souvenons-nous du doublement des contaminations au Covid-19 tous les cinq jours, au plus fort de la crise : il ne faut pas très longtemps pour arriver à des chiffres affolants (et au confinement forcé). De la même manière – mais plus lentement – un taux de croissance de 2 % implique un doublement tous les 37 ans et donc une multiplication par… 390 millions tous les millénaires ! Avec 2 % d’énergie (qu’elle soit ou non renouvelable) supplémentaire chaque année, il faudrait disposer, dans 1550 ans, de la puissance totale de l’étoile solaire.
Sans découplage, la croissance indéfinie des économistes tourne à la farce ou à la science-fiction. Mais peut-on découpler à ce point ? Serons-nous, dans mille ans, un milliard de fois plus « efficaces » énergétiquement qu’aujourd’hui ? J’en doute. La conclusion qui s’impose, physique, mathématique, est que la croissance prendra fin bien avant. Reste à savoir quand, comment, sous quelle forme, dans quel état sera la planète et quelles seront les conséquences humaines et sociales.
Si rien n’est fait pour contrecarrer la tendance, se dirige-t-on vers des pénuries ?
Indéniablement oui, puisque nous surexploitons les ressources renouvelables (comme les forêts, les pêcheries) ou que nous « puisons » dans le « stock » de ressources non renouvelables, certes immense, mais par nature limité. Ce « stock » ne fonctionne pas comme quand on pioche des yaourts dans le réfrigérateur et qu’on tombe à sec brutalement avant les courses salvatrices du week-end : ici, le réfrigérateur se remplit en même temps qu’on le vide, car les « réserves » (le stock), qui sont des ressources géologiques identifiées et qu’on peut extraire au prix actuel et avec la technologie actuelle, évoluent à mesure que ces paramètres bougent.
Il y a plus de pétrole « disponible » à 80 $ qu’à 40 $ le baril, comme il y a plus de cuivre « disponible » à 8 000 $ qu’à 4 000 $ la tonne. L’innovation technologique permet de traiter des ressources moins accessibles, dans des zones plus reculées, des gisements plus profonds, de moindre qualité, et de maintenir ou faire grandir la quantité de réserves disponibles, malgré l’extraction qui en est faite chaque année ; mais souvent au prix d’un impact environnemental accru, et les gains technologiques auront des limites physiques…
Si à long terme l’évolution semble inéluctable, à court terme c’est donc moins évident. Il ne faut d’ailleurs pas prendre les tensions actuelles sur les matières premières comme autant de signaux faibles d’une future « grande pénurie », tant les causes en sont diverses. Le manque soudain de semi-conducteurs, qui a partiellement bloqué l’industrie automobile, n’est pas lié à un manque de silicium, mais à une concentration de la production (due aux investissements monumentaux nécessaires à mesure que la finesse de gravure des microprocesseurs évolue) combinée à la forte reprise de la demande.
La hausse des prix des matières premières minières et agricoles ou de certains produits industriels (acier…), accentuée par la guerre en Ukraine, a pu venir d’abord, selon les cas, de la baisse des stocks des industriels en 2020 et de la forte reprise de l’économie en 2021, de la désorganisation du commerce maritime mondial augmentant les temps de transport, d’inquiétudes et spéculations diverses, d’effets « systémiques » (en cascade) – comme la hausse du prix du gaz, donc des engrais nitratés, donc des céréales…
« La démarche low-tech, c’est d’orienter l’innovation vers une réduction effective de l’empreinte environnementale, en misant, quand c’est pertinent, sur la simplicité contre l’inflation technologique. »
Qu’appelez-vous les « low tech » et en quoi permettraient-elles de résoudre la question de la production ?
« Résoudre » peut-être pas, mais du moins amoindrir notre problème de dépendance aux ressources et gagner, sans doute, en résilience (un mot très à la mode depuis la crise sanitaire) face aux chocs qui ne manqueront pas d’advenir. L’idée de la démarche low-tech, c’est d’orienter l’innovation vers une réduction effective de l’empreinte environnementale, en misant, quand c’est pertinent, sur la simplicité contre l’inflation technologique, mais aussi sur les dimensions sociales, culturelles, organisationnelles de l’innovation. D’abord grâce à la sobriété (un concept qui, lui aussi, vient de faire une entrée fracassante dans le débat public !) et la réduction des besoins à la source.
Il ne s’agit pas ici d’empiler les « petits gestes » ou quelques mesures emblématiques comme sur la publicité nocturne, mais bien de revoir en profondeur nos modes de production et de consommation, de mettre en œuvre de véritables évolutions sociétales : suppression de la plupart des emballages et des objets jetables ou « inutiles » – non « essentiels » – (supports publicitaires, eau en bouteille…) ; sortie progressive de la « civilisation de la voiture », en soutenant les innovations sur les deux-roues, en poursuivant le développement des transports en commun, en baissant progressivement le poids, la puissance et la vitesse maximale des véhicules ; réduction des besoins de constructions neuves en intensifiant l’usage du bâti existant et inversant la tendance à la décohabitation, pour concentrer les moyens techniques et financiers sur la réhabilitation et la rénovation ; baisse des températures en réapprenant l’usage des vêtements chauds en hiver ; limitation de la quantité de données numériques…
Ensuite grâce à une éco-conception « poussée » au maximum, permettant d’augmenter considérablement la durée de vie et la réparabilité des objets et d’optimiser les taux de recyclage des ressources. Schématiquement, la production pourrait être de deux types : les consommables (savons, lessives, produits médicaux et hospitaliers, peintures, etc.), par nature non recyclables, qui seraient de plus en plus biosourcés (issus de matières renouvelables) et conçus pour avoir un impact environnemental très faible en fin de vie (biodégradabilité ou gestion très précise des déchets) ; les produits « durables », de simples outils du quotidien aux infrastructures, en passant par les machines, les équipements, les véhicules, les bâtiments, qu’il s’agirait de faire durer, maintenir, réparer, adapter en les considérant comme un patrimoine, un stock de matières premières.
Enfin, en faisant preuve de « techno-discernement », en employant les hautes technologies et les précieuses ressources qu’elles embarquent uniquement dans des usages où leur intérêt est indéniable, ou leur avantage environnemental est démontrable. Ce serait l’occasion de réfléchir à la place du travail humain, alors qu’on parle d’une quantité toujours plus grande d’emplois qui pourraient être, dans un relativement proche avenir, remplacés par des robots, des drones ou des logiciels d’intelligence artificielle…
Quels changements de société et d’organisation des pouvoirs ces low-tech impliquent ou exigent-elles ?
Si vous voulez me faire dire qu’une société sobre et « durable », d’un point de vue environnemental, est incompatible avec la croissance et donc le système capitaliste mondialisé tel que nous le connaissons aujourd’hui, je ne peux que confirmer eu égard aux considérations précédemment évoquées. Mais que faire d’une telle affirmation ? Prendre le « combat contre le capitalisme » comme point de départ de la transition, c’est, me semble-t-il, aborder cette dernière par la face nord…
Au-delà de la posture, je suivrais plutôt Olivier Rey (auteur, entre autres, du formidable Une question de taille) en examinant l’échelle à laquelle on pose le problème : êtes-vous pour ou contre la concurrence et la libre entreprise ? Vous n’aurez peut-être pas la même réponse selon qu’on parle de boulangeries ou de centrales nucléaires.
Comment faire advenir ce système de « post-croissance » (et de plein emploi) ? Je pense qu’au-delà de l’engagement citoyen, associatif, militant, la puissance publique pourrait favoriser et accompagner les profonds changements nécessaires. À l’échelle de l’État qui dispose, grâce aux leviers normatifs et réglementaires – certes pas toujours simple à manier, potentiellement vus comme technocratiques, voire « liberticides » –, aux choix fiscaux (baisser le coût du travail humain, renchérir celui des ressources et des pollutions, mettre en place des mécanismes d’ajustement aux frontières pour protéger les productions locales à hauts standards sociaux et environnementaux…). À toutes les échelles, jusqu’aux collectivités territoriales, grâce au pouvoir prescriptif (les cahiers des charges des produits et services achetés) et au soutien local aux initiatives qui surgissent partout et peuvent être multipliées, amplifiées, généralisées.
« Alors qu’on appelle les populations à la sobriété et qu’on leur parle d’économie de guerre, milliardaires, dirigeants de grandes entreprises et membres du gouvernement continuent à se promener allégrement en jet privé… Cela devient insupportable. »
Pouvez-vous donner un aperçu de ce que serait cette société décroissante ? Quels transports, quels habitats, quelles manières de subvenir à ses besoins, quelle place pour le numérique ?
C’est une société qui consommerait moins de matières et d’énergie, qui produirait moins de déchets, de pollution, de gaz à effet de serre, de perte de biodiversité… Une société qui prendrait les sujets « à la source » : prévention en médecine et en alimentation, politique de « démobilité » et d’(a) ménagement du territoire… ; qui mettrait vraiment la sobriété au cœur de ses choix sociétaux : moins de viande, mais de meilleure qualité et n’utilisant pas du soja du bout du monde, moins de produits transformés, (bien) moins de fast food et fast fashion…
Dans le numérique, elle devrait arrêter la course au « toujours plus »… aujourd’hui on empile des réseaux et des datacenters supplémentaires pour se retrouver dans les (futurs) métavers, pour regarder des vidéos haute-résolution dont le nombre de couleurs, le nombre d’images par seconde, le nombre de pixels par cm2 dépassent la capacité de l’œil et du cerveau humain…
D’une manière générale, il ne s’agirait pas tant de renoncer à des « produits » que de les faire durer plus, de les changer moins souvent : smartphones, ordinateurs, vêtements, meubles, bâtiments, machines agricoles et industrielles… Le patrimoine existant est énorme. Des matières premières, des produits agricoles et industriels continueraient à être échangés, mais différemment d’aujourd’hui, où tomates, acier, pièces automobiles sillonnent l’Europe dans tous les sens… Une partie de la production serait relocalisée, en particulier les produits « essentiels », du quotidien, assez « faciles » à produire : vêtements, outillages, vélos, petits véhicules, électroménager, savons et produits d’entretien, certains médicaments et produits hospitaliers…
S’il existait une sérieuse volonté politique, serait-il encore temps d’opérer les changements que vous évoquez ? Pensez-vous que nous devrons passer inévitablement par des temps difficiles pour enfin agir dans le bon sens ?
Il n’est, de mon point de vue, jamais trop tard. Malgré le coup parti du changement climatique, nous pourrions être surpris par les capacités de rebond de la biosphère et des écosystèmes locaux. Mais aussi par l’engouement potentiel et la capacité de compréhension de nos concitoyens, si on arrêtait de les prendre pour des abrutis et de les matraquer de messages et de signaux contradictoires.
Les « temps difficiles » sont évidemment des moments privilégiés pour bousculer les habitudes, amorcer les changements de paradigme, renverser des croyances stupidement ancrées – à une petite échelle, la crise sanitaire l’a montré récemment, avec la pratique du vélo, le télétravail, l’argent gratuit (pour l’hôpital et d’autres) finalement disponible, les limites des ratios d’endettement balayées…
À condition toutefois que les « élites » se montrent exemplaires. Nous en sommes bien loin aujourd’hui : alors qu’on appelle les populations à la sobriété et qu’on leur parle d’économie de guerre, milliardaires, dirigeants de grandes entreprises et membres du gouvernement continuent à se promener allégrement en jet privé… Cela devient insupportable et, pour être honnête, je les trouve très imprudents ! En ces temps de restrictions et de pénuries potentielles, le commun des mortels ne supportera peut-être plus très longtemps ces petites fantaisies : tant pis pour ceux qui ne le comprendront pas assez vite.
Propos recueillis par Laurent Ottavi.
Cet article est gratuit grâce aux contributions des abonnés !
Pour nous soutenir et avoir accès à tous les contenus, c'est par ici :
S’abonner
Accès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous

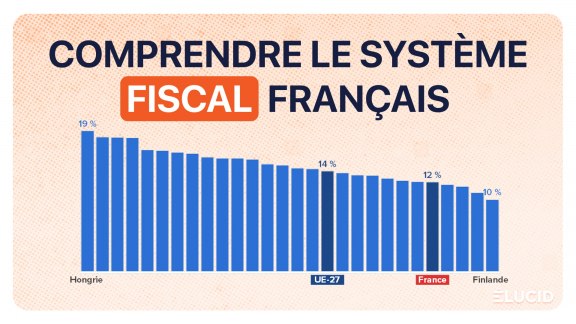






3 commentaires
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.
S'abonner