L’immobilier, le pilier central sur lequel repose la croissance chinoise, montre des signes de craquelures, sinon des crevasses profondes qui seraient à même d’emporter tout l’édifice. L’une d’elles se dénomme Evergrande, un conglomérat dont les dettes dépassent les 300 milliards de dollars. Sa faillite pourrait générer un « moment Lehman Brothers », l’instant de panique où les investisseurs perdent pied, déclenchant ainsi un remake de la crise financière de 2008. Le responsable est tout trouvé : c’est le président Xi Jinping lui-même qui aurait ouvert la boîte de Pandore.

Démesure, c’est le mot qui vient à l’esprit lorsque l’on emprunte l’un des gros ferries qui s’engouffrent par grappe de six dans les écluses du barrage des trois gorges (2,3 km de longueur). Les vannes se referment, l’eau monte d’une vingtaine de mètres, un sas s’ouvre sur l’écluse suivante. Cinq écluses et quatre heures plus tard, le ferry est enfin libre.
– « Vous avez des barrages aussi grands en France ? » taquine une jeune Chinoise.
– « Euh non, cela ne risque pas. »
Devant nous s’étale le lac de retenue, quelque 640 km jusqu’à Chongqing, approximativement la distance entre Paris et… Stuttgart. La démesure de la Chine vous éclate à la figure ; il a fallu 13 ans pour construire cet ouvrage pharaonique qui a englouti 13 villes, 4 500 villages et 162 sites archéologiques. Accessoirement, plus de 1,3 million de personnes furent déplacées. Nous étions alors en 2006, l’époque révolue d’une mondialisation heureuse qui suscitait les espoirs et convoitises d’un Occident attiré par la croissance à deux chiffres de l’Atelier du monde.
Un bien immobilier, sinon rien
C’est peu d’écrire que le secteur de la construction est au cœur de l’économie chinoise, c’est la pierre angulaire d’un développement reposant sur un modèle purement industriel. En chiffres, il représente entre 25 et 30 % du PIB de la Chine. En 2008, alors que les vagues destructrices de la crise américaine des subprimes déferlaient sur le monde, Pékin ne ferla pas ses voiles pour affronter la tempête. Au contraire, le pouvoir chinois les déploya en injectant 4 000 milliards de yuans (512 milliards d’euros) dans son économie. Cette débauche de crédits et d’investissements, spécialement dans les infrastructures, a permis à l’économie chinoise de croître de +8,7 % en 2009, puis de +10,4 % en 2010, entraînant à sa suite le reste du monde. La Chine asseyait alors sa position enviée de « locomotive de l’économie mondiale ».
Lisez la suite et soutenez un média indépendant sans publicité
S’abonnerAccès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous

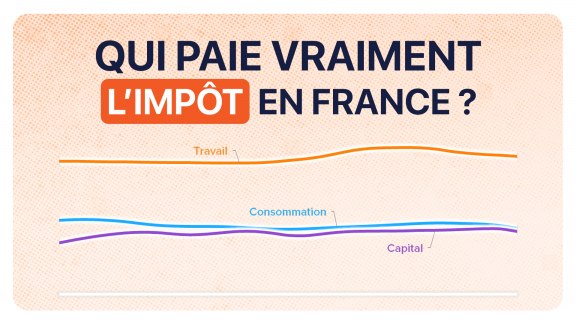


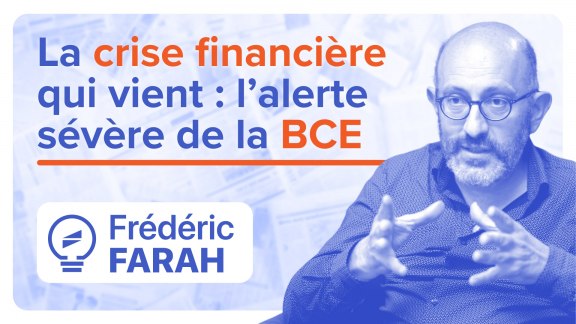

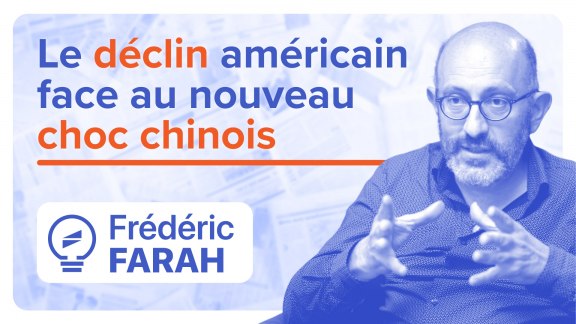

1 commentaire
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.
S'abonner