50 ans que les déficits publics s’enchaînent. Résultat : 3 000 milliards de dette publique dans un contexte social dégradé et désormais, de taux d’intérêt élevés. L’exécutif ne parvient pas à réduire la dépense publique, malgré le démantèlement progressif et méthodique de la protection sociale à la française, au mépris de la dignité des plus faibles, stigmatisés, et de plus en plus contrôlés et surveillés. Dans son grand plan de lutte contre les fraudes, le gouvernement met le paquet sur la fraude aux prestations sociales (2,8 milliards d'euros), qui est pourtant environ trois fois moindre que celle aux cotisations sociales des employeurs (8 milliards d'euros), et au moins 30 fois moindre que la fraude fiscale (80 à 100 milliards d'euros) ! Quant au discours politique sur la traque aux ultrariches et aux grandes multinationales, en face, les actes s’annoncent déjà parfaitement insuffisants...

Cinq décennies. Voilà 50 années, sans exception, que l’État français n’a pas su boucler son budget. Depuis 1974, la France enchaîne les déficits publics de plus en plus lourds (aggravés par la crise de 2008 et à des niveaux historiques depuis la crise Covid), alors que les crises économiques et financières sont de plus en plus violentes.
Résultat, en 2023, la dette de l’Hexagone contractée via les marchés financiers (c'est-à-dire la somme des déficits publics), a dépassé les 3 000 milliards d’euros — soit 2 000 milliards de plus qu’il y a seulement 20 ans. La cocotte-minute siffle, alors que le monde occidental redécouvre l’inflation et avec elle, les taux d’intérêt élevés. Dès 2027, le remboursement de la dette redeviendra le premier poste de dépenses de l’État (74,4 milliards d’euros) devant l'Éducation...


Réduire la dépense publique au maximum, mais sans trop de colère sociale !
Mais alors, que faire pour enrayer la machine infernale de la dette ? Le problème réside essentiellement dans le fait que la France a perdu, au fil de ces décennies, la maîtrise de son destin. Dans un système globalisé et interdépendant où le crédit est au cœur de toute la mécanique, le gouvernement – quel que soit son orientation politique – est en réalité pris en étau entre la Banque centrale européenne (BCE) qui a la main sur sa politique monétaire, et les puissantes agences de ratings internationales qui, par leurs notations (1) et perspectives en matière de solvabilité, imposent de fait la politique budgétaire à suivre en Europe, et a fortiori en France.
Lisez la suite et soutenez un média indépendant sans publicité
S’abonnerAccès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous


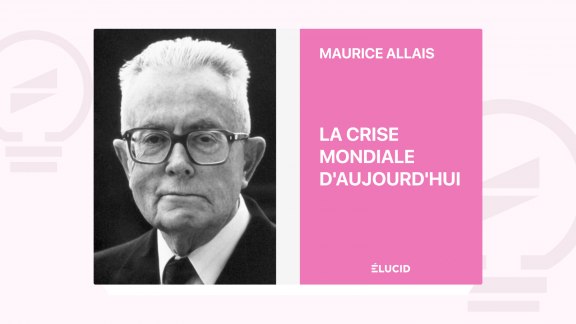

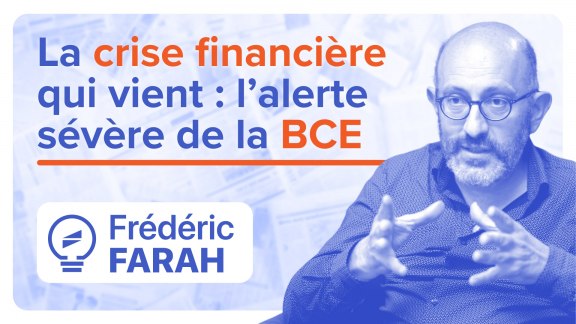

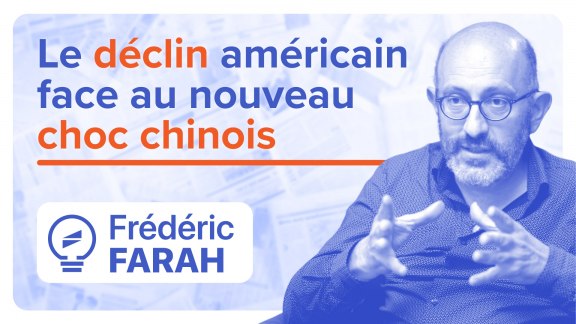

1 commentaire
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.
S'abonner