Pour l'ancien insider de la Commission Trilatérale, les mécanismes d'accumulation de liquidités ont pour une large part provoqué le cataclysme de la crise financière. Dans cet entretien exclusif réalisé par Olivier Berruyer en 2013, Hervé de Carmoy, fin connaisseur du milieu bancaire, analyse les dérives du système financier.

Hervé de Carmoy (1937 -) est un ancien dirigeant de banque. Il a été, entre autres, Directeur général pour l’Europe de la Chase Manhattan Bank NA (1963-1978), Directeur général à la Midland Bank PLC Londres et Président de Thomas Cook PLC (1978-1988). Il a également été Président de la Section française de la Commission Trilatérale (1989-2004), organisation privée créée en 1973 et regroupant diverses personnalités (hommes d’affaires, hommes politiques, décideurs, etc.).
Olivier Berruyer (Élucid) : M. de Carmoy, quel regard portez-vous sur la crise économique que nous traversons ?
Hervé de Carmoy : Selon moi, la crise est liée à l’accumulation de capital dans d’immenses proportions – des trillions de dollars pour la Chine, le Japon et les pays pétroliers d’Afrique du Nord ou les Émirats en ce qui concerne le capital liquide. Dans ces pays, les sommes disponibles et non investies sont colossales. Les États, devant la baisse des taux d’intérêts provoqués par cette masse d’argent, augmentent leur endettement. À partir du moment où cet argent est disponible à des taux faibles, cela permet de financer les dépenses au lieu de financer l’investissement.
Les États-Unis, par exemple, ont ainsi déboursé beaucoup plus que par le passé pour leurs dépenses militaires. Ils ont également sauvé certaines banques dépensant des montants énormes, de l’ordre de centaines de milliards de dollars. Ils ont aussi accordé des facilités à d’autres segments de la population. La France n’a pas fait différemment. Elle a augmenté ses dépenses considérablement. Tous les pays l’ont fait. La disponibilité des liquidités a explosé et la baisse des taux en est l’explication.
Lisez la suite et soutenez un média indépendant sans publicité
S’abonnerAccès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous


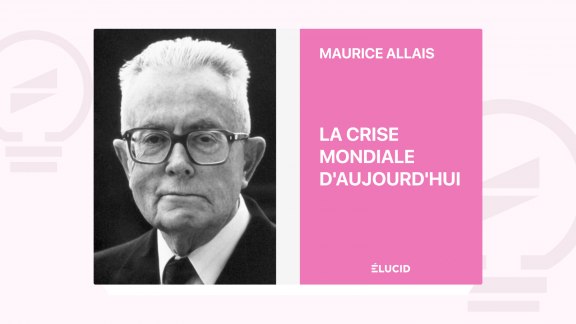

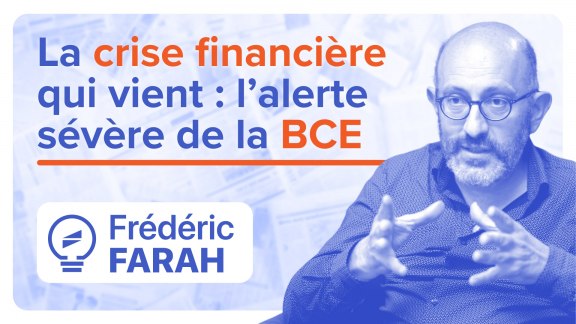

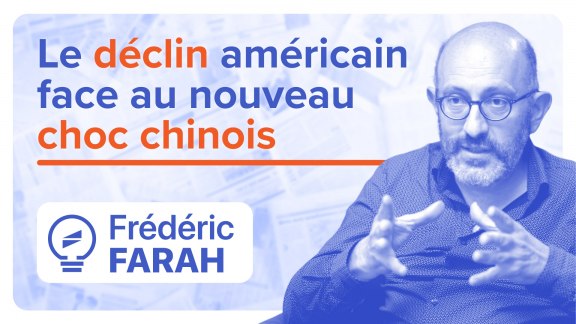

0 commentaire
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.
S'abonner