En estampillant leurs produits « neutres en carbone » ou « zéro émission », les entreprises laissent croire que leurs activités ne sont pas émettrices de gaz à effet de serre. Elles séduisent ainsi des consommateurs de plus en plus concernés par la cause climatique.

Ce tour de passe-passe est permis grâce au détournement du marché carbone à leur profit. Certaines entreprises s’achètent ainsi une pseudo-virginité écologique grâce aux « crédits carbone ». Or, une récente enquête montre que 95 % des crédits carbone vendus par le principal certificateur mondial n’ont aucun effet sur la réduction des émissions responsables du réchauffement climatique.
Les crédits carbone ne contribuent pas positivement au climat. Pire, la somme de ceux liés à la reforestation correspond à des engagements qui demandent deux fois plus de terres qu’il en existe sur terre à l’horizon 2050... Avec ces méthodes, les entreprises diffusent un écran de fumée qui masque leur manque d’implication dans la réduction effective de leurs émissions carbone.
Ces agissements participent au record des émissions de 2022, en hausse de 1 % par rapport à 2021, et sont en profond décalage avec la trajectoire attendue pour parvenir au zéro émission nette en 2050. Or, la décarbonation des processus de fabrication des entreprises est indispensable pour rester en dessous des +2 °C, voire des +1,5 °C de l'Accord de Paris. En l’état, l’ONU anticipe plutôt un réchauffement de l’ordre de +2,8 °C.
Développer sols et forêts : un levier pour atteindre la neutralité carbone
Commençons par un rappel essentiel : le réchauffement climatique est dû à l’accumulation de gaz à effet de serre (GES) dans l’atmosphère, et la combustion des énergies fossiles en est le principal responsable.
À côté des transports, du chauffage de l’électricité et des industries qui émettent des GES dans l'atmosphère, les puits de carbone – essentiellement les océans et les sols via la photosynthèse – prélèvent du carbone dans l'atmosphère et le stockent. Le changement d’usage des sols – en transformant prairies ou forêts en sols agricoles ou artificialisés via la construction de parkings, bâtiments, etc. – les fait passer de puits à sources d’émissions.
Lisez la suite et soutenez un média indépendant sans publicité
S’abonnerAccès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous
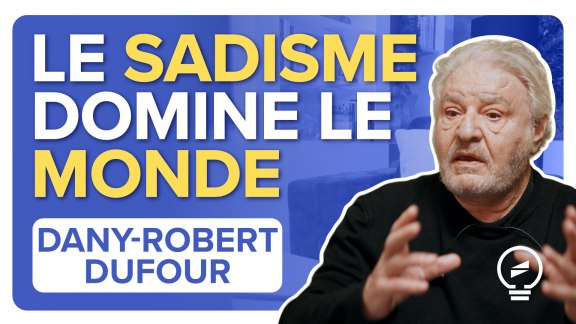

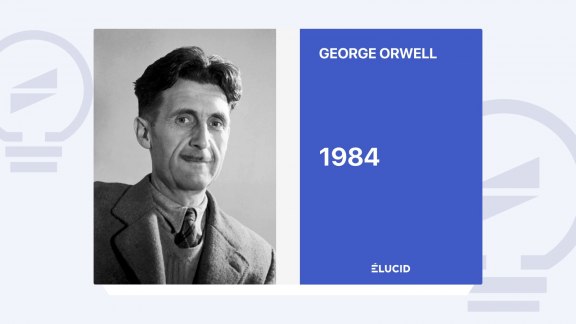





3 commentaires
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.
S'abonner