Le tourisme, porté par la dissolution des liens communautaires et une illusion de choix, est la première industrie au monde. Henri Mora, auteur de Désastres touristiques (L’Échappée, 2022), détaille ses effets écologiques, politiques, économiques et sociaux. Il s’élève également contre les distinctions entre bons et mauvais tourisme qui, pour lui, constituent un leurre.

Laurent Ottavi (Élucid) : Vous contestez dans votre livre la pertinence des oppositions, fréquentes, entre touriste et voyageur d’une part, et entre tourisme de masse et tourisme tout court de l’autre. Pourquoi cela ?
Henri Mora : Je réfute en effet les a priori tenant à séparer le bon grain de l’ivraie touristique. Par cette distinction, certains espèrent échapper à la représentation stéréotypée du touriste moutonnier et agaçant que l’on moque et que l’on méprise en général. Ceux-là considèrent échapper à l'image du voyageur organisé, bruyant, mal fagoté, son smartphone à la main, irrespectueux des lieux qu’il visite et de ses habitants, etc. Il n’y a pas de fumée sans feu, et de telles caricatures existent sûrement. Je souligne simplement que l'industrie touristique de masse s'organise pour profiter de chaque type de voyageur, aussi vertueux et marginaux soient-ils.
L’augmentation du pouvoir d’achat a contribué à développer le tourisme. Et l’industrie touristique draine touristes et voyageurs, leurs économies en poche, vers des lieux et des territoires préalablement aménagés pour les attirer. De plus, les pratiques alternatives entraînent souvent le voyageur à utiliser les infrastructures routières, ferroviaires, aéroportuaires et maritimes mises en place pour développer un tourisme sans distinction. Combien de voyageurs n’ont jamais utilisé de guides touristiques numériques ou papiers, des applications et des sites Internet pour bénéficier de services administratifs cartographiques, météorologiques ou de réservation ?
Lisez la suite et soutenez un média indépendant sans publicité
S’abonnerAccès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous


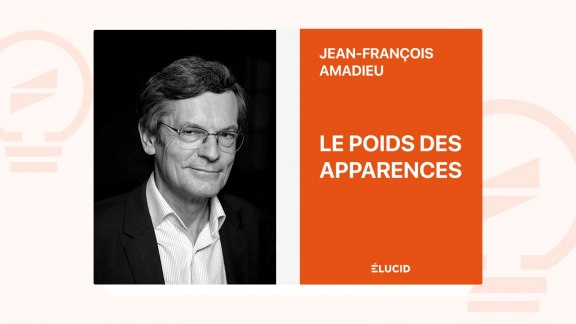
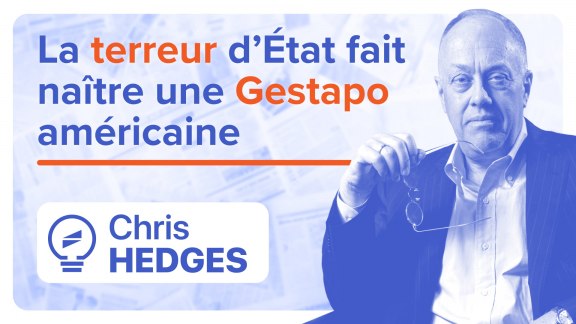




0 commentaire
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.
S'abonner