Dans la nuit du 2 au 3 janvier 2026, les forces armées américaines ont bombardé plusieurs cibles au Venezuela pour couvrir une opération qui a résulté en la capture du président vénézuélien, Nicolás Maduro, et de son épouse Cilia Flores. Point culminant de plusieurs mois de tensions entre les deux États, cet enlèvement d’un chef d’État en exercice endommage encore un peu plus le respect d’un droit international ouvertement méprisé par les États-Unis, et plonge le Venezuela dans l’incertitude.



Abonnement Élucid
« Les cons, ça ose tout, c’est même à ça qu’on les reconnaît », écrivait Michel Audiard, remaniant au goût de son époque une remarque de Saint Thomas d’Aquin. À l’heure où le monde entier est bouche bée devant le rapt, en pleine nuit, de Nicolás Maduro par l’armée américaine – du presque jamais vu dans les relations internationales (1) – le président américain Donald Trump représente sans doute l’illustration contemporaine la plus flagrante de cette sentence sans appel.
L’opération américaine menée dans la nuit du 2 au 3 janvier s’est soldée par l’enlèvement pur et simple du président en exercice du Venezuela. Après des mois passés à couler des navires censés transporter de la drogue en mer des Caraïbes, à parquer des navires de guerre au large des côtes vénézuéliennes, et à souffler le chaud et le froid dans des négociations avec un Nicolás Maduro de plus en plus ouvertement qualifié de « narco-terroriste » et présenté, à en croire l’administration Trump, comme le responsable de tous les maux liés à la drogue sur le territoire américain, Washington a finalement dévoilé ses véritables intentions.
Derrière le récit américain dépeignant Maduro comme une sorte de baron de la drogue inondant les États-Unis de substances toxiques, personne ne se fait d’illusions sur les raisons réelles de cette attaque. Le Venezuela est, du point de vue de Washington, coupable d’une triple faute : être un État latino-américain dirigé par un gouvernement de gauche ; refuser de se soumettre aux caprices des États-Unis ; et disposer d’immenses réserves de pétrole – à un moment où les États-Unis, par nécessité, cherchent à sécuriser de nouvelles sources d’approvisionnement, leurs propres ressources en hydrocarbures rentables à extraire s’épuisant à une vitesse inquiétante.
Washington a appliqué l'une de ses recettes classiques, maintes et maintes fois éprouvée pendant de la Guerre froide : provoquer ouvertement l’État ciblé, le faire passer pour l’agresseur, et intervenir « défensivement » pour le décapiter et le transformer en serviteur des intérêts de la Maison-Blanche. Au cours des 80 dernières années, les États-Unis ont procédé à des dizaines de « changements de régime », d’invasions et autres opérations hostiles à l’égard de nombreux États d’Amérique latine.

En vertu de la doctrine Monroe, récemment réactivée par Donald Trump, les États latino-américains ne sont rien de plus que des pions qui n’ont d’autre choix que de rester dans le giron de Washington pour servir les intérêts de la Maison-Blanche, faute de quoi les États-Unis s’empressent de « corriger » leur trajectoire politique. Lorsque Donald Trump énonce, aussitôt l’opération terminée, que les compagnies pétrolières américaines vont prendre le contrôle des champs pétroliers vénézuéliens, qui aurait la naïveté d’imaginer un seul instant que le citoyen vénézuélien moyen verra sa vie s’améliorer en conséquence ?
Et surtout, que va-t-il se passer à présent ? Les États-Unis semblent avoir l’intention de contrôler le pays, au moins pendant un temps. Comment vont-ils procéder ? À l’heure actuelle, ils n’ont aucune présence militaire significative sur le territoire vénézuélien, en dehors des agents au sol qui devaient certainement être présents pour que l’enlèvement de Maduro et de son épouse puisse s’effectuer. L’incertitude plane ; les prochains jours seront déterminants.
Un pas de plus vers l’obsolescence des normes impératives de droit international
Les États-Unis ont certes depuis longtemps habitué le monde au spectacle de leur respect à géométrie variable des normes de droit international censées régir la conduite des nations les unes envers les autres. Mais avec cette dernière démonstration, ils ont dépassé certaines bornes que même eux n’ont pas l’habitude de franchir.
L’interdiction du recours à la force entre États souverains, pilier de tout l’ordre juridique international depuis 1945 ? Les États-Unis en ont une interprétation connue pour être remarquablement large. Forts de leur possession de l’arme nucléaire, de leur siège au Conseil de sécurité des Nations unies et plus généralement de leur conviction d’être les personnages principaux de l’Histoire contemporaine, les responsables américains sont habitués à l’ignorer superbement, se réfugiant derrière leurs « intérêts vitaux », et se fatiguant encore quelquefois à arguer d’une prétendue « légitime défense » contre les pays qu’ils bombardent sans vergogne.
Et s’il est indéniable que le caractère démocratique du régime politique contrôlé par le président Maduro était devenu particulièrement douteux, surtout après les dernières élections de 2024 à la suite desquelles Maduro est resté au pouvoir en dépit de la victoire de son adversaire, il n’y a pas d’exception pour les « dictatures » à l’interdiction édictée par le droit international d’utiliser la force contre un État souverain. Car même en écartant l’épineuse question de la définition de ce qu’est au juste une dictature, si l'on considère que la dictature est mauvaise par essence, alors tous les dictateurs sont mauvais et il est du devoir de chaque individu qui raisonne ainsi d’œuvrer pour leur chute – ce qui n’est certainement pas de nature à assurer la paix et la stabilité de la communauté internationale.

On peut le regretter, mais bien rares sont ceux qui, dans les faits, abhorrent toutes les dictatures. Bien rares sont ceux qui, en Occident et notamment parmi les individus qui jubilent devant le rapt d’un chef d’État et de son épouse, s’opposent avec la même ferveur aux monarchies du Golfe ou autres régimes autoritaires « occidentalo-compatibles ». Or, dès que l'on accepte l’idée qu’un dictateur est plus tolérable qu’un autre, l’idéal du « combat pour la démocratie » est irrémédiablement perdu – ne restent plus alors que de bas calculs politiques bien indignes d’être célébrés.
Par leurs actes dans la nuit du 2 au 3 janvier 2026, les États-Unis ont allègrement piétiné le droit international avec la même désinvolture que la Russie lorsqu’elle a décidé d’envahir l’Ukraine. À vrai dire, en un sens, c’est même bien pire : l’interdiction de l’usage de la force peut être assortie d’exceptions – strictement encadrées – en cas de légitime défense, et la Russie n’a pas manqué d’en invoquer une dans le cadre de son action, se présentant comme agissant en réaction à une agression ukrainienne. Même si ce narratif n’a aucun véritable ancrage dans la réalité, Moscou avait au moins fait l’effort de maintenir les apparences, de se draper du manteau du droit international tout en le déchirant.
Mais l’immunité conférée aux chefs d’État en exercice par le droit international, quant à elle, immunité dont bénéficiait Maduro, ne tolère aucune exception – peu importe si ce chef d’État dispose ou non de la moindre légitimité démocratique. Cette absence de distinction coupe l’herbe sous le pied de l’argumentaire américain selon lequel Nicolás Maduro n’est qu’un chef d’État de facto, et non de jure, auquel cette immunité ne s’appliquerait pas. En réalité, le droit international ne prend pas cette distinction en compte.
Inscrite dans plusieurs textes de droit international à valeur impérative, cette immunité est l’héritière d’une coutume millénaire de respect de la personne de l’adversaire en toutes circonstances. Faire la guerre ? Soit, mais sans se massacrer lors de rencontres diplomatiques, et sans se prendre les uns les autres en otage. En jetant cette règle-là aux orties avec une telle désinvolture, l’administration Trump se rabaisse elle-même au rang d’un ramassis de vulgaires barbares.
Et c’est bien dans la barbarie que ce genre de mise au rebut du droit international risque de faire retomber l’humanité entière. L’ordre juridique international contemporain a été bâti sur les ruines laissées par la Seconde Guerre mondiale et sur l’horreur inspirée par ce conflit. Il est né d’une volonté de privilégier la règle de droit sur la loi du plus fort, car la loi du plus fort, dans son expression la plus pure, n’entraîne que chaos et désolation. Mais 1945 est désormais bien loin, et le monde a oublié ce qui lui pend au nez, le jour où les États cesseront d’accorder une importance même symbolique aux normes du droit international pour agir comme bon leur semble en faisant fi des conséquences. Et en particulier, si s’en prendre aux chefs d’État devient une pratique courante, alors Donald Trump, l’un des chefs d’État les plus détestés au monde, jusque parmi ses plus proches alliés, risque fort de regretter d’avoir montré l’exemple.
Un comportement de mafieux provoquant un embarras généralisé
Aussi diplomatiquement isolé qu’ait été Nicolás Maduro en tant que dirigeant autoritaire d’un régime d’inspiration marxiste dans un monde encore très imprégné des dichotomies héritées de la Guerre froide, son enlèvement par les forces américaines, en pleine nuit – et qui fait immédiatement suite à un bombardement non provoqué ayant servi de vulgaire diversion au mépris de ses victimes civiles – semble avoir laissé un arrière-goût désagréable dans la bouche des dirigeants mondiaux, y compris ceux que de basses considérations politiques poussent à se réjouir pour flatter l’ego d’un Donald Trump en roue libre. D’autant plus que l’administration américaine n’a pas traîné pour menacer d’autres dirigeants de pays latino-américains « ennemis » de les enlever à leur tour. Une attitude méprisable, plus digne de la mafia que de la première puissance mondiale.
Sans surprise, c’est en Amérique latine que les réactions ont été les plus contrastées, entre l’indignation de nombreux États tels que Cuba, la Colombie, le Mexique et le Brésil, atterrés de voir les États-Unis retomber dans leurs pires travers, et le triomphalisme écœurant d’un Javier Milei toujours prompt à lécher les bottes de ses maîtres – d’autant plus qu’il est parfaitement conscient de la précarité de sa situation si Washington venait à laisser tomber l’Argentine. De manière générale, sur le continent, les réactions ont largement dépendu de l’orientation politique des gouvernements au pouvoir : tous les gouvernements de droite, complètement inféodés aux intérêts de Washington, ont exprimé leur satisfaction, souvent sans un mot pour la règle de droit.
Le reste du monde a très largement condamné l’opération américaine, ouvertement qualifiée de violation flagrante du droit international. Le continent asiatique, en particulier, était à peu près unanime sur la question, allant de la condamnation franche et massive à de prudents appels à la retenue et à une solution négociée, à l’exception notable du Japon et de la Corée du Sud, qui dépendent de l’assistance militaire américaine et qui doivent veiller à caresser Washington dans le sens du poil. Sans oublier bien sûr Israël, un État qui n’éprouve plus la moindre trace de honte à contribuer de façon constante à piétiner le droit international.
Enfin, malheureusement sans surprise, c’est encore une fois l’Europe qui a fait montre de la plus grande lâcheté. La gêne des dirigeants européens est palpable, de même que leur absence totale de coordination. Le résultat est qu’ils ont tenté de dire tout et son contraire. Il fallait à la fois se montrer satisfait de la chute de Maduro, tout en veillant à manifester une certaine désapprobation pour ne pas perdre encore un peu plus en crédibilité en ne soutenant le droit international que lorsque cela nous arrange, quitte à ce que le résultat soit une cacophonie sans queue ni tête. Pire encore, au fil des heures, alors que les chancelleries ont pu enfin se concerter, les réactions européennes se sont faites de plus en plus serviles envers Washington, abandonnant peu à peu toute référence au droit international.
La palme de la honte revient toutefois au président français Emmanuel Macron, le seul chef d’État de l’Union européenne à s’être félicité du « départ » de Maduro sans même faire mention de l’attaque américaine, ni du droit international, ni de la nécessité de faire preuve de retenue, comme si le président vénézuélien s’était soudainement volatilisé.

Son commentaire a suscité une levée de boucliers dans la classe politique française, à tel point qu’il a été forcé de faire machine arrière le 5 janvier. Distinction plus piteuse encore, il est le seul chef d’État dont les propos sur la question ont été à la fois repris par Trump lui-même et condamnés officiellement par le gouvernement du Venezuela.
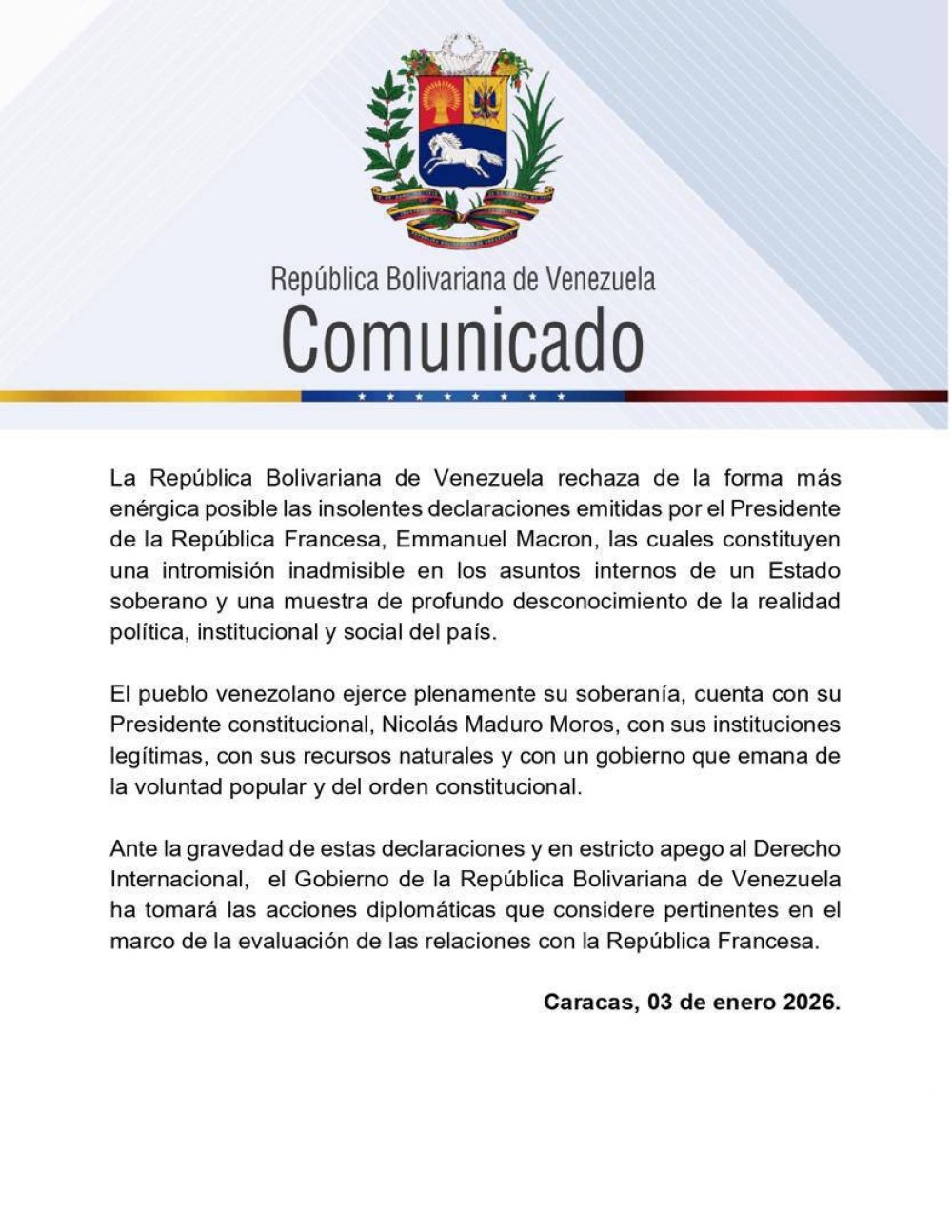
« La République bolivarienne du Venezuela rejette avec la plus grande fermeté les déclarations insolentes du président de la République française, Emmanuel Macron, qui constituent une ingérence inadmissible dans les affaires intérieures d'un État souverain. »
On peut également citer le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui, en plein processus de négociation avec la Russie, n’a rien trouvé de plus intelligent que de suggérer aux États-Unis de faire subir à Vladimir Poutine le même sort qu’à Maduro. Un grand moment de diplomatie, à n’en pas douter.
Une démonstration paradoxale de l’impuissance militaire grandissante d’un empire en déclin
Ce qu’il y a toutefois de plus instructif dans ce qui s’est passé dans la nuit du 2 au 3 janvier 2026 au Venezuela, c’est en fin de compte, et assez contre-intuitivement de prime abord, l’aveu d’impuissance que les États-Unis ont involontairement offert au monde, sous les dehors d’une opération visant pourtant ostensiblement à montrer leurs muscles.
Indiscutablement, le plan qui a abouti à l’enlèvement de Nicolás Maduro et de son épouse s’est révélé, si l’on en croit les propos toujours vantards de Donald Trump, un véritable exploit en termes de préparation et de coordination. Le ballet d’aéronefs nécessaires, la présence au sol d’agents américains, et l’exfiltration réussie des deux prisonniers vers la flotte stationnant au large : tout cela a constitué une impressionnante démonstration de l’expertise des forces armées américaines.
Mais c’est bien le choix d’une telle opération qui s’avère curieux. Les États-Unis ont amassé des forces considérables, en termes d’hommes, d’avions et de navires, au large du Venezuela et dans la mer des Caraïbes au sens large. La perspective d’une invasion du pays par l’armée américaine semblait se rapprocher. Au lieu de cela, Washington a préféré décider de se contenter d’enlever Maduro. Au vu des déclarations de Donald Trump à la suite de cette opération, proclamant que les États-Unis allaient « diriger » le Venezuela et qu’ils veilleraient à assurer une « transition pacifique », il semble clair que l’espoir de l’administration américaine était que les bombardements et l’enlèvement du président suffiraient à provoquer la chute du gouvernement vénézuélien.
Or, jusqu’à présent, cette chute n’a pas eu lieu. La vice-présidente, Delcy Rodriguez, dont la résidence a été bombardée, a accédé au pouvoir sans incident ; son profil, si elle peut envisager de discuter avec les États-Unis, laisse supposer qu’elle ne sera probablement pas encline à s’y soumettre pleinement. Le peuple vénézuélien, quant à lui, ne s’est jusqu’à présent pas soulevé non plus. Maduro était certes devenu très impopulaire, mais il est difficile d’estimer jusqu’à quel point cette impopularité s’étendait au chavisme au sens large, ou était au contraire limitée à la personne du président. Le sentiment qui semble prédominer actuellement au Venezuela est l’inquiétude et une forme d’attente anxieuse ; même les opposants à Maduro ne voient pas forcément tous d’un très bon œil une intervention américaine. L’Amérique latine sait mieux que quiconque de quoi les États-Unis sont capables.
Résultat, les belles déclarations pleines d’assurance de Donald Trump sonnent creux. Les États-Unis ne contrôlent absolument pas le pays à l’heure actuelle ; et à moins qu’un soulèvement ne finisse par se produire, ou que le gouvernement vénézuélien décide de céder, il paraît évident qu’une seconde opération devra être mise sur pied. Or, de simples bombardements ne suffiront probablement pas à provoquer la chute du régime. Washington se trouverait alors dans la très inconfortable position de devoir recourir à la solution que l’administration Trump a soigneusement cherchée à éviter depuis tout ce temps : l’invasion.
Et c’est bien en cela que les États-Unis ont involontairement démontré leur faiblesse. Ils disposent évidemment des ressources nécessaires pour envahir le Venezuela, même s’il s’agit d’une cible difficile, au terrain accidenté, en zone tropicale. Mais c’est bien la volonté qui fait défaut aux autorités américaines. Une invasion du Venezuela, si le pays décide de résister de façon significative, se solderait par un coût élevé en vies humaines, dans un pays dont le peuple a clairement démontré, à la suite des guerres d’Irak et d’Afghanistan, qu’il n’était plus disposé à payer un tel prix ni à encourager de nouvelles aventures militaires.
« Boots on the ground », autrement dit l’envoi de troupes sur le terrain, est presque devenu une idée tabou aux États-Unis. Si l’administration Trump décide d’envahir le Venezuela, le soutien populaire dont elle bénéficie encore s’évaporera très vite dès que les premiers avions-cargos chargés de cercueils de soldats commenceront à arriver. À moins d’un an des midterms qui s’annoncent très délicates à négocier pour le Parti républicain, une telle décision serait terriblement lourde de conséquences.
Mais que faire alors ? Si le gouvernement vénézuélien ne s’effondre pas de lui-même et ne décide pas non plus d’abdiquer la souveraineté du Venezuela, les États-Unis risqueraient de perdre la face. Une étroite voie médiane demeure : si le gouvernement vénézuélien finit par accepter de négocier, il est possible qu’un accord soit trouvé qui permette aux États-Unis une sortie de crise « par le haut », notamment s’ils parviennent à sécuriser le contrôle du pétrole vénézuélien. La menace d’un éventuel embargo américain pourrait notamment encourager Caracas à rechercher un tel compromis.
Mais si le gouvernement vénézuélien refuse de céder, même face à un embargo, alors un tel cas de figure demeurera hors de portée des États-Unis, et ils n’auront plus que deux choix : envahir le pays ou finir humiliés. Les responsables américains n’ont donc plus qu’à prier pour que la situation évolue en leur faveur à Caracas, faute de quoi ils seront les prochaines victimes, après Maduro, du piège qu’ils ont eux-mêmes tendu au Venezuela.
Notes
(1) En décembre 1989, le président américain, George Bush, ancien directeur de la CIA, a ordonné l’invasion du Panama pour capturer l’homme fort du pays, le général Manuel Noriega, ex-collaborateur des services secrets américains poursuivi par la justice américaine pour trafic de drogue.
Photo d'ouverture : Le président du Venezuela Nicolás Maduro, yeux bandés, pris en photo lors de son enlèvement par les forces spéciales américaines, le 3 janvier 2026 - @realDonaldTrump - Truth Social
Cet article est gratuit grâce aux contributions des abonnés !
Pour nous soutenir et avoir accès à tous les contenus, c'est par ici :
S’abonner
Accès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous








14 commentaires
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.
S'abonner