La Commission européenne planche sur la création d’un 28e État membre totalement fictif, qui pourrait être doté de son propre droit des sociétés, droit des faillites et droit du travail. Toutes les entreprises européennes pourraient opter pour ce régime alternatif à la place de leur législation nationale. Il s’agit ni plus ni moins de créer un droit fédéral des affaires taillé sur mesure pour les multinationales – un potentiel État virtuel du dumping réglementaire, pour le plus grand bonheur de nos patrons. Un projet sans équivalent au monde, qu’aucune entreprise n’a obtenu, pas même aux États-Unis sur leur propre territoire. Un paradis fiscal, juridique et social virtuel, sous drapeau européen, pourrait-il être proposé par la Commission en 2026 ? Des États s'y opposeront-ils ? On vous explique tout !



Abonnement Élucid
La Commission est en passe de doter le capitalisme européen d’une arme de destruction massive contre les droits sociaux, la plus redoutable de l’histoire – devant l’euro et le libre-échange – qui anéantirait toute perspective de progrès social. Son nom de code : « 28e régime ».
Vous n’en avez pas entendu parler ? C’est normal : ce projet reste largement inconnu du grand public. Pourtant, à Bruxelles, le 28e régime est sur toutes les lèvres. Il circule dans les cabinets d’avocats et de lobbyistes, et a été repris par les plus hautes instances de l’UE : Enrico Letta l’a évoqué dans un rapport en avril 2024, Mario Draghi en a parlé dans un rapport en septembre 2024, et Ursula von der Leyen l’a même annoncé officiellement dans son discours sur l’état de l’Union du 10 septembre 2025 : « Pour les entreprises innovantes, nous préparons le 28e régime… ».
Alors, de quoi s’agit-il au juste ? En clair, ce 28e régime consisterait à créer ex nihilo un cadre juridique fédéral optionnel, englobant les principaux pans du droit des affaires (sociétés, faillites, fiscalité, travail). Théoriquement, la souveraineté des États serait préservée, puisque ce régime n’entraînerait pas la suppression des lois nationales – chaque entreprise restant libre de ne pas y souscrire. Mais qui peut croire qu’une entreprise refusera le cadre le plus souple et avantageux jamais conçu ? L’objectif assumé est en effet que ce 28e régime soit plus favorable que tous les droits nationaux existants réunis. S’il tient ses promesses, l’adoption massive de cette « option » rendrait de fait caducs les droits nationaux (obsolètes par abandon). En pratique, on obtiendrait un véritable droit fédéral unifié des affaires, sans le dire ouvertement.
Nouveau nom, nouvelle marque pour une proposition déjà tentée plusieurs fois
La Commission n’en est pas à son premier coup d’essai. Depuis 2004, elle a déjà tenté à plusieurs reprises de créer des statuts européens permettant aux entreprises d’échapper aux contraintes nationales :
- 2004 : Statut de société européenne (Societas Europaea, SE) – première forme de société commune aux 27 États membres, adoptée principalement par des entreprises allemandes pour contourner l’obligation de cogestion avec les salariés (la Mitbestimmung, qui fait siéger des représentants du personnel au conseil de surveillance).
- 2008 : Projet de société privée européenne (SPE) – aucun engagement en matière d’information/consultation des travailleurs. Abandonné en 2014, faute d’accord entre États.
- 2012 : Projet de société unipersonnelle à responsabilité limitée (SUP) – visait à permettre aux entreprises de court-circuiter les réglementations nationales fiscales, sociales et de gouvernance. Retiré en 2018 pour les mêmes raisons (blocage sur la protection des salariés).
Ces échecs répétés ne l’ont pas découragée. La Commission a de la suite dans les idées : toute nouvelle initiative européenne présentée comme visant à « simplifier la vie des entreprises » doit être examinée à la lumière de ces tentatives passées, qui en disent long sur les véritables objectifs poursuivis.
Une initiative aux sponsors puissants, les usual suspects bien présents
L’idée du 28e régime n’est pas sortie de nulle part – elle émane dès l’origine du milieu des start-up et du capital-risque. Mi-octobre 2024, l’association EU-Inc – qui fédère plusieurs start-up et fonds de venture capital (capital-risque) – a lancé une pétition en faveur de ce « 28e État » virtuel, recueillant plus de 16 000 signatures.
Le 28 janvier 2025 – la veille de la présentation par la Commission de son grand plan pour la compétitivité européenne – EU-Inc a surenchéri en publiant un plan extrêmement détaillé décrivant le 28e régime de ses rêves. Parmi les mesures phares proposées :
- Création d’entreprise en 24h et entièrement en ligne, via un guichet numérique unique européen (plus besoin de passer devant notaire) ;
- Registre en ligne centralisé : tous les actes de la vie de la société inscrits sur une plateforme unique ;
- Stock-options uniformisées : les salariés des sociétés sous ce régime bénéficieraient des mêmes plans de stock-options, quel que soit le pays ;
- Levée de fonds facilitée : possibilité pour ces start-up d’émettre des bons de souscription d’actions futures pour attirer des investisseurs ;
- Moins de contraintes sociales : allègement des obligations d’information et de consultation des salariés ;
- Harmonisation fiscale partielle : certaines assiettes d’imposition unifiées à l’échelle européenne ;
- Tribunal dédié : création d’une juridiction unique pour régler rapidement les litiges nés de l’application du 28e régime.

EU-Inc et consorts jurent que leur démarche n’a pas pour but de démanteler les droits sociaux européens. On peut leur accorder le bénéfice du doute sur ce point. Cependant, il est plus difficile d’être rassuré par les autres promoteurs de l’initiative. L’ONG Corporate Europe Observatory, qui surveille les lobbies à Bruxelles, révèle que de grands acteurs patronaux se sont engouffrés dans la brèche : Chamber of Progress, ECIPE, BusinessEurope, EuroCommerce, pour ne citer qu’eux. Toutes ces organisations ont eu des réunions avec des commissaires européens pour pousser le 28e régime – et elles exigent sans ambiguïté qu’il s’applique à l’ensemble des entreprises, pas seulement aux start-up.
Le 30 juin 2025, la commission des Affaires juridiques du Parlement européen s’est d’ailleurs auto-saisie du sujet. Son rapport reprend l’essentiel des propositions d’EU-Inc, en demandant explicitement que les droits des salariés « ne soient pas affectés » par ce nouveau cadre, et en préconisant d’ouvrir le régime optionnel à toutes les entreprises (confirmant ainsi la demande des lobbies).
En juillet 2025, la Commission européenne a lancé une consultation publique pour préparer son projet. Un questionnaire en ligne, ouvert à tous jusqu’au 30 septembre 2025, invitait les parties prenantes à donner leur avis sur les caractéristiques que devrait avoir le 28e régime. Aucun tabou dans ce questionnaire : la Commission y suggérait qu’elle n’exclut aucune option, pas même l’harmonisation fiscale ou le droit du travail, et invitait les répondants à s’exprimer librement sur tous les aspects du futur régime.

En parallèle, la Commission a aussi recueilli 879 contributions libres (sous forme de commentaires publics non structurés) : l’Allemagne domine (28,5 % des répondants), tandis que la France est quasi absente (à peine 5,2 % des contributions).
La lecture de ces retours en dit long sur les motivations derrière le 28e régime. Premier enseignement : de nombreux acteurs économiques allemands et autrichiens plébiscitent l’initiative, y voyant un moyen de contourner la lourdeur de leurs procédures nationales. Dans ces deux pays, créer une société exige de passer devant notaire – on comprend leur agacement : l’Allemagne et l’Autriche pointent aux 125e et 127e rangs sur 190 en matière de facilité de création d’entreprise (classement Doing Business), alors que la France est 37e. Les puissantes organisations patronales d’outre-Rhin (telles que la DIHK ou la VDMA) ont d’ailleurs apporté un soutien officiel à la proposition.
Le dernier jour de la consultation, de nombreuses organisations patronales, la plupart basées à Bruxelles, se sont manifestées en faveur du projet et notamment la plus puissante d’entre elle, la table ronde des industrielles (ERT). On peut aussi trouver les commentaires de DigitalEurope, SME United, de eBay, de Deutsche Börse Group, de la confédération des entreprises suédoises et bien sûr de EU-Inc à l’origine de l’initiative.
Du côté français, parmi les contributions notables figurent celles de la CPME (organisation patronale des PME) et du Cercle Montesquieu (club de juristes d’entreprise proche du Medef) – deux fervents soutiens de la proposition. Le Cercle Montesquieu estime même qu’il faudrait aller beaucoup plus loin dans l’harmonisation du droit des affaires, en couvrant des pans plus larges que le projet actuel.
Au final, une écrasante majorité des répondants se prononcent en faveur du 28e régime. Fait notable, un consensus se dégage pour refuser que le 28e régime soit instauré par une directive européenne (ce qui exigerait une transposition dans chaque État, avec le risque de divergences supplémentaires). Or la Commission, dans son questionnaire, laissait entendre qu’elle privilégiait justement la voie de la directive – tout comme le Parlement européen dans son rapport préliminaire. Ce choix procédural pourrait donc devenir un point de friction à l’avenir.
Des syndicats et des partis de gauche aux abonnés absents
L’autre enseignement frappant de cette consultation, c’est l’absence quasi totale des syndicats et de la gauche politique dans le débat. Seulement deux syndicats ont contribué publiquement : la confédération allemande DGB, ainsi que la confédération danoise (the Danish Trade Union Confederation), qui ont vivement dénoncé un projet menaçant les droits des salariés. La DGB rappelle qu’au début des années 2000, le statut de Société Européenne (SE) (voir plus haut) avait été massivement utilisé pour priver les salariés allemands de ce droit (dans 83 % des cas, les entreprises ayant adopté le statut SE l’ont fait pour esquiver la participation des employés).
Mis à part ce cri d’alarme venu d’outre-Rhin, c’est le silence radio du côté des travailleurs. Aucune contribution des grands syndicats français (pas un mot de la CGT, de la CFDT, de FO ou de la CFTC), pas davantage de réactions officielles des partis de gauche. Pendant ce temps, le patronat, lui, s’est bien mobilisé : comme on l’a vu, le Medef (via BusinessEurope), France Digitale, la CPME, le Cercle Montesquieu et consorts ont répondu présents à la consultation et multiplié les réunions avec Bruxelles.
Pour être juste, signalons qu’au niveau européen, la Confédération européenne des syndicats (CES) a réagi dès mars 2025, en rejetant fermement l’idée d’inclure des dispositions de droit du travail dans un 28e régime. La CES a prévenu qu’elle s’opposerait à tout dispositif qui permettrait de contourner les protections sociales existantes, le droit du travail national ou les conventions collectives au prétexte d’un régime optionnel supplémentaire.
Plus inquiétant encore : aucun responsable politique de premier plan ne semble disposé à monter au front. L'eurodéputée macroniste Valérie Hayer et le vice-président exécutif pour la prospérité et la stratégie industrielle de la Commission européenne, Stéphane Séjourné peuvent même se vanter tranquillement sur les réseaux sociaux du lancement du 28e régime, sans rencontrer la moindre contradiction.
Les heures que nous vivons sont celles du réveil de l’Europe. Ce réveil que Mario #Draghi appelait de ses voeux dans son rapport.
Un an après, son message ne cesse de gagner en importance.
De l'union bancaire au 28è régime à la préférence européenne, accélérons.@RenewEurope pic.twitter.com/5pfDK38eXL
— Stéphane Séjourné (@steph_sejourne) September 3, 2025
Quoi qu’il en soit, le 28e régime suit son cours. Ce n’est plus une simple idée en l’air : la Commission a annoncé qu’elle présenterait un premier projet de texte dès le premier trimestre 2026. C’est à ce moment-là que nous découvrirons les détails concrets du dispositif… et ses éventuelles clauses toxiques.
L’approche des « petits pas » pour faire passer la proposition
La méthode qui s’annonce est un grand classique de la construction européenne : l’approche des petits pas (ou du pied dans la porte). La Commission devrait débuter par une première directive modeste, posant les bases du 28e régime avec quelques mesures de simplification a priori consensuelles (par exemple, faciliter la création d’entreprise en ligne en 24h). Bien sûr, ce texte initial n’aborderait aucun des sujets explosifs comme le droit du travail ou la fiscalité – histoire de ne déclencher ni l’opposition des États ni celle des syndicats (s’ils venaient à se réveiller).
Ensuite, une fois le principe du 28e régime acté, il ne restera qu’à élargir progressivement son champ d’application, directive après directive. C’est la stratégie habituelle de l’UE depuis les années 1950 : avancer par petites touches réglementaires, sous un vernis technique, de sorte que personne ne s’alarme. Chaque mesure prise isolément paraît indolore ; ce n’est qu’après coup, en empilant toutes ces « briques », qu’on réalise l’ampleur des changements et des transferts de souveraineté opérés. (La libéralisation du secteur électrique illustre bien cette tactique : une première directive a entamé le monopole d’EDF, et trois directives plus tard ce monopole avait volé en éclats.)
Au bout du compte, en quelques années, un véritable droit fédéral des affaires parallèle aux droits nationaux pourrait voir le jour, sans que presque personne ne s’en aperçoive. Si bataille politique il doit y avoir, c’est maintenant qu’il faut la mener. Une fois la première pierre posée, l’engrenage sera lancé et il sera trop tard pour enrayer la machine.
Une proposition basée sur un mensonge et un postulat erroné
Pour conclure, il est crucial de démonter le mythe fondateur qui sous-tend la promotion du 28e régime. L’argument intuitif mis en avant, c’est que les États-Unis d’Amérique, eux, seraient un marché entièrement intégré – un seul pays, donc un seul cadre légal – et qu’il y serait bien plus simple de faire des affaires qu’en Europe. D’où l’idée que l’UE devrait s’aligner sur ce modèle en unifiant davantage ses règles. Or, cette prémisse est entièrement fausse.
D’abord, il est absurde d’imaginer qu’une entreprise se déploie simultanément dans les 50 États d’un pays-continent comme les États-Unis. Mais surtout, et c’est là le cœur du problème, les États-Unis n’ont pas un environnement juridique unifié – loin de là. En réalité, les États-Unis sont un État fédéral composé de 50 États… dotés chacun de leur propre législation. Ils possèdent 50 systèmes juridiques différents rien que pour le droit des sociétés, le droit du travail, la fiscalité, le droit bancaire, etc., en plus des lois fédérales nationales. On se retrouve donc avec du 50 + 1 dans chaque domaine ! 51 droits des sociétés, 51 droits fiscaux, 51 droits bancaires, etc. Le droit du travail fédéral américain fixe par exemple quelques standards minimaux (salaire minimum, etc.), mais chaque État impose ses propres règles au-delà de ce plancher.
En pratique, le droit américain est d’une complexité redoutable. Les lois y atteignent des milliers de pages, et l’accès aux informations juridiques y est difficile et coûteux (les bases de données publiques sont lacunaires, les bases privées hors de prix). Ce n’est pas un hasard si c’est « le pays des avocats » : pour une entreprise, il est quasiment impossible d’opérer sur plusieurs États américains sans s’entourer d’une armée de juristes. La fiscalité américaine, elle aussi, n’a rien à envier à la nôtre en termes d’opacité : selon l’indice international de complexité fiscale (Tax Complexity Index), les États-Unis et la France obtiennent un score similaire. En clair, chaque société doit composer avec des règles fiscales et sociales qui varient d’un État à l’autre – tout comme une entreprise européenne doit s’adapter aux lois de chaque pays où elle est implantée.
Les économistes américains le reconnaissent d’ailleurs : il existe aux États-Unis d’importantes « frictions » dues aux divergences de réglementation entre États. Une partie de la recherche académique s’attache à mesurer l’impact de ces barrières internes sur la libre circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes à l’intérieur du marché américain – un marché prétendument unifié, mais en réalité très fragmenté.
Et les résultats de ces études sont édifiants : le marché unique européen est aujourd’hui une zone plus intégrée économiquement que le marché intérieur des États-Unis, aussi bien pour les biens que pour les services. Au moins deux études récentes l’affirment. L’une d’elles (1) – pourtant citée par le FMI et par Ursula von der Leyen pour alimenter le discours inverse – conclut noir sur blanc que les barrières réglementaires intra-UE sont moins élevées que celles existant entre les États américains. Dans son discours de 2025, Von der Leyen s’alarmait que « les barrières subsistant au sein du marché unique équivalent à des droits de douane de 45 % sur les marchandises et 110 % sur les services », reprenant des chiffres d’un rapport du FMI. Or, l’étude universitaire citée en source par le FMI montrait exactement l’inverse : sur ces mêmes indicateurs, les entraves sont moindres dans l’UE qu’aux États-Unis !

En lisant le graphique, on s’aperçoit donc qu’en équivalent droits de douane, les barrières réglementaires sont moins élevées dans l’UE qu’aux États-Unis (8 contre 10 pour les biens et 36 contre 48 pour les fusions et acquisitions.
Les auteurs de cette étude (parue dans le Journal of Economic Perspectives en 2021) concluent ainsi que « sur de nombreux fronts, l’intégration économique de l’UE égale, voire dépasse, celle des 50 États américains ». Une seconde étude (2), présentée à la Commission européenne fin 2022, aboutissait au même constat. Nous avions déjà cité et présenté plus en détail cette étude dans un précédent article intitulé « Le marché unique : une success-story européenne de destruction du progrès social ».
Le récit d’une Europe bureaucratique et « enfer réglementaire » face à un Eldorado américain dénué de contraintes est donc un fantasme pur et simple. Entretenir ce narratif anti-régulation ne fait que nuire à l’attractivité du continent, en le dépeignant à tort comme un cauchemar administratif pour les entrepreneurs. D’ailleurs, lors de l’atelier organisé au Parlement européen sur le 28e régime, un rapport listant tous les obstacles rencontrés par les start-up a repris mot pour mot ce discours du « fardeau réglementaire » et du marché européen prétendument fragmenté. Or, chacune des plaintes visant la lourdeur de l’UE aurait pu s’appliquer à l’identique au marché américain ! Cela prouve à quel point même en Europe, les élites économiques ont intégré ce complexe d’infériorité face au modèle américain.
L’ironie, c’est que ce même rapport admettait que le problème numéro 1 des start-up européennes n’est pas la réglementation ou la fiscalité, mais le financement. En clair, nos jeunes pousses peinent à lever autant de capitaux qu’aux États-Unis – les chiffres sont sans appel. Mais accuser la complexité des règles est un faux-semblant : comme on l’a vu, la réglementation est en réalité plus simple en Europe et permet des échanges plus fluides qu’aux États-Unis. D’ailleurs, quand on demande aux start-up quelles sont leurs principales difficultés, elles citent d’abord le prix de l’énergie, le manque de main-d’œuvre qualifiée et l’incertitude politique – bien avant la question réglementaire.
Au passage, la véritable barrière qui entrave le marché unique européen n’est pas juridique : ce sont les langues (pas moins de 24 langues officielles dans l’UE) et les différences culturelles. Toutes les harmonisations du monde n’y feront rien.
Des progrès possibles, mais des lignes rouges à ne pas franchir
Reconnaissons pour finir que certaines demandes portées par les entrepreneurs sont légitimes, et qu’il est tout à fait possible de simplifier la vie des entreprises en Europe sans dynamiter les protections sociales. Par exemple, on pourrait généraliser la dématérialisation intégrale des registres du commerce et des procédures de création d’entreprise : aujourd’hui, quelques États membres (comme l’Estonie ou le Portugal) offrent déjà un enregistrement 100 % en ligne, mais ce n’est pas le cas partout. De même, on peut raccourcir les délais de création : ceux-ci varient de quelques heures à plusieurs semaines selon les pays (et ils sont manifestement très longs en Allemagne). EU-Inc réclame 24 heures, la Commission 48 heures ; l’important est de laisser aux autorités le temps de vérifier sérieusement les fondateurs (par exemple s’assurer qu’ils ne figurent pas sur une liste de blanchiment d’argent).
Aller trop loin dans la facilitation comporterait en revanche de graves risques. Rendre la création d’entreprises trop aisée, c’est ouvrir la porte à la prolifération des coquilles vides et autres sociétés-écrans utilisées dans les schémas de fraude et de blanchiment. La grande facilité à ouvrir des sociétés en Europe a d’ailleurs été l’une des causes du fameux scandale de la fraude à la TVA carbone (des escrocs profitaient des immatriculations express pour monter des carrousels frauduleux). Ne leur simplifions pas trop la tâche…
En somme, oui aux progrès techniques et administratifs – mais non à la casse sociale. Exiger un droit fédéral des affaires sur mesure pour le grand capital – une construction inédite au monde – revient ni plus ni moins à vouloir s’affranchir de toutes les règles nationales conquises par les travailleurs et les citoyens. Les partisans du 28e régime souhaitent une entreprise hors-sol, libérée de toutes les contraintes locales, de toutes les protections nationales, de toutes les préférences collectives forgées par 27 histoires socio-économiques différentes. Jusqu’à présent, aucune société, même dans un État fédéral, n’a jamais bénéficié d’un tel passe-droit – pas même aux États-Unis.
Évidemment, abolir le Code du travail, réduire les droits des salariés ou faire disparaître les syndicats peut rendre un pays plus « compétitif » sur le papier. Mais à ce compte-là, l’Europe se rapprocherait bien davantage du Vietnam que d’hypothétiques « États-Unis d’Europe » – lesquels, de fait, existent déjà sur bien des plans.
Notes
(1) « The United States of Europe: A Gravity Model Evaluation of the Four Freedoms », Keith Head et Thierry Mayer parue en 202 parue au Journal of Economic Perspectives, Volume 35, Number 2, Spring 2021, Pages 23-48.
(2) « Why Did Europe’s Single Market Surpass America’s », Craig Parsons, Matthias Matthjis et Benedikt Springer, 2021.
Photo d'ouverture : La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, observe pendant une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre letton à Riga, en Lettonie, le 29 août 2025. (Photo de Gints Ivuskans / AFP)
Cet article est gratuit grâce aux contributions des abonnés !
Pour nous soutenir et avoir accès à tous les contenus, c'est par ici :
S’abonner
Accès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous


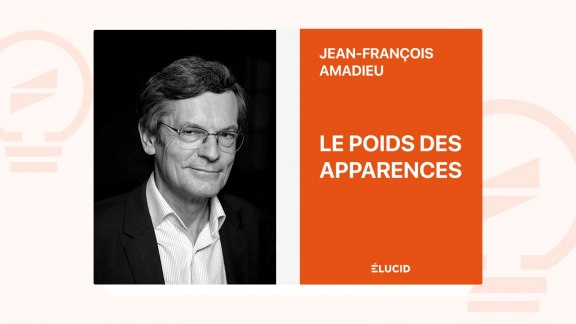



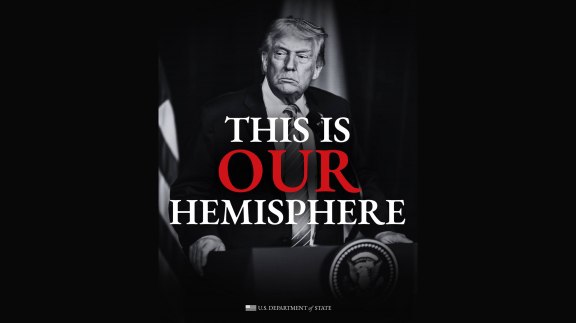

10 commentaires
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.
S'abonner