Il existe une version plus récente de cet article sur Le PIB et la croissance de la France
Nous vous recommandons de lire notre article actualisé sur daté du
La France voit refluer l’inflation mais le retour à la normale semble encore lointain. Et malgré les revendications d'une indexation des salaires sur l'inflation, les revenus de beaucoup de travailleurs n'ont pas suivi cette évolution des prix. La santé économique des Français s'est donc dégradée, avec des répercussions sur notre économie qui n’a connu qu’une croissance famélique de +0,2 % au 1er trimestre 2024. De plus, notre gouvernement a convenu avec Bruxelles de diminuer son soutien à l'économie cette année – les 10 milliards d’économies annoncées par Bruno Le Maire ne sont qu’un début, 10 autres milliards de coupes se profilent déjà comme vient de le confirmer Standard & Poor’s. La situation devrait donc continuer à se détériorer dans les prochains mois, dans un contexte de crises internationales compliquées, entraînant un climat social pour le moins chaotique. Qu'avons-nous à craindre pour notre pouvoir d'achat et nos emplois ? On vous explique tout.

1- Une quasi-stagnation
2- Le PIB par habitant proche du niveau de 2019
3- Le secteur public et le commerce extérieur sauvent la croissance
4- Décroissance de la construction et de la consommation
5- Les dividendes ont terminé leur forte croissance
6- Le pouvoir d'achat en berne
Ce qu'il faut retenir
Cette analyse graphique originale d'Olivier Berruyer pour Élucid est une mise à jour de notre suivi régulier et actualisé des grands indicateurs économiques.
Rappelons tout d’abord que le fameux PIB (Produit Intérieur Brut) est un indicateur économique qui mesure la production économique, c’est-à-dire la valeur de tous les biens et services produits. Souvent décrié – et pour de très bonnes raisons – pour son utilisation en tant que principal indicateur économique, le PIB offre cependant une bonne vision de la production économique de la France, et donc de l’évolution corrélative de nos revenus et de notre pouvoir d’achat.
Une quasi-stagnation de la croissance
L’atonie du PIB français continue : après +0,1 % et + 0,3 % aux 3e et 4e trimestres 2023, le PIB est annoncé en hausse de +0,2 % au premier trimestre 2024.


Rappelons également que ces chiffres sont calculés avec le controversé indice des prix de l’Insee, mais que celui d’Eurostat, à la méthode de calcul harmonisée en Europe, lui est quasiment toujours supérieur. L’écart entre ces deux indices a atteint 1 point de pourcentage au début de 2023, et il est toujours de 0,5 point actuellement (à comparer au petit +0,2 point de croissance du trimestre).


De façon générale, les calculs de ces deux instituts publics de statistique ont fortement divergé en 2022. Au final, l’écart entre leur évaluation de l’inflation depuis 2015 atteint 2,7 %, pour une croissance totale durant cette période de +9,4 %. Il y a donc une incertitude sur au moins le quart de la valeur de la croissance de ces 8 dernières années, ce qui est colossal.
Lisez la suite et soutenez un média indépendant sans publicité
S’abonnerAccès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous




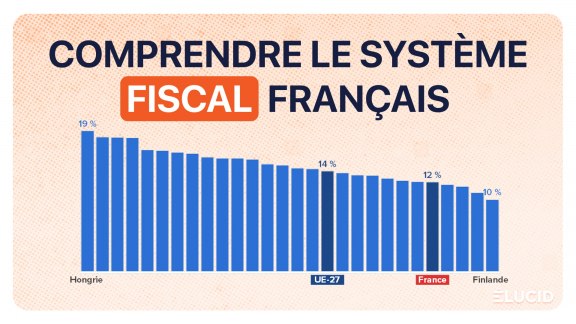



2 commentaires
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.
S'abonner