L’Asie du Sud-Est fait rarement les gros titres de l’actualité occidentale. Si les récentes escarmouches entre la Thaïlande et le Cambodge rencontrent davantage d’écho que leur précédent conflit en 2011, c’est parce que le président américain se vante d’y avoir brillamment joué son rôle d’expert du fameux « art de la négociation ». La réalité n’est toutefois pas si simple.

Au cours du mois d’août dernier, que ce soit sur les réseaux sociaux ou au cours de diverses prises de parole, le président américain Donald Trump, qui ne compte décidément pas abandonner ses efforts pour tenter d’obtenir le prix Nobel de la paix, s’est vanté à plusieurs reprises d’avoir « mis fin à six guerres en six mois » – ou parfois même sept, suivant les versions – depuis son retour au pouvoir, le 21 janvier 2025. Une assertion qui semble effectivement impressionnante, tout à fait le genre qui, si Donald Trump n’était pas Donald Trump, pourrait convaincre le très politique Comité Nobel norvégien de lui accorder la précieuse récompense. Après tout, elle fut jadis décernée à Barack Obama alors qu’à peu près tout le monde – y compris Obama lui-même – s’accordait à dire qu’il n’avait encore rien fait pour la mériter. Les membres du Comité étant directement désignés par le Parlement norvégien, dominé par une coalition de gauche, on les voit toutefois mal trancher en faveur de l’actuel président américain.
Et encore faudrait-il que cette allégation soit vérifiable. Or, il s’avère qu’elle est peut-être un peu trop ambitieuse pour être entièrement honnête. Ainsi, sans même compter les échecs évidents de la diplomatie américaine, comme en Ukraine ou à Gaza, les conflits qui ont effectivement fait l’objet de cessez-le-feu orchestrés par Washington ne sont certainement pas réglés pour de bon. De fait, la totalité d’entre eux, qu’il s’agisse du conflit entre la RDC et le Rwanda, celui entre le Pakistan et l’Inde, celui entre l’Iran et Israël, ou encore celui entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, ne constituaient que les émanations les plus récentes de tensions parfois très anciennes, dans des contextes particulièrement compliqués, et qui ont probablement vocation à resurgir un jour ou l’autre.
Lisez la suite et soutenez un média indépendant sans publicité
S’abonnerAccès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous


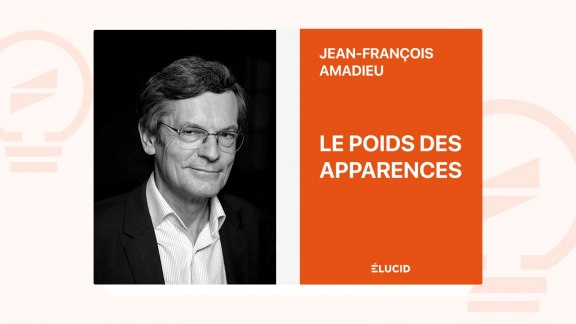



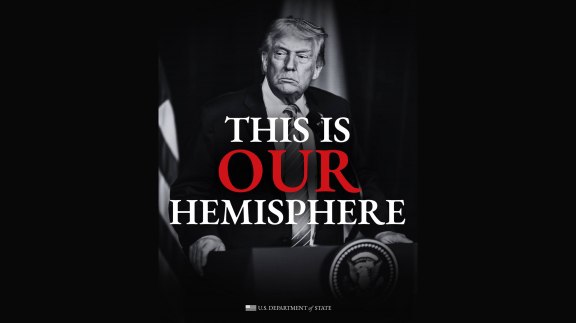

1 commentaire
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.
S'abonner