Présentée comme naturelle et irréversible afin de la mettre à l’abri de la critique et du politique, la globalisation est pourtant une entreprise délibérée qui s’inscrit dans la logique de l’expansion du capitalisme, et qui fut rendue possible par le hard power et le soft power des États-Unis.



Abonnement Élucid
La « mondialisation » est généralement attribuée par les hommes politiques et les médias à deux grandes causes. Elle résulterait exclusivement d’inventions technologiques, au service du « Progrès », dans les domaines du transport – le porte-conteneur créé à la fin des années 1960 – et des communications – Internet, né officiellement en 1989. Elle s’inscrirait, sinon, dans la continuité d’unifications toujours plus vastes du monde (l’Empire romain, les Grandes découvertes, les décennies 1870-1910), sans que soit prêté attention aux enfers qui les suivirent (les invasions barbares, les guerres de religion, la Première Guerre mondiale). Dans un cas comme dans l’autre, la mondialisation est tenue pour un mouvement naturel et irréversible, placé en cela hors de portée de la critique et du politique.
Une nouvelle phase du capitalisme
L’anglicisme de « globalisation » (globalization), majoritairement utilisé dans le lexique des pays latins à l’exception de la France, a au moins le mérite de distinguer le phénomène actuel des expériences passées de mise en relations du monde à travers des échanges, des communications et des contacts. Prendre toute la mesure de cette notion exige toutefois de la débarrasser des deux représentations déterministes dont elle fait souvent l’objet.
La première, centrée sur le porte-conteneur et Internet, confond les origines avec les leviers. La généralisation d’une technologie procède communément d’un contexte social qu’elle contribue ensuite à modifier. Le smartphone, explique ainsi le médiologue Pierre-Marc de Biasi, est la conséquence d’une fascination pour la vitesse et la quête de super-pouvoirs. En revanche, la technologie ne répondant pas aux mentalités, aux méthodes et aux aspirations de son temps, attend quant à elle son tour, à l’instar des « low tech » aujourd’hui ou de la locomotive et du chemin de fer hier.
L’identification de la globalisation au porte-conteur et au numérique – certes responsables de la baisse des coûts et de la plus grande rapidité des transports maritimes, des communications et des transactions – occulte les causes de leur généralisation, à savoir la dynamique inhérente au capitalisme d’affranchissement des contraintes de lieu et de temps. Dans les années 1960-1970, comme le rappelle Aurélien Bernier, la « mondialisation » était encore appelée la « division internationale du travail ».
Le concept se situe au croisement des travaux de deux penseurs phares du capitalisme : d'un côté Adam Smith, qui déclina sa théorie de la division du travail à l’échelle des nations, appelées, pour le profit de toutes, à se spécialiser là où leur productivité dépassait celle des autres pays, et de l'autre côté Ricardo, à l’origine de la théorie des avantages comparatifs d’après laquelle chaque nation gagne à se spécialiser là où sa productivité est la plus forte, même si elle est moindre par rapport à celle d’autres pays.
La division internationale du travail de la fin du XIXe siècle, qualifiée de « traditionnelle », répartissait les rôles entre les pays pauvres, chargés des produits bruts (matières premières ou agricoles) et les pays riches, chargés des produits manufacturés. La « nouvelle division internationale du travail » dont il était désormais question dans la seconde moitié du XXe siècle, se doublait en revanche d’une division internationale des processus productifs. Le perfectionnement de la stratégie des entreprises pour isoler des segments de production et les transférer à l’étranger permettait en effet d’exporter des pièces détachées et des composants, et non plus seulement des produits finis tels que le vin et le drap.
Cette nouvelle division internationale du travail – en raison notamment de l’effondrement du communisme – pris de plus en plus la forme d’une extension planétaire de la séparation, centrale dans le capitalisme, entre le travail intellectuel et le travail manuel. La conception et l’encadrement revenaient aux pays riches (l’économie de service, du tertiaire, de l’information, de la connaissance, le marketing, le financement) et l’exécution aux pays pauvres ou émergents industrialisés, les « usines et ateliers du monde » (la production industrielle, l’assemblage de composants, l’extraction des ressources).
Des classes moyennes sur le modèle occidental devaient émerger dans les nations dédiées à l’exécution, tandis que les consommateurs (aux emplois très qualifiés) des nations aisées bénéficieraient de biens plus divers, car issus du monde entier, et moins chers, car produits par une main d’œuvre peu coûteuse dans des pays à la faible réglementation sociale et environnementale. Une paix découlerait alors de ce « jeu gagnant-gagnant » vers toujours plus de prospérité.
Le rôle du politique dans le processus de libre-circulation
Tout comme la première, avec laquelle elle peut parfaitement s’accorder, l’explication déterministe qui fait de la globalisation une unification du monde qualitativement différente des précédentes mondialisations occulte le poids de l’action humaine. Elle ramène des évènements comme la chute du mur de Berlin et la Réunification allemande à de simples vecteurs du Sens d'une l’Histoire entrée dans sa phase finale de « réconciliation » de l’humanité par l’élimination des frontières, tenues pour cause des guerres.
L’interdépendance, tissée par les fils du droit, du commerce et des technologies, se substituerait inéluctablement à l’indépendance, entraînant une solidarité de fait dans un espace unifié, « le village global » ou le « monde plat » dont parle le chroniqueur du New York Times Thomas Friedman, fait d’interrelations, d’interactions et de communications instantanées, déchargé des négativités des distances géographiques, de la profondeur de l’histoire et de l’irréductibilité des cultures. Il serait le théâtre de tous les possibles pour l’individu mis grâce à lui en contact direct avec l’universel.
Cette représentation omet complètement les décisions politiques d’ouverture ou de suppression des frontières qui rendirent possible la libre-circulation des marchandises, des capitaux et des hommes.
Les premières remontent à avant les années Reagan et Thatcher – si on laisse de côté les accords de libre-échange entre les États-Unis et le Mexique, dont l’étendue géographique est très circonscrite – à l’abandon « provisoire » de la convertibilité du dollar en or par le président Nixon le 15 août 1971, confirmée par la conférence de Kingston en 1976. Il fut le point de départ, explique Jacques de la Rosière, ancien directeur du Trésor (1974-1978) et du FMI (1978-1987), d’une libéralisation croissante des mouvements de capitaux « qui déterminèrent les taux de change mais aussi, dans une certain mesure, les politiques économiques des États » avec pour conséquence un endettement massif et, pour y répondre, une amplification de la création monétaire et l’abaissement à zéro, voire moins, des taux d’intérêts par les banquiers centraux.
Sans la fin de Bretton Woods, affirme également l'économiste Frédéric Farah, le GATT, ancêtre de l’OMC destiné à limiter les barrières tarifaires et non-tarifaires des économies, n’aurait pas pu fonctionner.
Depuis 1971, les trois libertés de circulation – et même les quatre si l’on y ajoute la libre-circulation des services – se sont poursuivies à travers l’application de normes internationales et de traités de libre-échange négociés loin des peuples. Les nations sont, en ce sens, plus ou moins « intégrées » à la nouvelle phase du capitalisme qu’est la globalisation, en fonction de la volonté de leurs dirigeants, elle-même changeante selon les circonstances – la pandémie de Covid-19 typiquement, mais aussi la prise en compte des effets néfastes de la concurrence internationale. Elles peuvent l’être à des degrés très différents en fonction des domaines. La France préserve ainsi son « exception culturelle », notamment par des quotas protégeant son cinéma, sans déployer la même énergie pour son agriculture et ses produits manufacturés.
Très loin de l’image de dérégulation absolue qui l’entoure, la globalisation requiert et appelle donc à la fois une sur-règlementation et une sur-administration. En témoignent les formes exacerbées de bureaucratie publique constituées par les organisations supranationales de la « gouvernance mondiale » – chargées de diminuer les barrières tarifaires et non-tarifaires, d’orienter les économies vers l’exportation ou encore de restreindre les contrôles de mouvement de capitaux – et les mastodontes de bureaucratie privée représentées par les entreprises dites « multinationales », armées d’experts leur permettant d’obtenir des lois à leur avantage ou de pratiquer « l’optimisation fiscale », et mises en situation de pouvoir attaquer des États pour « entrave au commerce ».
Les assises géopolitiques de la globalisation
À la dynamique du capitalisme et aux décisions des gouvernants s’ajoute encore un dernier facteur, d’ordre géopolitique, indispensable à l’essor de la globalisation.
Déjà au XIXe siècle, le capitalisme devait son expansion de la victoire militaire de l’Angleterre, puissance maritime tournée vers le commerce, sur la France napoléonienne, centrée sur l’agriculture et rétive à utiliser l’arme du crédit. La « première mondialisation » des années 1870-1910 n’aurait pas pu advenir sans ce précédent.
Le capitalisme ne fit que changer de pays-vecteur cent ans plus tard, lorsque les États-Unis, une puissance maritime à nouveau, prirent le relai de l’hégémonie après la Première Guerre Mondiale et surtout après la Seconde. Il se retrouvait, a fortiori, dans les objectifs que les Américains se fixaient au milieu du XXe siècle, également rappelés par Aurélien Bernier : éviter une nouvelle crise de surproduction, lutter contre le communisme et s’assurer des accès aux matières premières, autant de raisons de dominer le commerce mondial. La fin de la convertibilité du dollar en or, trente ans plus tard, répondrait aussi à l’intérêt national d’imposer le « pouvoir exorbitant du dollar », déjà déploré par Valéry-Giscard d’Estaing, afin d’emprunter et d’émettre massivement de la monnaie tout en exportant le déséquilibre monétaire vers le reste du monde.
Pour se globaliser, le capitalisme prit appui sur le hard power des États-Unis, dirigé contre le communisme en premier lieu et contre les pays menaçant ce qu’ils jugeaient être leurs intérêts vitaux. « La main invisible du marché, affirme ainsi Thomas Friedman, ne peut fonctionner sans un poing caché – McDonald’s ne peut prospérer sans McDonald Douglas, qui construit les F-15. Et le poing caché qui rend le monde sûr pour les technologies de la Silicon Valley s’appelle l’armée, la force aérienne, la force navale et les Marines des États-Unis ».
Le capitalisme se servit également du soft power des Américains, d’une part inhérent à la force d’attraction exercée par une puissance dominante, et d’autre part promu par divers relais d’influence, entre autres l’industrie de la culture et du divertissement, véhiculant le « globish » et un certain type de modes de vie, ou les organisations supranationales exigeant des pays pauvres l’adoption de la « bonne gouvernance » en échange de prêts.
Il serait bien hâtif, toutefois, de déduire de tout cela que la globalisation se confond avec une américanisation du monde. De nombreuses cultures la rejettent et elle s’hybride sous des formes inédites avec le caractère propre des pays. Surtout, le capitalisme, qui est un bouleversement multidimensionnel des existences et des institutions bien au-delà d’une simple organisation économique, diffusa sur la planète des conceptions standardisées du politique, du bonheur, et de la vie bonne qu’il avait lui-même matérialisées au préalable aux États-Unis, en profonde contradiction avec l’idéal des Pères fondateurs.
La réinvention de l’American dream, dans le sens qui nous est familier aujourd’hui du self-made man, date de la fin du XIXe siècle, et la redéfinition par Walter Lippmann, tenu pour le père du néolibéralisme, de la démocratie en distribution la plus large possible des biens et des services et en pouvoir des experts fut mise en pratique à partir du New Deal.
Paradoxalement, la fin du capitalisme globalisé, dont un prochain article soutiendra qu’elle risque de se produire dans un futur proche, pourrait donc donner l’occasion aux États-Unis de renouer avec de larges pans de leur identité perdue, en particulier avec leur idéal des origines d’une société sans classes, aujourd’hui enfoui dans l’oubli. Tout la question est de savoir s’ils auront alors la volonté et la force de la saisir.
Photo d'ouverture : FOTOGRIN - @Shutterstock
Cet article est gratuit grâce aux contributions des abonnés !
Pour nous soutenir et avoir accès à tous les contenus, c'est par ici :
S’abonner
Accès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous


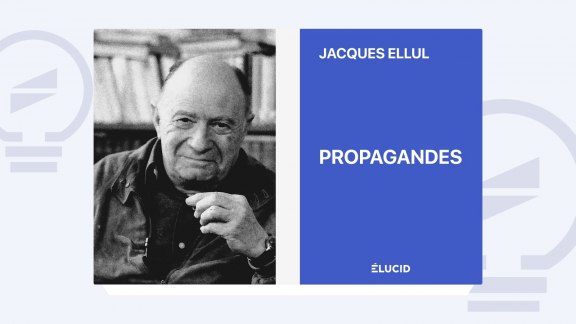





2 commentaires
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.
S'abonner