En dépit de leurs différences, tous les militants de la décroissance sont conscients de la contradiction entre leur projet et le capitalisme. Néanmoins, cette contradiction n’est pas toujours clairement étudiée. Dans cette cinquième chronique pour Élucid, l'économiste David Cayla explique les raisons fondamentales pour lesquelles capitalisme et décroissance sont effectivement incompatibles. Il explique aussi pourquoi une sortie du capitalisme ne suffirait pas à instaurer une société post-croissance et dévoile certaines contradictions dans les propositions faites par les auteurs décroissants.



Abonnement Élucid
Vous avez manqué l'article précédent de cette série ? Cliquez ICI pour le découvrir !
1- La décroissance est-elle indispensable ?
2- Doit-on se débarrasser du PIB ?
3- La décroissance implique-t-elle une décroissance technologique ?
4- La décroissance implique-t-elle de renoncer au développement ?
5 - La décroissance est-elle nécessairement post-capitaliste ?
6 - Publication à venir...
Nous avons vu précédemment que les approches de la décroissance sont multiples et qu'elles n’ont pas les mêmes perspectives politiques. Certaines rejettent le progrès technique ou la notion même de développement, tandis que d’autres considèrent que les innovations technologiques sont nécessaires, ou du moins compatibles, avec la mise en œuvre d’un projet décroissant.
En dépit de leurs différences, toutes les théories de la décroissance adoptent un même objectif visant à réduire l’empreinte écologique en réduisant l’activité économique des sociétés tout en préservant leur capacité à subvenir aux besoins fondamentaux de chacun. La décroissance est donc un projet de transformation globale. C’est d’ailleurs ce que recouvre le slogan selon lequel « la décroissance n’est pas la récession ». Autrement dit, la décroissance ne se résume pas à une simple baisse du PIB, mais doit permettre la mise en œuvre d’un autre système économique et social rendant possible une baisse de la production.
Quel doit être ce système ? Pour tous les décroissants, il est clair que le capitalisme doit être dépassé, car il serait incompatible avec les limites écologiques de la planète. La plupart d’entre eux récusent d’ailleurs le terme « anthropocène » pour évoquer l’influence de l’activité humaine sur la géologie terrestre, lui préférant celui de « capitalocène » qui fait clairement référence au capitalisme. Dans une note pour les Économistes atterrés, l’économiste Gilles Rotillon estime que « ces signes visibles de transformation [de la géologie de la planète] n’ont rien à voir avec une “nature humaine” qui n’utilisait ni plutonium, ni plastiques en grandes quantités avant le milieu du XXe siècle, mais tout à voir avec un mode de production s’appuyant sur la technologie, et dont l’objectif principal est l’accumulation sans fin du capital ».
Cette réflexion sur les effets géologiques du capitalisme mérite une définition claire du capitalisme, comme l’admet d’ailleurs Rotillon dans sa note. Pourtant, il ne fait lui-même pas l’effort de définir ce qu’il entend par « capitalisme ». On retrouve le même problème chez la plupart des auteurs de la décroissance.
Dans une interview récente, Timothée Parrique estime que, pour mettre en œuvre le projet de la décroissance, « il faudra nécessairement sortir du capitalisme », sans pour autant se prononcer sur une mesure précise permettant de le faire. Dans une autre interview pour Reporterre, il est un peu plus explicite, indiquant qu’il faut démanteler les institutions capitalistes telles que « l’organisation du travail sous le salariat, la concentration des moyens de production, l’organisation de la production avec l’objectif de la lucrativité et la vente de marchandises sur des marchés ».
Enfin, dans un article pour Socialter paru en janvier 2025 et co-écrit avec Timothée Duverger, il estime qu’il serait possible d’« éroder le capitalisme » en utilisant les outils de l’économie sociale et solidaire (ESS) pour en faire « le principal système économique en France ». L’ESS, parce qu’elle est fondée sur un principe de non-lucrativité, permettrait de « rompre avec la course aux profits ». D’autres institutions, telles que la création d’une « monnaie libre » par la banque centrale ou un « revenu minimum garanti » permettant d’accéder à des services de base seraient également nécessaires.
Rien ne démontre, pourtant, que ces mesures suffiraient à rompre avec le capitalisme. Il n’est pas plus démontré qu’elles permettraient de fonder une société post-croissance. L’ESS, comme cela est d’ailleurs souligné dans l’article, n’est en rien incompatible avec le capitalisme ou la croissance. Les coopératives ouvrières, par exemple, ont bien pour but de se développer et de s’étendre en vendant sur un marché. Considérer la non-lucrativité des activités économiques comme suffisante pour parvenir à la décroissance est une erreur – nous y reviendrons. Pire, certaines banques mutualistes comme le Crédit Agricole se sont allégrement transformées en société capitaliste pour mener des acquisitions dans le monde entier. Banque populaire et Caisse d’épargne se sont pour leur part associées pour crée Natixis, une banque d’affaires qui a effectué des rachats d’entreprises douteuses et investi dans les crédits subprime avant la crise de 2008. Enfin, notons que le secteur de l’ESS n’est pas épargné par les stratégies d’exploitation ou la souffrance au travail, comme l’ont révélé de nombreuses enquêtes (1).
Définir les termes
Avant d’en venir à une définition précise du capitalisme, il convient de clarifier certains termes souvent utilisés par les auteurs décroissants et associés indument au capitalisme. Ainsi, la marchandisation ou la quête de profit ne sont pas propres au système capitaliste. À l’époque médiévale, les systèmes commerciaux et bancaires se sont développés sans que les sociétés du XIIIe siècle ne puissent être qualifiées de capitalistes. De même, l’exploitation de la main-d’œuvre est une constante de l’Histoire. La Grèce et la Rome antique étaient des sociétés esclavagistes sans pour autant être capitalistes.
Enfin, le productivisme contemporain n’a pas été l’apanage du capitalisme. L’Union soviétique et la Chine maoïste étaient tout autant productivistes que leurs rivaux dans les années 1960. Elles étaient même, sans doute, davantage obsédées par les taux de croissance de leurs plans quinquennaux que ne l’étaient les responsables politiques occidentaux. De fait, de la grande campagne du moineau à la dévastation de la mer d’Aral, les dégâts écologistes des économies planifiées n’ont rien à envier à ceux des sociétés capitalistes.
En somme, ni la quête de profit – y compris financiers –, ni l’exploitation du travail et de la nature, ni même le productivisme ne sont des attributs propres du capitalisme. Ainsi, sortir du capitalisme n’implique pas nécessairement la disparition de ces aspects de la société que les partisans de la décroissance entendent combattre. Cela ne signifie pas pour autant qu’une sortie du capitalisme n’est pas nécessaire. Encore faut-il définir ce dernier de manière claire et en comprendre la logique sous-jacente.
La littérature économique définit traditionnellement le capitalisme par la coexistence, au sein d’un même système social et économique, de trois principes fondamentaux : la propriété privée du capital, le rapport salarial et la coordination marchande.
Le capital correspond aux moyens de production, c’est-à-dire aux outils matériels et immatériels permettant de produire des biens et services. Dans une société capitaliste, même s’il peut exister du capital public ou socialisé (une coopérative détenue par ses salariés par exemple), la majorité du capital doit être possédée par des agents privés qui tirent de cette gestion l’essentiel de leurs revenus – car non, posséder quelques actions sur un PEA ne transforme pas un travailleur en capitaliste.
Un deuxième principe, directement lié au premier, est le rapport salarial. Le rapport salarial reflète le rapport de domination du salarié par son employeur. Concrètement, cela signifie que l’entreprise est gérée non pas collectivement, en associant travailleurs et propriétaires, mais exclusivement, ou presque, par le détenteur du capital. Le droit du travail permet d’atténuer cette domination sans la supprimer. Le rapport salarial s’exerce au sein de l’activité professionnelle et est contractualisé. Le travailleur n’est pas un esclave. Il délègue à son employeur le droit de gérer et d’exploiter sa force de travail, mais pas sa personne. Il renonce ainsi au fruit de son travail qui est capté par l’entreprise et redistribué à ses propriétaires.
Enfin, le troisième principe du capitalisme est la coordination marchande. Le marché a deux fonctions. La première est d’organiser le système logistique qui permet à l’entreprise de fonctionner. La production représente une activité de transformation de marchandises (la force de travail, les matières premières, les biens d’équipement) en d’autres marchandises. Pour que ce processus fonctionne, il faut, comme l’a montré l’économiste et historien Karl Polanyi (2), que l’ensemble de la société gère les flux entrants et sortants au sein d’un système marchand. Afin d’organiser rationnellement sa production, l’entrepreneur doit pouvoir acheter des moyens de production standardisés sur un marché suffisamment vaste, et revendre sa production sur le même marché global (3).
La seconde fonction du marché est d’évaluer la valeur d’échange des marchandises. En effet, pour produire, une organisation doit être capable d’établir une comptabilité objective lui permettant d’agréger, sous forme de valeur monétaire, les éléments de son actif et de son passif. Ce sont les marchés, c’est-à-dire l’offre et la demande, qui déterminent les prix des actifs et permettent de calculer le profit comptable à distribuer.
La dynamique capitaliste
Propriété privée du capital, système de marché et rapport salarial permettent conjointement de définir un système pleinement capitaliste. Lorsqu’ils sont réunis, ces trois éléments enclenchent des processus de transformation et conduisent à l’émergence d’institutions spécifiques.
Premier processus, l’accumulation du capital. Le calcul du profit comptable, conséquence de la valorisation marchande, permet de distribuer des revenus aux propriétaires, mais il permet aussi – et surtout – d’accumuler ces revenus afin de financer l’achat de capital productif supplémentaire. Cet investissement est au cœur de la dynamique capitaliste et de la croissance économique. En effet, la nature même du capitalisme n’est pas tant dans la lucrativité immédiate que dans l’espérance d’une lucrativité future supplémentaire.
Tout ce vers quoi tend le capitaliste repose sur une logique d’accumulation des moyens de production. Cette accumulation est la conséquence d’un système productif majoritairement industriel. Dans une économie agricole en effet, les limites du foncier cultivable font qu’il n’est pas possible d’accumuler au-delà d’un certain point. Lorsque toutes les terres arables sont possédées, l’acquisition de terres supplémentaires n’est possible qu’en spoliant un autre propriétaire. À l’inverse, la capacité d’accumuler du capital industriel est pratiquement illimitée. On peut toujours améliorer des machines ou en ajouter sans forcément les prendre à un concurrent. C’est parce que le capitalisme industriel s’extrait des contraintes naturelles – au moins dans un premier temps – qu’il parvient à engager un processus d’accumulation.
Le deuxième processus engendré par le capitaliste est l’expansion. Marx avait noté que le capitalisme, poussé par la logique d’accumulation, ne pouvait que s’étendre. Cette extension se fait à deux niveaux. En premier lieu, au sein de l’économie, la logique capitaliste se propage dans l’ensemble des secteurs d’activité, détruisant les formes traditionnelles de production les unes après les autres. L’agriculture, au départ exclue des procédés capitalistes, transforme son système productif en se mettant à gérer la terre et son exploitation comme un capital.
Si la paysannerie traditionnelle fonctionne de manière autonome, l’agriculture contemporaine est mécanisée et spécialisée. Pour produire, elle doit consommer une quantité croissante de matières premières (engrais, produits phytosanitaires, machines, carburant…) tout en produisant un nombre de plus en plus restreint de produits agricoles. La logique d’accumulation est au cœur de son modèle ; elle est permise par le rachat des terres, des exploitations insuffisamment capitalistes et qui sont condamnées à la faillite. En fin de compte, une forme de paysannerie ne subsiste plus que dans les fermes opérant au sein de milieux non standardisés (moyennes, montagnes, zones humides…).
Le commerce est une autre activité traditionnelle qui subit une transformation capitaliste. L’épicerie traditionnelle de centre-ville disparaît au profit de franchises détenues par les géants de la distribution. Ces derniers utilisent la puissance de leurs centrales d’achat pour faire disparaître les commerçants indépendants.
Le second niveau d’expansion du capitalisme est géographique. Poussé par une production toujours plus importante, le système capitaliste doit trouver des débouchés dans l’exportation. Il doit aussi trouver des ressources et des matières premières à l’étranger. Il étend donc ses réseaux logistiques au-delà de ses frontières, ouvre des mines et supplante l’économie traditionnelle des autres pays. Cela peut passer par un processus colonial ou de manière plus insidieuse, par des investissements. Le résultat est que la dynamique capitaliste finit inéluctablement par s’étendre dans toutes les sphères de l’économie et dans le monde entier.
Le troisième processus engendré par le capitalisme est la monétarisation. L’économie capitaliste est nécessairement une économie monétaire. La monnaie permet la marchandisation de la société. En tant qu’institution, la monnaie est nécessaire à la logique capitaliste, car elle unifie le calcul de la valorisation marchande en fournissant un étalon de valeur stable tout en permettant à chacun d’entreprendre et d’acheter dans n’importe quel secteur de l’économie. De plus, c’est par la monnaie que les flux intersectoriels ont lieu. C’est ainsi grâce à elle que le capitalisme s’étend au sein de l’économie et d’une économie à l’autre. La monétarisation engendre de nouveaux comportements. Comme l’accès à la monnaie devient une condition nécessaire pour entreprendre ou consommer, elle devient le centre de la vie sociale, poussant chacun à adopter des stratégies parfois dégradantes pour y accéder.
De nouvelles institutions capitalistes
Le capitalisme produit des dynamiques qui révolutionnent constamment l’organisation sociale et les processus productifs. Le monde capitaliste est donc en perpétuelle mutation. Ainsi, pour durer dans le temps, il lui faut des institutions fortes et stables susceptibles de canaliser sa dynamique interne.
La première de ces institutions est l’État. L’État n’est pas propre au capitalisme, mais il ne peut pas y avoir de capitalisme sans État. Nous entendons par « État » un système d’institutions juridiques stable et rationnel générant un comportement relativement prévisible. Le concept d’État présenté ici s’oppose donc à la fois à un système absolutiste dirigé par une seule personne au comportement imprévisible, et à un système qui serait fondé sur des communautés autonomes, liées entre elles par des accords pouvant être librement renégociés. Dans le premier cas, l’absence totale de démocratie et de contre-pouvoirs empêche les institutions de jouer leur rôle de coordination sociale, puisque tout fonctionne selon la volonté et les désirs d’un tyran ; dans le second, la forme de démocratie complète qui prévaut à la fois au sein des communautés et entre les communautés conduit à l’impossibilité d’instituer un système stable permettant au capitalisme de se déployer sereinement.
Au-delà de son aspect rationnel et prévisible, un État capitaliste a différentes fonctions. Premièrement, il doit garantir le respect de la propriété privée en instituant un système judiciaire et policier permettant à chacun de posséder réellement des droits économiques. Deuxièmement, à partir du moment où le capitalisme repose sur un système productif relativement complexe et sur une technologie avancée, il doit assurer la formation de la main-d’œuvre et faire en sorte que les compétences acquises par cette main-d’œuvre soient relativement standardisées. Enfin, l’État doit prendre à sa charge la production de services et d’infrastructures nécessaires à la production capitaliste (routes, ports, systèmes d’assainissement, défense nationale, diplomatie économique…).
La deuxième institution nécessaire au capitalisme est l’organisation d’un système bancaire et financier qui dispose d’une certaine autonomie. Dans le système capitaliste, le degré d’autonomie du système financier peut varier d’une période à l’autre. Durant les années 1960, cette autonomie était faible. La finance était très largement contrôlée par les États. À partir des années 1970, au contraire, la finance s’est progressivement émancipée de la tutelle étatique sous l’effet des politiques néolibérales et de la lutte contre l’inflation.
Le rôle du système bancaire et des marchés financiers est triple. D’abord, le système financier permet, comme son nom l’indique, d’organiser le financement des activités productives – qu’elles soient privées ou publiques. Ensuite, les marchés financiers sont le lieu où se détermine la valeur du capital. Ils permettent également de faire émerger des anticipations. Enfin, le système financier permet de réarranger la propriété du capital, d’organiser des fusions ou des dépeçages de sociétés. Toutes ces fonctions sont absolument essentielles à l’activité économique capitaliste. La finance amorce et sécurise la logique d’accumulation.
Troisième institution fondamentale du capitalisme : la régulation économique. Comme cela a été dit précédemment, le système capitaliste engendre une profonde instabilité, laquelle s’accroit à mesure que le système productif se complexifie, que la consommation se diversifie et que la sphère financière s’élargit. À tout moment, une crise financière ou une perturbation exogène – comme une guerre ou une pandémie – peuvent apparaître et déstabiliser les anticipations et le système économique dans son ensemble. Dans ce cas, le rôle de la régulation économique est de rétablir la confiance en amortissant les chocs ou en garantissant les patrimoines. La gestion de la crise Covid fut en ce sens emblématique : le fort interventionnisme des États permit d’éviter que la crise pandémique n’engendre une trop forte déstabilisation économique.
La régulation permet enfin d’assurer des débouchés au système productif. C’est ainsi que, au fur et à mesure que le capitalisme se développe, la dépense publique tend à augmenter structurellement. L’endettement public est lui-même un facteur de stabilisation du système financier qui a besoin, pour son développement, des titres de dettes publiques qui sont utilisés comme collatéral pour la plupart des opérations financières. Dette publique et dépenses publiques sont donc des instruments de régulation économique ; ce sont également, contrairement à ce que croient les éditorialistes, des facteurs de stabilisation qui sont absolument nécessaires au fonctionnement du système capitaliste.
Décroissance et capitalisme
À présent que la nature et le fonctionnement du capitalisme ont été décrits, il faut répondre à la question posée : le système capitaliste est-il compatible avec une dynamique de décroissance ?
Avant de répondre sur le fond, notons tout d’abord qu’une décroissance du PIB n’a rien de saugrenu dans une économie capitaliste. La Grèce a connu une longue période de récession entre 2008 et 2016 ; elle n’est pourtant pas sortie du capitalisme durant cette période. Les récessions existent. Elles peuvent être longues et engendrer une baisse durable du PIB. Pour autant, les récessions ne constituent pas la norme du système capitaliste ; par certains côtés elles révèlent un dysfonctionnement ou une période de transition entre différentes phases du capitalisme. Elles sont l’exception, et non la règle.
La norme du capitalisme est la croissance économique, et cela pour une raison simple : le capitalisme est fondé sur la dynamique d’accumulation que nous avons décrite plus haut. Or, comme le capital correspond à des moyens de production, plus celui-ci s’accumule chez les capitalistes, plus il s’accumule dans la société, et plus le volume de marchandises produit augmente. Cette logique d’accumulation repose sur la capacité des entrepreneurs à réinvestir leur profit dans le but d’augmenter leur pouvoir économique et leurs profits futurs. Il faut donc un profit comptable positif et que ce dernier ne soit pas entièrement redistribué pour qu’il y ait accumulation. Cette dynamique augmente la valeur des entreprises et le patrimoine des propriétaires. Il augmente aussi les flux de rémunération du capital, puisque le profit est toujours exprimé en proportion de la valeur de l’investissement. Par exemple, si une entreprise dont le capital vaut 1000 fait un profit de 10 % dont la moitié est réinvestie, sa valeur devient 1050 et le profit attendu de la prochaine période devrait être de 10 % de 1050 soit 105.
Le PIB, comme nous l’avons vu dans un précédent article (Doit-on se débarrasser du PIB ?), représente la somme des revenus. Que se passe-t-il si le PIB diminue ? Comme le stock de capital progresse, les flux de revenu du capital augmentent eux aussi. Ainsi, la seule manière de décroître le PIB serait de baisser encore plus les autres revenus composant le PIB, c’est-à-dire les revenus du travail. Dans un régime où le rendement du capital est positif et où il y a accumulation du capital, alors la décroissance du PIB renforce considérablement les inégalités. C’est notamment la thèse défendue par Thomas Piketty dans Le Capital au XXe siècle, et qui exprime une équation fondamentale du capitalisme : si r (le rendement du capital) est supérieur à g (la croissance économique), alors les inégalités progressent. Dans le cas contraire, la hausse des flux de revenus profite aux salariés, ce qui fait diminuer le niveau d’inégalité.
On déduit de ce raisonnement qu’il existe une contradiction fondamentale entre la décroissance et la soutenabilité sociale si le rendement du capital est positif. Or, un rendement du capital négatif signifie que les entreprises font des pertes. Il n’y aurait donc plus aucun intérêt à investir. Le processus d’accumulation s’interrompt, et le capital, non renouvelé, s’use inéluctablement. Au bout d’un moment, toute activité productive s’arrête. Notons que, dans cette logique, on ne réduit pas simplement la taille de l’économie, on la fait, à terme, entièrement disparaître ; on organise à terme l’absence de toute production de biens et services, y compris les services essentiels que les partisans de la décroissance entendent préserver (logement, santé, alimentation…).
Tout cela démontre que pour préserver un système productif minimal, il faut que l’investissement ne soit pas assis sur le principe de la propriété privée du capital. Dans ce cas, l’absence de rentabilité cesse d’être un problème et un système productif post-croissance peut s’enclencher sans faire exploser les inégalités.
Le rapport salarial est lui aussi incompatible avec la logique décroissante. En effet, la domination du travail par le capital n’a en réalité qu’un seul but : celui d’augmenter la productivité du travail en passant outre l’avis des salariés. Si la productivité augmente, c’est essentiellement pour produire davantage, ou pour produire autant avec la même quantité de travail. Produire davantage est incompatible avec la logique décroissante. Il faudrait donc que la hausse de la productivité du travail se traduise par une baisse de la quantité de travail. Nous verrons dans un prochain article que la baisse du temps de travail prônée par les partisans de la décroissance pose des questions et des problèmes spécifiques. Ce qui est certain, au point où nous en sommes, c’est que la logique de maximisation de la productivité du travail n’est pas compatible avec le projet décroissant. Il faudrait donc réorganiser les processus productifs pour transformer en profondeur le rapport salarial.
Dernière institution fondamentale du capitalisme : la coordination marchande. Cette dernière pose également problème. Marchandisation et monétarisation, on l’a vu plus haut, tendent à bouleverser les comportements. L’acquisition de monnaie devient nécessaire pour accéder aux biens et s’inscrire dans la vie sociale. Cette logique pousse chacun à l’accumulation monétaire, la thésaurisation, ce qui est incompatible avec la décroissance. De même, la logique marchande est essentiellement poussée par la quête de profit. Or, le profit doit nécessairement être limité dans une société décroissante afin d’éviter l’accumulation. Si la dimension marchande doit régresser, cela conduit à inventer un autre système d’allocation et de distribution des ressources, par exemple un système fondé sur la gratuité, avec des limites imposées à l’acquisition de biens ou de services.
Notons que cette démarchandisation est incompatible avec le principe du revenu minimum garanti tel qu’il est proposé par la plupart des théoriciens de la décroissance (4), puisque tout revenu monétaire ne peut être dépensé que si la sphère marchande s’est préalablement développée (voir note 3).
Reste à savoir quelle place laisser au marché, c’est-à-dire à l’autonomie de la consommation. Si l’objectif est de réduire globalement la consommation, il faudra nécessairement réduire fortement les revenus et limiter la capacité d’acheter librement.
Pour sortir de la croissance, quelles institutions faudrait-il changer ?
Il ne fait aucun doute que la décroissance est incompatible avec le capitalisme. Aller vers la décroissance implique de renoncer à la logique d’accumulation, à la propriété privée du capital, au rapport salarial et à la coordination marchande.
La décroissance n’est pas incompatible avec toute propriété privée. Le problème se pose pour la propriété des moyens de production et pour orienter l’investissement. Peut-on néanmoins, comme le suggère Timothée Parrique, sortir du capitalisme et organiser la décroissance en développant des systèmes de propriété collective tels qu’ils existent dans l’ESS ? L’idée semble intéressante dans la mesure où les parties prenantes des entreprises de l’ESS, salariés et usagers qui possèdent les parts sociales, ne sont pas rémunérées. C’est le principe de la non-lucrativité. Toutefois, il convient de souligner que la non-lucrativité concerne la distribution des profits. Elle n’implique pas l’absence de profit. D’ailleurs, les entreprises de l’ESS font des profits. Ces profits sont obligatoirement soit réinvestis, soit distribués au sein du secteur associatif pour d’autres projets. Cette distinction entre profit et non-lucrativité est essentielle. Elle explique pourquoi les entreprises de l’ESS n’échappent pas à la logique d’accumulation puisqu’elles sont tenues de réinvestir leurs profits.
Ainsi, s’il est vrai qu’organiser l’ensemble de l’économie autour de l’ESS serait incompatible avec la propriété privée du capital et donc avec le capitalisme, cela ne changerait pas la logique d’accumulation. Or, c’est cette dernière qui est incompatible avec la décroissance. Autrement dit, l’ESS telle qu’elle fonctionne ne peut pas porter un projet décroissant puisque les entreprises de l’ESS sont elles aussi fondées sur une logique de croissance. Notons aussi que l’ESS n’est pas nécessairement incompatible avec le rapport salarial lorsque les parts sociales de l’entreprise sont détenues par les usagers, comme c’est la norme dans le secteur mutualiste. Seules les coopératives salariées échappent au rapport salarial, puisque dans ce cas, les propriétaires du capital sont également les salariés de l’entreprise.
Les entreprises de l’ESS posent un dernier problème. Ce sont des entités privées qui poursuivent des objectifs propres. Elles peuvent ainsi acheter des terres, accaparer des ressources naturelles, gérer une flotte de véhicules polluants. En réalité, rient n’interdit à une association à but non lucratif de polluer. Il ne suffit pas d’avoir une gouvernance démocratique pour être spontanément vertueux sur le plan écologique. Ainsi, si l’on entend limiter l’exploitation des ressources naturelles, cela impose de mettre en place des contraintes à la liberté d’entreprendre et de possession.
L’une des propriétés les plus problématiques du point de vue écologique est la propriété foncière. Aujourd’hui, posséder une terre, c’est avoir le droit de l’exploiter, que ce soit du point de vue agricole ou minier. Ce droit est, heureusement, encadré. Mais il constitue un principe fondamental d’une société capitaliste. Le propriétaire peut librement et individuellement décider d’exploiter ou de faire exploiter une terre qu’il possède.
Organiser la décroissance impose de gérer les ressources naturelles de manière parcimonieuse. Il faudrait donc organiser une exploitation rationalisée de celles-ci, en fonction de besoins sociaux définis collectivement. Cela implique une transformation fondamentale du droit de propriété. Si la propriété privée d’une maison avec jardin ne pose pas de problème, la propriété de forêts, de terres arables ou d’espaces naturels riches en ressources se posera nécessairement dans une société visant la décroissance.
Enfin, il faut ajouter une réflexion sur l’État. Les partisans de la décroissance tels que Vincent Liegey, dans son ouvrage de présentation de la décroissance, conçoivent une société fondée sur de petites communautés autogérées à l’image des ZAD, telle que celle qui s’est développée sur le site envisagé pour le déplacement de l’aéroport de Nantes. Cette vision est issue des approches technocritiques inspirées de la pensée de Jacques Ellul, qui relie progrès technologique et autoritarisme étatique, comme nous l’avons précédemment souligné (lire La décroissance implique-t-elle de renoncer au développement ?) . Ce rejet de l’État pose néanmoins un problème de fond. Comment empêcher des communautés autonomes et autogérées d’accaparer des ressources, de les exploiter et d’amorcer une dynamique de croissance capitaliste ? Vincent Liegez, comme de nombreux auteurs décroissants, font le pari d’une révolution d’ordre morale ou spirituelle qui modifierait en profondeur les attentes et les désirs des populations. Reste que cette « décolonisation de l’imaginaire », pour laquelle milite Serge Latouche dans Le Pari de la décroissance, n’est pour l’heure qu’un projet de long terme et, à vrai dire, on voit mal comment il pourrait être mené à bien.
Plutôt que de s’attaquer à l’imaginaire, il faudra donc, au moins dans un premier temps, imposer à l’ensemble de la société une restriction dans sa capacité à exploiter son environnement. Cela ne peut pas se faire sans un État fort qui limitera forcément l’autonomie des individus et des collectifs. L’espoir d’une société sans État est profondément incompatible avec le projet de la décroissance. De même, la sphère bancaire et financière devra elle aussi perdre une grande partie, si ce n’est la totalité, de son autonomie.
*
Au terme de cette réflexion, trois conclusions s’imposent. La première est que, incontestablement, le projet décroissant est incompatible avec le système capitaliste. La deuxième est que, si la sortie du capitalisme est nécessaire, elle n’est en aucun cas suffisante. L’exploitation de son environnement et du travail d’autrui, la croissance économique et le productivisme, peuvent parfaitement exister en dehors du système capitaliste.
Enfin, la dernière conclusion est que les théoriciens de la décroissance n’ont pas véritablement réfléchi aux institutions permettant la décroissance, car la plupart des réformes institutionnelles qu’ils préconisent ne permettront pas d’établir une société post-croissance. L’ESS n’empêche pas l’accumulation du capital ni la croissance ; le revenu minimum garanti suppose une sphère marchande développée ; enfin, la disparition de l’État et une organisation sociale fondée sur des communautés autogérées risquent d’échouer à contrôler l’exploitation des ressources naturelles et les logiques capitalistes, lesquelles pourraient à tout moment resurgir.
Notes
(1) Voir par exemple : Pascale-Dominique Russo, Souffrance en milieu engagé. Enquête sur des entreprises sociales, Éditions du faubourg, 2020. Plus récemment, le rapport de l’UDES (Union des Employeurs de l’économie sociale et solidaire) sur la santé au travail dans l’ESS montre que près de la moitié des salariés de l’ESS ont le sentiment d’une dégradation de la qualité de vie au travail.
(2) Karl Polanyi (1983), 1944, La Grande Transformation, trad. C. Malamoud, Gallimard, Paris.
(3) La création de ce marché global est un processus extrêmement délicat et constitue sans doute l’un des problèmes les plus difficiles du développement capitaliste. Beaucoup d’économies ne peuvent se développer faute d’accéder aux ressources productives nécessaires (main-d’œuvre qualifiée, matières premières, énergie peu chère…) ou faute de débouchés suffisants pour leur production. De fait, le capitalisme n’existerait pas sans la logistique marchande qui permet à chacun (consommateurs et entrepreneurs) d’accéder à pratiquement tous ses besoins en échange de monnaie. Dans beaucoup de pays en voie de développement, ce système logistique n’est que partiellement développé, ce qui fait que l’activité productive est difficile à organiser. Réciproquement, un démantèlement de ce système logistique consécutif à une sortie du capitalisme serait sans doute vécu comme une régression épouvantable pour la plupart des habitants des sociétés capitalistes développées. Comme dans les pays du bloc de l’Est avant la chute des régimes d’économie planifiée, le fait de disposer d’argent ne garantirait plus l’accès à un bien ou à une ressource.
(4) Voir par exemple Nick Fitzpatrick, Timothée Parrique et Inês Cosme (2022), « Exploring degrowth policy proposals: A systematic mapping with thematic synthesis », Journal of Cleaner Production, Vol. 365, en ligne.
Cet article est gratuit grâce aux contributions des abonnés !
Pour nous soutenir et avoir accès à tous les contenus, c'est par ici :
S’abonner
Accès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous

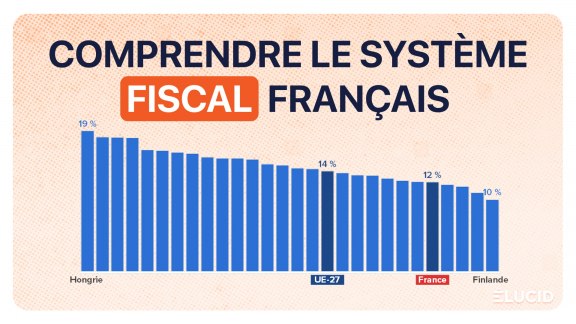






9 commentaires
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.
S'abonner